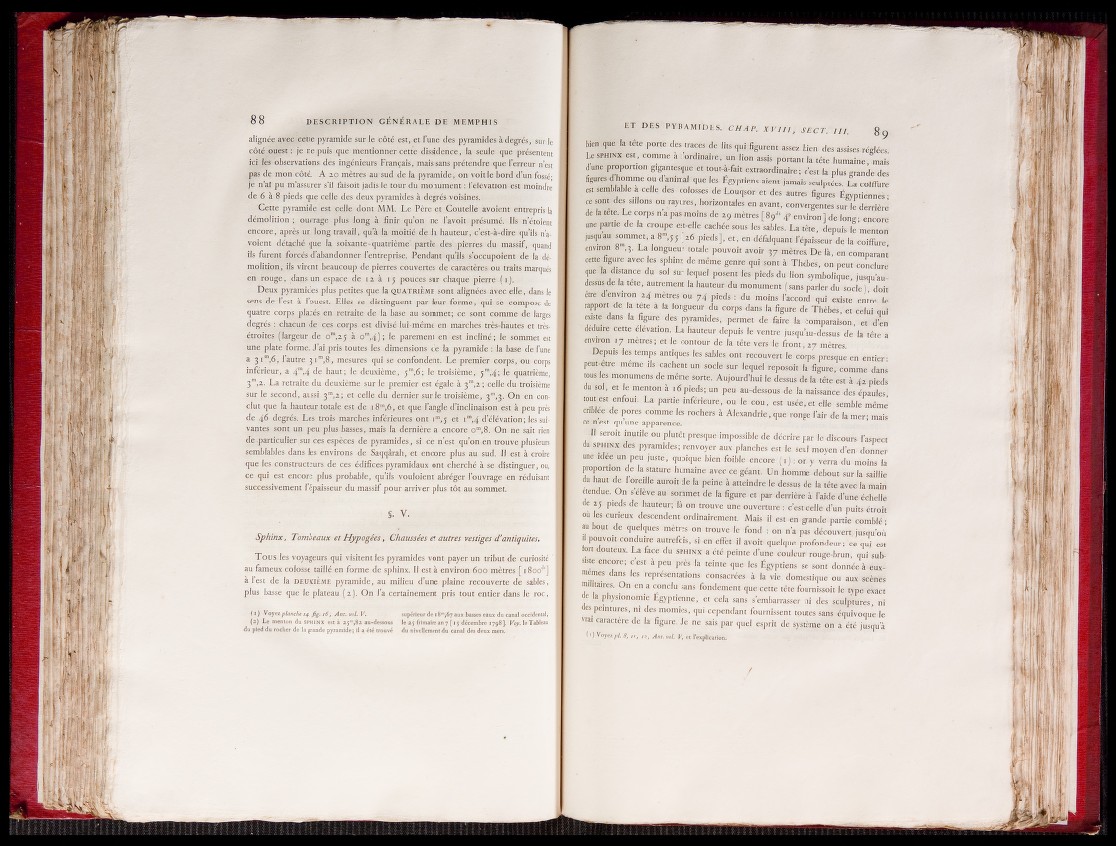
alignée avec cette pyramide sur le côté est, et l’une des pyramides à degrés, sur le
côté ouest : je ne puis que mentionner cette dissidence, la seule que présentent
ici les observations des ingénieurs Français, mais sans prétendre que l’erreur n’est
pas de mon côté. A 20 mètres au sud de la pyramide, on voitle bord d’un fossé-
je n’ai pu m’assurer s’il faisoit jadis le tour du monument : l’élévation est moindre
de 6 à 8 pieds que celle des deux pyramides à degrés voisines.
Cette pyramide est celle dont MM. Le Père et Coutelle avoient entrepris la
démolition ; ouvrage plus long à finir qu’011 ne l’avoit présumé. Ils n’étoient
encore, après un long travail, qu’à la moitié de la hauteur, c’est-à-dire qu’ils n’a-
voient détaché que la soixante-quatrième' partie des pierres du massif, quand
ils furent forcés d’abandonner l’entreprise. Pendant qu’ils s’occupoient de la démolition,
ils virent beaucoup de pierres couvertes de caractères ou traits marqués
en rouge, dans un espace de 12 à 15 pouces sur chaque pierre (1).
Deux pyramides plus petites que la quatrième sont alignées avec elle, dans le
sens de l’est à l’ouest. Elles se distinguent par leur forme, qui se compose de
quatre corps placés en retraite de la base au sommet; ce sont comme de larges
degrés : chacun de ces corps est divisé lui-même en marches très-hautes et très-
étroites (largeur de om,2y à om,4) ; le parement en est incliné; le sommet est
une plate forme. J’ai pris toutes les dimensions de la pyramide : la base de l’une
a 3 1 "">6> lautre 3 1 “ ,8, mesures qui se confondent. Le premier corps, ou corps
inférieur, a 4”\4 de haut; le deuxième, ym,6; le troisième, 5” ,4; le quatrième,
3” a- La retraite du deuxième sur le premier est égale à 3ra,2 ; celle du troisième
sur le second, aussi 3m,2; et celle du dernier sur le troisième, 3m,3. On en conclut
que la hauteur totale est de i8m,6, et que l’angle d’inclinaison est à peu près
de 46 degrés. Les trois marches inférieures ont im,y et im,4 d élévation; les suivantes
sont un peu plus basses, mais la dernière a encore om,8. On ne sait rien
de particulier sur ces espèces de pyramides, si ce n’est qu’on en trouve plusieurs
semblables dans les environs de Saqqârah, et encore plus au sud. Il est à croire
que les constructeurs de ces édifices pyramidaux ont cherché à se distinguer, ou,
ce qui est encore plus probable, qu’ils vouloient abréger l’ouvrage en réduisant
successivement l’épaisseur du massif pour arriver plus tôt au sommet.
§. V.
Sphinx, Tombeaux et Hypogées, Chaussées et autres vestiges d ’antiquités.
T o u s les voyageurs qui visitent les pyramides vont payer un tribut de curiosité '
au fameux colosse taillé en forme de sphinx. Il est à environ 600 mètres [ 18ooJ‘]
a lest de la deuxième pyramide, au milieu d’une plaine recouverte de sables,
plus basse que le plateau (2). On l’a certainement pris tout entier dans le roc,
( 1 ) Voyez p la n c h e 1 4 , f i g . 1 6 , A n t. v o l. V. su périeu r d e 18m,6 7 au x basses eau x du can al occidental,
( - ) L e m e n to n d u s p h in x est à 2$m,82 au -d esso u s le 2 5 frim aire an 7 [15 d écem b re 1798]. Voy. le Tableau
d u p ie d d u ro c h e r d e la g ra n d e p y ram id e ; il a été tro u v é d u n iv ellem en t d u canal des deu x m ers.
E T D E S P Y R A M I D E S . C H A P . X V I I I , S E C T . I I I .
bien que la tete porte des traces de lits qui figurent assez bien des assises réglées
Le sphinx est, comme a ¡ordinaire, un lion assis portant la tête humaine mais
dune proportion gigantesque et to-ut-à-fait extraordinaire; c’est la plus grande des
figures d homme ou d animal que les Egyptiens aient jamais sculptées. La coiffure
est semblable a celle des colosses de Louqsor et des autres figures Égyptiennes I
ce sont des sillons ou rayures, horizontales en avant, convergentes sur le derrière
de la tete. Le corps n’a pas moins de 29 mètres [%'£ 4P environ] de long- encore
une partie de la croupe est-elle cachée sous les sables. La tête, depuis le menton
jusquau sommet, a 8” ,55 [26 pieds], et, en défalquant l’épaisseur de la coiffiire
environ 8 ,3. La longueur totale pouvoir avoir 37 mètres. De là, en comparant
cette figure avec les sphinx de même genre qui sont à Thèbes, on peut conclure
que la distance du sol sur lequel posent les pieds du lion symbolique, jusqu’au-
dessus de la tete, autrement la hauteur du monument (sans parler du socle ) doit
être d environ 24 mètres ou 74 pieds : du moins l’accord qui existe entre le
rapport de la tete a la longueur du corps dans la figure de Thèbes, et celui qui
existe dans la figure des pyramides, permet de faire la comparaison, et d’en
déduire cette élévation. La hauteur depuis le ventre jusqu’au-dessus de la tête a
envnon 17 mètres; et le contour de la tête vers le front, 27 mètres.
Depuis les temps antiques les sables ont recouvert le corps presque en entier:
peut-etre même ils cachent un socle sur lequel reposoit la figure, comme dans
tous les monumens de même sorte. Aujourd’hui le dessus de la tête est à 42 pieds
du sol, et le menton à 16 pieds; un peu au-dessous de la naissance des épaules,
tout est enfoui. La partie inférieure, ou le cou, est usée, et elle semble même
criblée de pores comme les rochers à Alexandrie, que ronge l’air de la mer; mais
ce n est qu une apparence.
SerOIt " lutlle ou P,utôt presque impossible de décrire par le discours l’aspect
u sphinx des pyramides; renvoyer aux planches est le seul moyen d’en donner
une idee un peu juste, quoique bien foible encore (1) : on y verra du moins la
proportion de la stature humaine avec ce géant. Un homme debout sur la saillie
du haut de 1 oreille auroit de la peine à atteindre le dessus de la tête avec la main
etendue. On s élève au sommet de la figure et par derrière à l’aide d’une échelle
de 25 pieds de hauteur; là on trouve une ouverture : c’est celle d’un puits étroit
ou les curieux descendent ordinairement. Mais il est en grande partie comblé-
au bout de quelques mètres on trouve le fond : on n’a pas découvert jusqu’où
d pouvoit conduire autrefois, si en effet il avoir quelque profondeur ; ce qui est
tort douteux. La face du sphinx a été peinte d’une couleur rouge-brun, qui'sub-
«te encore; c’est à peu près la teinte que les Égyptiens se sont donnée à eux-
memes dans les représentations consacrées à la vie domestique ou aux scènes
mi itaires. On en a conclu sans fondement que cette tête fournissoit le type exact
de la physionomie Egyptienne, et cela sans s’embarrasser ni des sculptures, ni
des peintures, ni des momies, qui cependant fournissent toutes sans équivoque le
vrai caractère de la figure. Je ne sais par quel esprit de système on a é t é jusqu’à
( 1) Voyez p l . 8, u , 1 2 , Ant. vo l. V , et l’ex p licatio n .