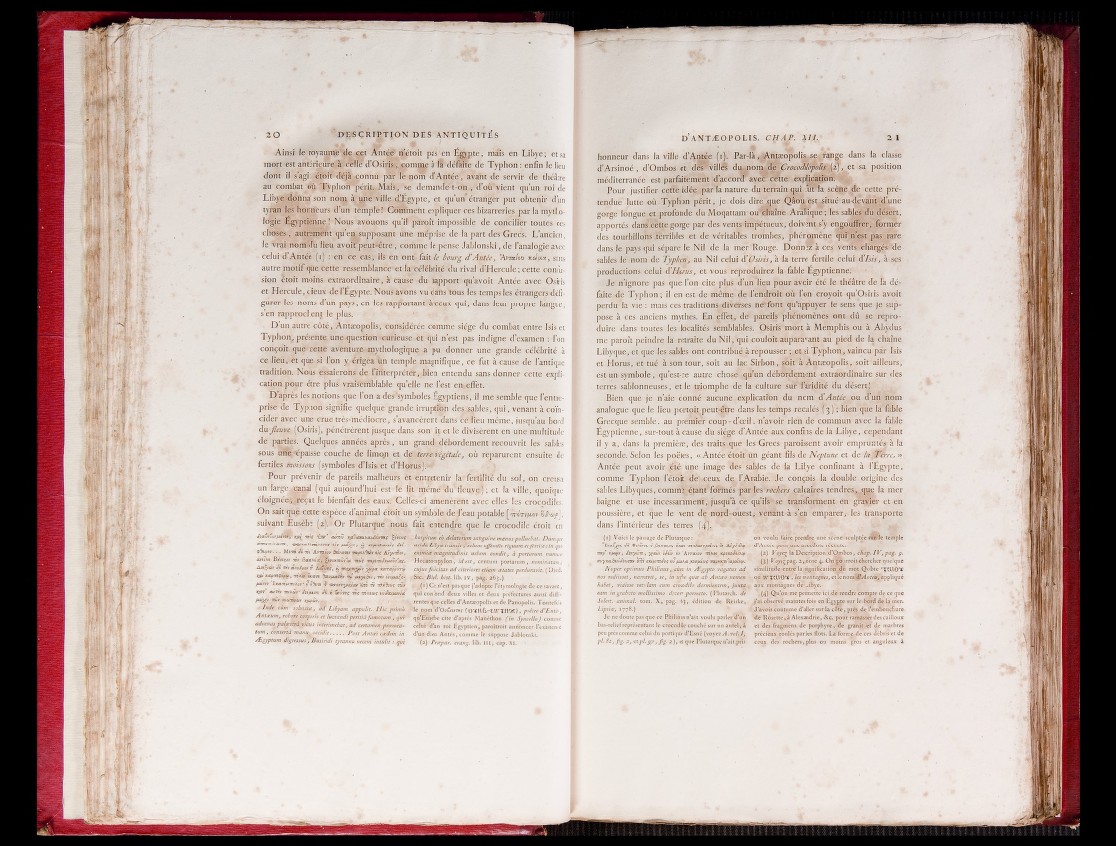
Ainsi Je royaume de cet Antée' n’étoit pas en Egypte, radis en Libye; et sa
mort est antérieure à celle d’O siris, comme à la défàn'e de Typhon : enfin le lieu
dont il s’agit étoit déjà connu par le nom d’A nté e , avant de servir de théâtre
au combat où Typhofrpérit. Mais, se demande-t-on , d’où'vient qu’un roi cle
Libye donna son nom à une ville ^Egypte, et qu’un étranger put obtenir d’un
tyran les honneurs d’un temple ! Comment expliquer ces bizarreries par la mythologie
Egyptienne ! Nous avouons qu’il paroît impossible de concilier toutes ces
choses, autrement qu’en,supposant une méprise de la part des Grecs. L ’ancien,
le vrai nom du lieu avoirpeut-être, comme le pense Jablonski, de l’analogie avec
celui d’Antée (i) : en ce cas, ils en ont fait le bourg d'Antée, ’Avmlov x.wpii, sans
autre motif que cette ressemblance et la célébrité du rival d’Hercule ; cette confusion
étoit moins extraordinaire, à cause du rapport qu’avoit Antée avec Osiris
et Hercule, dieux de l’Egypte. Nous avons vu dans tous les temps les étrangers défigurer
les noms d’un pays, en les rapportant à ceux qui, dans leur propre langue,
s’en rapprochent le plus. 1
Du n autre côté, Antæopolis, considérée comme siège du combat entre Isis et
Typhon^ présente une question curieuse et qui n’est pas indigne d’examen : l’on
conçoit que cette aventure mythologique a pu donner une grande célébrité à
ce lieu, et que si l’on y érigea un temple magnifique, ce fut à cause de l’antique
tradition. Nous essaierons de l’interpréter, bien entendu sans donner cette explication
pour être plus vraisemblable qu’elle ne l’est en effet.
D ’après les notions que l’on a des^symboles Égyptiens, il me semble que l’entreprise
de Typhon signifie quelque grande irruption des 'sables, qui, venant à coïncider
avec une crue très-médiocre, s’avancèrent clans cê lieu même, jusqu’au bord
du fleuve (Osiris), pénétrèrent jusque dans son lit et le divisèrent en une multitude
de parties. Quelques années après, un grand débordement recouvrit les sables
sous une «épaisse couche de limon et de terre végétale, où reparurent ensuite de
fertiles moissons (symboles d’Isist et d’Horus].-'
Pour prévenir de pareils malheurs èt entretenir la“fertilité du sol, on creusa
un large .«mal (qui aujourd’hui est le lit même du fleuve) ; et la ville, quoique
éloignée;-réçut le bienfait des eaux; Celles-ci amenèrent avec elles les crocodiles.
On sait que cette espèce d’animal étoit un symbole de l’eau potable [vror//i.ov -.iiJVi/l,
suivant Eusèbe (2). Or Plutarque nous fait entendre que le crocodile étoit en
¿laStGorfxivov', jcof, otvt -ùsr’ eurnu i&.'IcaaMuàirmç grevé hospilum eo delatonim sanguine manus polluebal. Dumqut
àimun irstnu, notsrutMtmpiroç tic putqqr, x. mpuPauetit tri- arida L-ibyoe transir, solum ojfendit riguum et fertile lin quo
fitip tr... Mira Si tir ‘ Krrflmi Sdram aapihiùr tic AÏpjdtav, eximioe magnitudinis urbem condit, à porlurum numéro
attira Bontir rtr fiaoixtrox-itîiria rtuç oaptmSOuoor'lac. H e c a rom p y lo n , ïd est, c cm um portarum , namintuami Aitfyci. Stror anjfyoy 1* AiCtltiç, £ mesrujpy ytôpa iutrapprrrqt cuÿus félicitas ad citeriores eùam oetates perduravir. ( Diod. Xgr y-apmaépa, mrai txnn javparor n S /utyiSti, 7xV iyopxado- , S i c . Blbl. h ¡st. lib . IV , pa g. 2 6 3 .)
p in s irutripuontr « lira ¥ napmyreiat'dm n talft vt sût I ( i ) C e n’est pas qu e j ’ad opte ¡’ é tym o lo g ie d e ce s a v an t ,
KfCT aanr au su r biparti Ji n tstonç s i c rnntuç tvbuporiu q u i c on fon d d eu x v illes et d eu x préfectures aussi diffé-
tM0&‘ ttcoiiptot xaipar. N 1 è, rentes qu e ceües d ’Antseopolis et d e P anopo lis . T o u te fo is
Jade eum solyisset, ad Libyam appulit. H ic primo le n om d ’O v â u n c ( O 'X I tf à - E i r r l B î) , prêtre d'Em is,
A n tium , roboreçotporis a luctandiperitiâ famosum, qui qu’E d s è b e cite d ’après M an éth on (in Syncello) comme
advenas paloestra victos interimebat, ad certamen provoca- c e lu i 'd ’un ro i É g y p t ie n , pa roîtro it an nonce r l ’existence
tum , concerta m a n u , occid it P o s t A n toe i ardent in d’un dieu A n t é s , com m e le suppose Jab lonski.
Æg yptum digressus, B u sir id i tyranno necem intù lit : q u i (2 ) Proepar. evang. lib . I I I , cap. X I . •
honneur dans la ville d’Antée (i). Par-là, AntæopoIis^.se.s iange dans la classe
d’Arsinoé , d’Ombos et des’ villes du ¿nom dé Crocodllffpolis (2), et sa position
méditerranée est parfaitement d’accorcf avec' cette explication.
Pour justifier cette idée par la nature du terrain qui fu iia scène de cette prétendue
lutte où Typhon périt, je dois dire que Qâou est .situé-au-devant d’jine
gorge longue et profonde du Moqattam ou1 chaîne Arabique ; les sablés du désert,
apportés dans cette gorge par des vents impétueux, doivent s’y engouffrer, former
des tourbillons .terribles et de véritables trombes, phénomène qui n’èst pas rare
dans le pays cpii sépare le Nil de la mer Rouge. Donnez à ces vents chargés-'Me
sables le nom de Typhon, au Nil celui d’Osiris, à la terre fertile celui d’Isis, à ses
productions celui cl 'Ho rus, et vous reproduirez la fable Egyptienne.
Je n’ignore pas que l’on cite plus d’un lieu pour avoir été le théâtre de la défaite
de Typhon ; il en est de même de l’endroit où l’on croyoit qu’Osiris avoit
perdu la vie : mais ces traditions diverses ne’ font qu’appuyer le sens que je suppose
à ces anciens mythes. En effet, de pareils phénomènes ont dû se reproduire
dans toutes les localités semblables. Osiris mort à Memphis ou à Abydus
me paroît peindre la retraite du Nil, qui couloit auparavant au pied de la chaîne
Libyque, et que les sables ont contribué à repousser ; et si Typhon, vaincu par Isis
et Horus, et tué à son tour, soit au lac Sirbon, soit à Antæopolis, soit ailleurs,
est un symbole, qu’est-ce autre chose qu’un débordement extraordinaire sur des
terres sablonneuses, et le triomphe de la culture sur l’aridité du désert!
Bien que je n’aie donné aucune explication du nom d’Antée ou d’un nom
analogue que le lieu portoit peut-être dans les temps reculés ( 3 ) ; bien que la fable
Grecque semble, au premier coup-d’oe il, n’avoir rien de commun avec la fable
Égyptienne, sur-tout à cause du siège d’Antée aux confins de là Libye, cependant
il y a, dans la première, des traits que les Grecs paraissent avoir empruntés-à la
seconde. Selon les poètes, « Antée étoit un géant fils de Neptune et de la Terre. »
Antée peut avoir été une image des sables de la Libye confinant à l’Égypte,
comme Typhon l’étoit de ceux de l’Arabie. Je conçois la double origine des
sables Libyques, comme étant formés par les rochers calcaires tendres, que la mer
baigne et use incessamment, jusqu’à ce qu’ils ‘ se transforment en gravier et en
poussière, et que le vent de nord-ouest, venant-à s’en emparer, les transporte
dans l’intérieur des teri •es (4). I
(1) Voici le passage de Plutarque:
’ EracJ^of J î <&i\noç 0 (ÎAKitçnç i\xa>7 ■mtâcun/Mroç à» A iy jx iu
imp ììjufpy, Jivy iiiD , ¿çetuv IJiiv ¿v 'A trcciou imAet Kpo>toJithco
cvyxdtditjJbvtmr fà n otdy.imJbç tv /xeLhot flor/u aç imp ixn 'ia p jtra.
JVirper opt ¡mus Philinus, cimi in Ægypto vagatus ad
nos redii s s et, narravi t, se, in urbe quoi ab Antato nomen
habet, vi disse vetulam cum crocodilo dormientem, juxta
eam in grabato mollissimo dixore porrecto. (Plutarch, de
Solerr. animal, tom., X., pag. 63, édition de Reiske,
Lipsia, 1778.)
Je ne doute pas que ce Phiiinus n’ait voulu parler d’un
bas-relief représentant le crocodile couché sur un autel, à
peu prés comme celui du portique d’Esné (voyez A.vol./,
pl. 8z,fig. 2, et pl. 97 y fig- 2), et que Plutarque n’ait pris
ou voulu faire prendre une scène sculptée survie temple
d’Antée pour une anecdote récente.
(2) Voyeç la Description d’O.mbos, chap. IV , pag. 9.
(3) note 4- On pourrait chercher quelque
similitude entre la signification du mot Qobte TXÜD'K’
ou KTOLiOY > p i montagnes, et le nom- d’Anteu, appliqué
aux montagnes de Libye.
’ (4) Qu’on me permette ici de rendre compte de ce que
, j’ai observé maintes fois en Egypte sur le bord de la mer.
J’avois coutume d’aller sur la côte, près de l’embouchure
de Rosette, à Alexandrie, &c. pour ramasser des cailloux
et des fragmens de porphyre, de granit et de marbres
précieux roulés par les flots. La forme de ces débris et de
ceux des rochers, plus ou moins gros et anguleux à