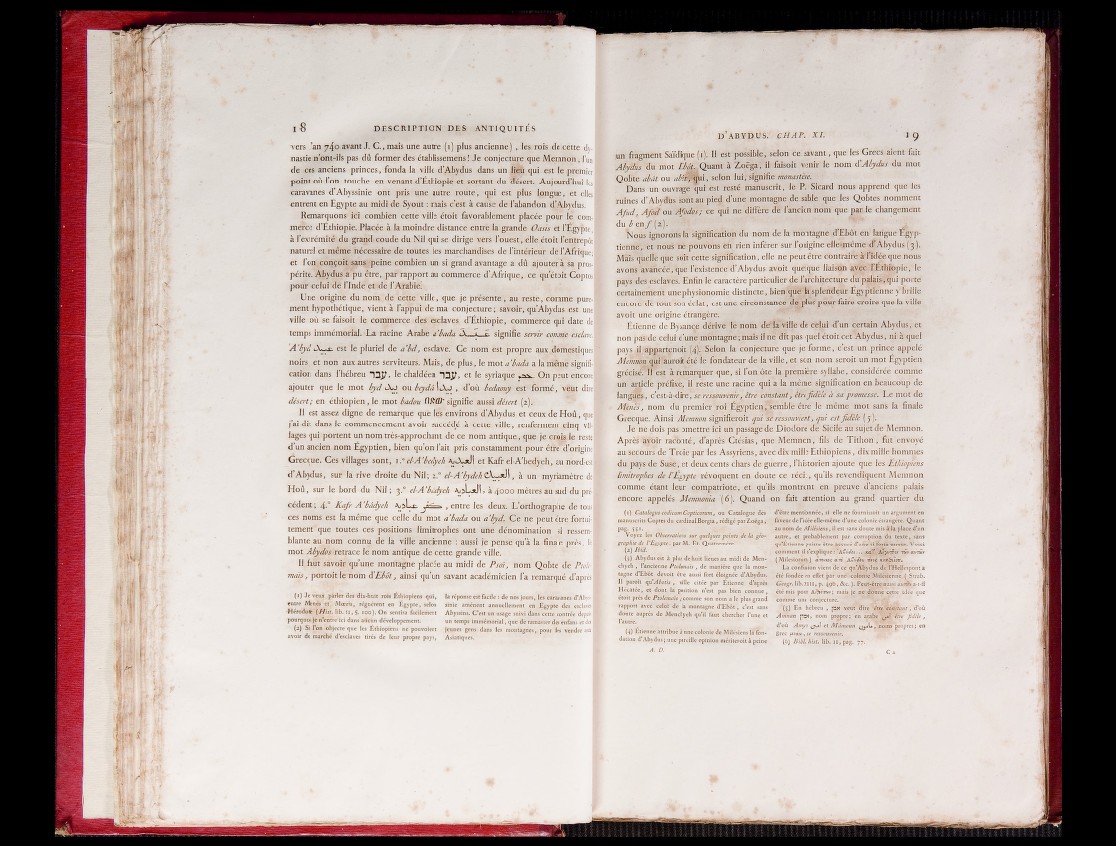
vers l’an 740 avant J. C., mais une autre (1) plus ancienne) , les rois de cette dy- 1
nastie n’ont-ils pas dû former des établissemens ! Je conjecture que Memnon , l'u n I
de ces anciens princes, fonda la ville d’Abydus dans un lieu qui est le premier I
point où l’on touche en venant d’Ethiopie et sortant du désert. Aujourd’hui les I
caravanes d’Abyssinie ont pris une autre route, qui est plus longue, et ellesI
entrent en Egypte au midi de Syout : mais c’est à cause de l’abandon d’Abydus.
Remarquons ici combien cette ville étoit favorablement placée pour le com-B
merce d’Ethiopie. Placée à la moindre distance entre la grande Oasis et l’Egypte, I
à l’extrémité du grand coude du Nil qui se dirige vers l’ouest, elle étoit l'entrepôt■
naturel et même nécessaire de toutes les marchandises de l’intérieur de l’Afrique;*
et l’on conçoit sans peine combien un si grand avantage a dû ajouter à sa pros-B
périté. Abydus a pu être, par rapport au commerce d’Afrique, ce qù'étoit CoptosB
pour celui de l’Inde et de l’Arabie.
Une origine du nom de cette ville, que je présente, au reste, comme pure-B
ment hypothétique, vient à l’appui de ma conjecture; savoir, qu’Abydus est uneB
ville où se faisoit le commerce des esclaves d’Ethiopie, commerce qui date dcB
temps immémorial.'Ea racine Arabe a bada l\ k. r. signifie servir comme esclave
A ’byd est le pluriel de a'bd, esclave. Ce nom est propre aux domestiquesB
noirs, et non aux autres serviteurs. Mais, de plus, le mot a bada a la même signifi-H
cation dans l’hébreu P p le chaldéen -DJE et le syriaque On peut encoreB
ajouter que le mot byd iX j ou beydâ ItXo , d’où beduouy est formé, veut direB
désert; en éthiopien, le mot badou AMP signifie aussi désert (a).
Il est assez digne de remarque que les environs d’Abydus et ceux de Hoû, que
j’ai dit dans le commencement avoir succédé à cette ville, renferment cinq vil-H
lages qui portent un nom très-approchant de ce nom antique, que je crois le resteB
d’un ancien nom Egyptien, bien qu’on l’ait pris constamment pour être d’origine«
Grecque. Ces villages sont, \.° el-A’bedyeh AjJçjJ! et Kafr el-A’bedyeh, au nord-estB
d Abydus, sur la rive droite du Nil; 2.0 el-A ’/ydeh CX-^xll, à un myriamètre de
Hoû, sur le bord du N il; 3.0 el-A’bâdyeh A sL x tl, à 4000 mètres au sud du pré-B
cèdent; 4 -° Kafr A ’bâdyeh A i L t > entre k s deux. L ’orthographe de to u il
ces noms est la même que celle du mot a’bada ou a byd. Ce ne peut être fortui-B
tement que toutes ces positions limitrophes ont une dénomination si ressemblante
au nom connu de la ville ancienne : aussi je pense qu’à la finale près, le
mot A/ydos retrace le nom antique de cette grande ville.
Il faut savoir qu’une montagne placée au midi de Pso'i, nom Qobte de Pto!t\
mais, portoitle nom SEbôt, ainsi qu’un savant académicien l’a remarqué d’après
( 1 ) J e v eu x pa r le r d es d ix -h u it rois É th iop ien s qui,, la réponse est fa c ile : d e nos jo u rs , les ca ravan es d ’Abys-
en tre M e n é s e t M oe r is , régnè rent en E g y p t e , selon sinie amènent an n u e llem en t en E g y p te des esclaves
•H érodo te (H i s t . lib . n , §. 10 0 ) . O n sentira facilement A b y s s in s . C ’est un usage su iv i dans c ette con tré e depuis
p o u rq u o i je n'entre ic i dans aucun d év elo ppemen t. un temps im m ém o r ia l, q u e d e ramasser des enfans et des
(2) S i l ’o n o b je c te qu e les É th iop ien s ne po u vo ien t jeunes gens dans les m o n ta gn e s , p o u r les v en d re aux
a v o ir d e ma rch e d’esclav es tirés d e leu r propre p a y s , A s ia tiq u e s .
d ’ a b y d u s : c h a p . x i . * 9
un fragment Saïdicjue (i). II est possible, selon ce savant, que les Grecs aient fait
Abydus du mot Ebat. Quant à Zoëga, il faisoit venir le nom d’Abydus du mot
Qobte abât ou abêr, é\\à, selon lui. signifie monastère.
Dans un ouvrage qui est reste manuscrit, le P. Sicard nous apprend que les
ruines d’ Abydùs sont au pied d’une montagne de sable que les Qobtes nomment
Afud, Afod ou Afodos; ce qui ne diffère de l’ancien nom que par le changement
du b t n f (2). '
Nous ignorons la signification du nom de la montagne d’Ebôt en langue Égyptienne,
et nous ne pouvons èli rien inférer sur l’origine elle-même d’Abydus (3 ).
Mais quelle que soit cette signification, elle ne peut être contraire à l’idée que nous
avons avancée, que l’existence d’Abydus avoit quelque liaison avec l’Ethiopie, le
pays des esclaves. Enfin le caractère particulier de l’architecture du palais ¡ qui porte
certainement une physionomie distincte, bien que la splendeur Égyptienne y'brille
encore dè tout son éclat, est une circonstance de plus pour faire croire que la ville
avoit une origine étrangère.
Etienne de Byzance dérive le nom de là ville de celui d’un certain Abydus, et
non pas de celui d’une montagne; mais il ne dit pas quel etoitcet Abydus, ni a quel
pays j l appartenoit (4).. Selon la conjecture que je forme, c’est un prince appelé
Memnon qui auroit été le fondateur de la ville, et son nom seroit un mot Égyptien
grécisé. II‘est à remarquer que, si l’on ôte la première syllabe, considérée comme
un article préfixe, il reste une racine qui a la même signification en beaucoup de
langues, c’est-à-dire, se ressouvenir, être constant, être fidèle à sa promesse. Le mot de
Menés, nom du premier roi ¡Égyptien,';semble être le même mot sans la finale
Grecque. Ainsi Memnon signifieroit qui se ressouvient, qui est fidèle ( y ).
Je ne dois pas omettre ici un passage de Diodore de Sicile au sujet de Memnon.
Après avoir racbnté, d’après Ctésias, que Memnon, fils de Tithon , fut envoyé
au secours de Troie par les Assyriens, avec dix mille Ethiopiens, dix mille hommes
du pays de Suse, et deux cents chars de guerre, l’historien ajoute que les Ethiopiens
limitrophes de l ’Egypte révoquent en doute ce récit, qu’ils revendiquent Memnon
comme étant leur compatriote, et qu’ils montrent en preuve d’anciens palais
encore appelés Memnonia (6). Quand on fait attention au grand quartier du
(1) Catalogas codicum Copticorum, ou Catalogue des
manuscrits Coptes du cardinal Borgia, rédigé par Zoëga,
Pag- 5 S1 -
Voyez les Observations sur quelques points de lagéographie
de l'Egypte, par M. Ét. Quatremère.
(2) Ibïd.
(3) Abydus est à plus de huit lieues au midi de Men-
cliyeh , l’ancienne Ptolemais, de manière que la montagne
d’Ebot devoit être aussi fort éloignée d’Abydus.
II paroit qu’Abotis, ville citée par Etienne d’après
Hecatée, et dont la position n’est pas bien connue,
étoit près de Ptolemais ; comme son nom a le plus grand
rapport avec celui de la montagne d’E bô t, c’est sans
doute auprès de Menchyeh qu’il faut chercher l’une et
l’autre.
(4) Etienne attribue à une colonie de Milésiens la fondation
d’Abydus ; une pareille opinion mériteroit à peine
A. D.
d’être mentionnée, si elle ne fournissoit un argument en
faveur de l’idée elle-même d’une colonie étrangère. Quant
au nom de Aiilésiens, il est sans doute mis à la place d’un
autre, et probablement par corruption du texte, sans
qu’Etienne puisse être accusé d’une si forte erreur. Voici
comment il s’explique: ’ACvJbi... xa.4*- Aiyjiilov miv avmv
(Milesiorum) dmixoç à-n [ASv/bv 7ivoç x\iiSi7m.
La confusion vient de ce qu’Âbydus de l ’HelIespont a
été fondée en effet par une ' colonie Milésienne ( Strab.
Geogr. lib.XIil, p. 490, &c. ). Peut-être aussi a.ù.ytJv a-t-il
été mis pour Aijtonor; mais, je ne donne cette idée que
comme une conjecture. . *
(5) En hébreu , p x veut dire être constant, d’où.
Amnan ¡TON, nom propre; en arabe "être f id è le ,
d’où Amyn ^jyl et Alâmoun , noms propres; en
grec fiYeta, se ressouvenir.
(6) Bibl, hist, lib. 11, pag. 77.
C x