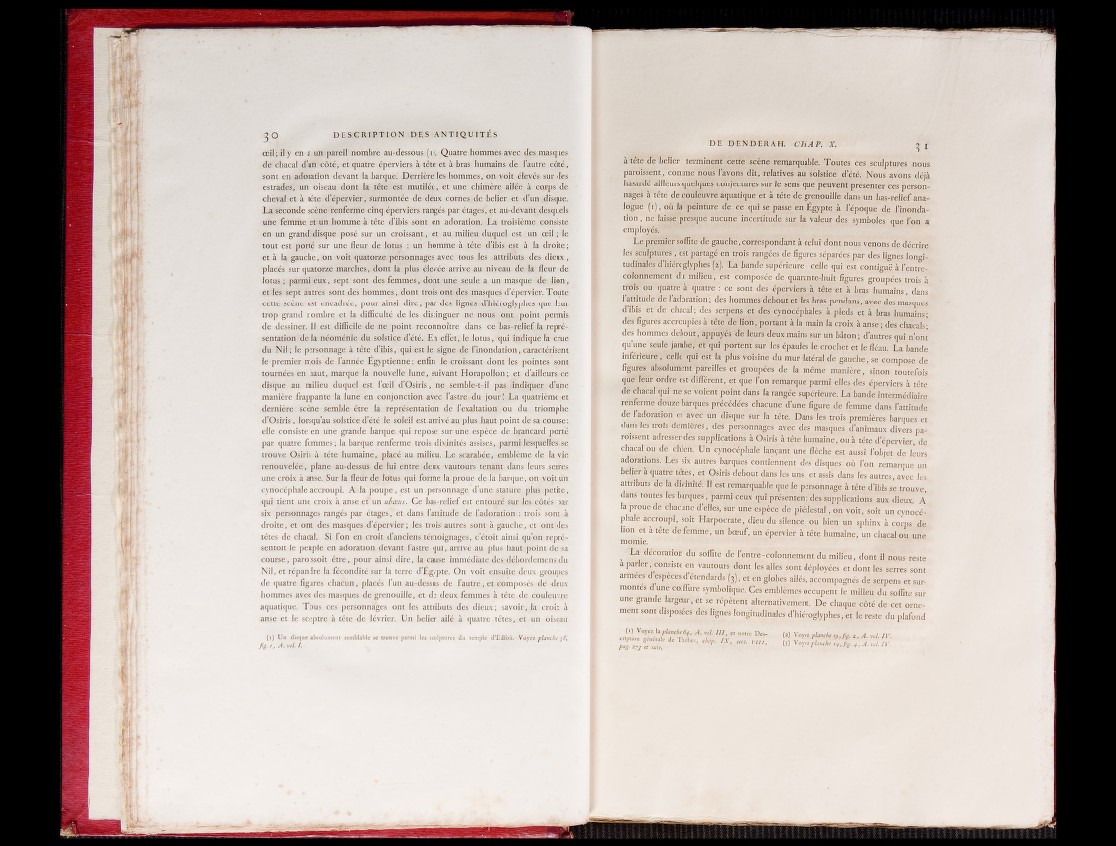
ceil ; il y en a un pareil nombre au-dessous (i). Quatre hommes avec des masques
de chacal d’un côté; et quatre éperviers à tête et à bras humains de l’autre côté,
sont en adoration devant la barque. Derrière les hommes, on voit élevés sur des
estrades, un oiseau dont la tête est mutilée, et une chimère ailée à corps de
cheval et à tête d’épervier, surmontée de deux cornes de belier et d’un disque.
La seconde scène renferme cinq éperviers rangés par étages, et au-devant desquels
une femme et un homme à tête d’ibis sont en adoration. La troisième consiste
en un grand disque posé sur un croissant, et au milieu duquel est un ceil ; Je
tout est porté sur une fleur de lotus : un homme à tête d’ibis est à la droite ;
et à la gauche, on voit quatorze personnages avec tous les attributs des dieux ,
placés sur quatorze marches, dont la plus élevée arrive au niveau de la fleur de
lotus ; parmi eux, sept sont des femmes, dont une seule a un masque de lion,
et les sept autres sont des hommes, dont trois ont des masques d’épervier. Toute
cette scène est encadrée, pour ainsi dire, par des lignes d’hiéroglyphes que leur
trop grand nombre et la difficulté de les distinguer ne nous ont point permis
de dessiner. 11 est difficile de ne point reconnoître dans ce bas-relief la représentation
de la néoménie du solstice d’été. En effet, le lotus, qui indique la crue
du Nil; le personnage à tête d’ibis, qui est le signe de l’inondation, caractérisent
le premier mois de l’année Egyptienne; enfin le croissant dont les pointes sont
tournées en haut, marque la nouvelle lune, suivant Horapollon; et d’ailleurs ce
disque au milieu duquel est l’oeil d’O siris, ne semble-t-il pas indiquer d’une
manière frappante la lune en conjonction avec l’astre du jouri La quatrième et
dernière scène semble être la représentation de l’exaltation ou du triomphe
d’Osiris, lorsqu’au solstice d’été le soleil est arrivé au plus haut point de sa course ;
elle consiste en une grande barque qui repose sur une espèce de brancard porté
par quatre femmes; la barque renferme trois divinités assises, parmi lesquelles se
trouve Osiris à tête humaine, placé au milieu. Le scarabée, emblème de la vie
renouvelée, plane au-dessus de lui entre deux vautours tenant dans leurs serres
une croix à anse. Sur la fleur de lotus qui forme la proue de la barque, on voit un
cynocéphale accroupi. A la poupe, est un personnage d’une .stature plus petite,
qui tient une croix à anse et un uboeus. Ce bas-relief est entouré sur les côtés par
six personnages rangés par étages, et dans l’attitude de l’adoration : trois sont à
droite, et ont des masques d’épervier; les trois'autres sont à gauche, et ont des
têtes de chacal. Si l’on en croit d’anciens témoignages, c’étoit ainsi qu’on repré-
sentoit le peuple en adoration devant l’astre qui, arrivé au plus haut point de sa
course, paroissoit être, pour ainsi dire, la cause immédiate des débordemens du
Nil, et répandre la fécondité sur la terre d’Egypte. On voit ensuite deux groupes
de quatre figures chacun, placés l’un au-dessus de l’autre, et composés de deux
hommes avec des masques de grenouille, et de deux femmes à tête de couleuvre
aquatique. Tous ces personnages ont les attributs des dieux; savoir, la croix à
anse et le sceptre à tête de lévrier. Un belier ailé à quatre têtes, et un oiseau
(i) Un disque absolument semblable se trouve parmi les sculptures du temple d’Edfoû. Voyez planche jS,
fig. i j A . vol. I.
D E D E N D E R A H , C H A P . X . o i 1 1
à tête de belier, terminent cette scène remarquable. Toutes ces sculptures nous
paroissent, comme nous l’avons dit, relatives au solstice d’été. Nous avons déjà
hasardé ailleurs quelques conjectures sur le sens que peuvent présenter ces personnages
à tête de couleuvre aquatique et à tête de grenouille dans un bas-relief analogue
(i), où la peinture de ce qui se passe en Égypte à l’époque de l’inondation
, ne laisse presque aucune incertitude sur la valeur des symboles que l’on a
employés.
Le premier soffite de gauche, correspondant à celui dont nous venons de décrire
les sculptures , est partagé en trois rangées de figures séparées par des lignes longitudinales
d’hiéroglyphes (i). La bande supérieure, celle qui est contiguë à l’entre-
colonnement du milieu, est composée de quarante-huit figures groupées trois à
trois ou quatre à quatre : ce sont des éperviers à tête et à bras humains, dans
l’attitude de l’adoration; des hommes debout et les bras pendans, avec des masques
d’ibis et de chacal; des serpens et des cynocéphales à pieds et à bras humains;
des figures accroupies à tête de lion, portant à la main la croix à anse ; des chacals'
des hommes debout, appuyés de leurs deux mains sur un bâton; d’autres qui n’ont
qu’une seule jambe, et qui portent sur les épaules le crochet et le fléau. La bande
inférieure, celle qui est la plus voisine du mur latéral de gauche, se compose de
figures absolument pareilles et groupées de la même manière, sinon toutefois
que leur ordre est différent, et que l’on remarque panni elles des éperviers à tête
de chacal qui ne se voient point dans la rangée supérieure. La bande intermédiaire
renferme douze barques précédées chacune d’une figure de femme dans l’attitude
de I adoration et avec un disque sur la tête. Dans les trois premières barques et
dans les trois dernières, des personnages avec des masques d’animaux divers pa^
roîssent adresser des supplications à Osiris à tête humaine, ou à tête d’épervier, de
chacal ou de chien. Un cynocéphale lançant une flèche est aussi l’objet de leurs
adorations. Les six autres barques contiennent des disques où l’on remarque un
belier a quatre têtes, et Osiris debout dans les uns, et assis dans les autres, avec les
attributs de la divinité. Il est remarquable que le personnage à tête d’ibis se trouve,
dans toutes les barques, parmi ceux qui présentent des supplications aux dieux. A
la proue de chacune d elles, sur une espèce de piédestal, on voit, soit un cynocéphale
accroupi, soit Harpocrate, dieu du silence, ou bien un sphinx à corps de
lion et à tête de femme, un boeuf, un épervier à tête humaine, un chacal ou une
momie.
^ La décoration du soffite de l’entre-colonnement du milieu, dont il nous reste
a parler, consiste en vautours dont les ailes sont déployées et dont les serres sont
armées d espèces d’étendards (3), et en globes ailés, accompagnés de serpens et surmontes
dune coiffure symbolique. Ces emblèmes occupent le milieu du soffite sur
une grande largeur, et se répètent alternativement. De chaque côté de cet ornement
sont disposées des lignes longitudinales d’hiéroglyphes, et le reste du plafond
( 0 Voyez \a planche t+, A . vol. I I I , « notre Des- (z) Voyez planche ,o ,fy . a , A . vol. IV .
cnpuon générale de Thèbes, Cap. IX , sec. v u s , 3 Vo ez planche % % ¡ A. IV .
pag. 2 7 J et suiv, + > j 0