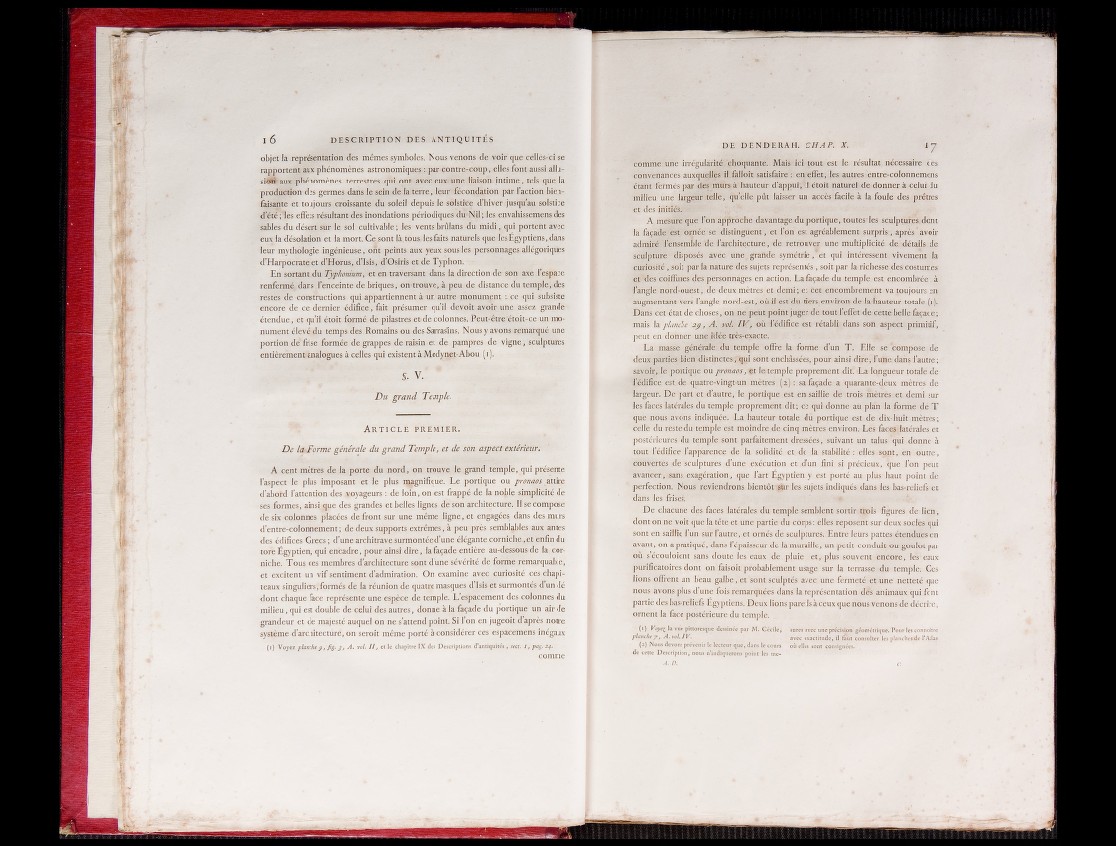
objet la représentation des mêmes symboles. Nous venons de voir que celles-ci se
rapportent aux phénomènes astronomiques : par contre-coup, elles font aussi allusion!
aux phénomènes terrestres qui ont avec eux une liaison intime, tels que la
production des germes dans le sein de la terre, leur fécondation par l’action bienfaisante
et toujours croissante du soleil depuis le solstice d’hiver jusqu’au solstice
d été; les effets résultant des inondations périodiques du Nil; les envahissemensdes
sables du désert sur le sol cultivable ; les vents brûlans du midi, qui portent avec
eux la désolation et la mort. Ce sont là.tous les faits naturels que les Egyptiens, dans
leur mythologie ingénieuse, ont peints aux yeux sous les personnages allégoriques
d’Harpocrate et d’Horus, d’Isis, d’Osiris et de Typhon.—
En sortant du Typlionitim, et en traversant dans la direction de son axè l’espace
renfermé dans l’enceinte de briques, on trouve, à peu de distance du temple, des
restes de constructions qui appartiennent à un autre monument ce qui subsiste
encore de ce dernier édifice, fait présumer qu’il devoit avoir une assez grande
étendue, et qu’il étoit formé de pilastres et de colonnes. Peut-être étoit-ce un monument
élevé du temps des Romains ou des Sarrasins, Nousy avons remarqué une
portion de frise formée de grappes de raisin et de pampres de vigne, sculptures
entièrement analogues à celles qui existent à Medynet-Abou ( i ).
s. v.
D u grand Temple.
A r t i c l e p r e m i e r .
D e la Forme générale du grand Temple, et de son aspect extérieur.
A cent mètres de la porte du nord, on trouve le grand temple, qui présente
l’aspect le plus imposant et le plus nyagnifique. Le portique ou pronaos attire
d’abord l’attention des voyageurs : de loin, on est frappé de la noble simplicité de
ses formes, ainsi que des grandes et belles lignes de son architecture. Il se compose
de six colonnes placées de front sur une même ligne, et engagées dans des murs
d’entre-colonnement ; de deux supports extrêmes, à peu près semblables aux antes
des édifices Grecs ; d’une architrave surmontée d’une élégante corniche ,et enfin du
tore Égyptien, qui encadre, pour ainsi dire, la façade entière au-dessous de la corniche.
Tous ces membres d’architecture sont d’une sévérité de forme remarquable,
et excitent un v if sentiment d’admiration. On examine avec curiosité ces chapiteaux
singuliers, formés de la réunion de quatre masques d’Isis et surmontés dundé
dont chaque face représente une espèce de temple. L ’espacement des colonnes du
milieu, qui est double de celui des autres, donne à la façade du portique un air de
grandeur et de majesté auquel on ne s’attend point. Si l’on en jugeoit d après notre
système d’architecture, on seroit même porté à considérer ces espacemens inégaux
(i) Voyez planche p , fîg. A . vol. 11, et le chapitre IX des Descriptions d’antiquités , sec(. i , pcig. 2jf..
comme
D E D E N D E R A H . C H A P . X . i n/
comme une irrégularité choquante. Mais ici tout est le résultat nécessaire des
convenances auxquelles il falloir satisfaire : en effet, les autres entre-colonnemens
étant fermés par des murs à hauteur d’appui, il étoit naturel de donner à celui du
milieu une largeur telle, qu’elle pût laisser un accès facile à la foule des prêtres
et des initiés.- -
A mesure que l’on approche davantage du portique, toutes les sculptures dont
la façade est ornée se distinguent, et l’on est agréablement surpris, après avoir
admiré l’ensemble de l’architecture, de retrouver une multiplicité de détails de
sculpture disposés avec une grande symétrie , et qui intéressent vivement la
curiosité, soit par la nature des sujets représentés, soit par la richesse des costumes
et des coiffures des personnages en action. La façade du temple est encombrée, à
l’angle nord-ouest, de deux mètres et demi; et cet encombrement va toujours en
augmentant vers l’angle, nord-est, où il est du tiers environ de la hauteur totale ( i ).
Dans cet état de choses, on ne peut point juger de tout l’effet de cette belle façade;
mais la planche 2 p , A . vol. IV , où l’édifice est rétabli dans son aspect primitif,
peut en donner une idée très-exacte.
La masse générale du temple offre la forme d’un T . Elle se compose de
deux parties bien distinctes, qui sont enchâssées, pour ainsi dire, l’une dans l’autre ;
savoir, le portique ou pronaos, et le temple proprement dit. La longueur totale de
l’édifice est.de quatre-vingt-un mètres . (2) : sa façade a quarante-deux mètres de
largeur. De part et d’autre, le portique est en saillie de trois mètres et demi sur
les faces latérales du temple proprement dit; ce qui donne au plan la forme de T
que nous avons indiquée. La hauteur totale du portique est de dix-huit mètres;
celle du reste du temple est moindre de cinq mètres environ. Les faces latérales et
postérieures du temple sont parfaitement dressées, suivant un talus qui donne à
tout l’édifice l’apparence de la solidité et de la stabilité : elles sont, en outre,
couvertes de sculptures d’une exécution et d’un fini si précieux, que l’on peut
avancer, sans exagération, que l’art Égyptien y est porté au plus haut point de
perfection. Nous reviendrons bientôt sur les sujets indiqués dans les bas-reliefs et
dans les frises.
De chacune des faces latérales du temple semblent sortir trois figures de lion,
dont on ne voit que la tête et une partie du corps: elles reposent sur deux soclès qui
sont en saillie l’un sur l’autre, et ornés de sculptures. Entre leurs pattes étendues en
avant, on a pratiqué, dans l’épaisseur de la muraille, un petit conduit ou goulot par
où s’écouloient sans doute les eaux de pluie, et, plus souvent encore, les eaux
purificatoires dont on faisoit probablement usage sur la terrasse du temple: Ces
lions offrent un beau galbe, et sont sculptés avec une fermeté et une netteté que
nous avons plus d une fois remarquées dans la représentation dés animaux qui font
partiè des bas-reliefs Égyptiens. Deux lions pareils à ceux que nous venons de décrire,
ornent la face postérieure du temple.
■ (1) Voyez vue pittoresque dessinée par M. Cécile, sures avec une précision géométrique. Pour les connoître
planche y , A. vol. JV. avec exactitude, il faut consulter les planches de l’Atlas
(-) Nous devons prévenir le lecteur que, dans le cours où elles .sont consignées,
de cette Description, nous n’indiquerons point les me