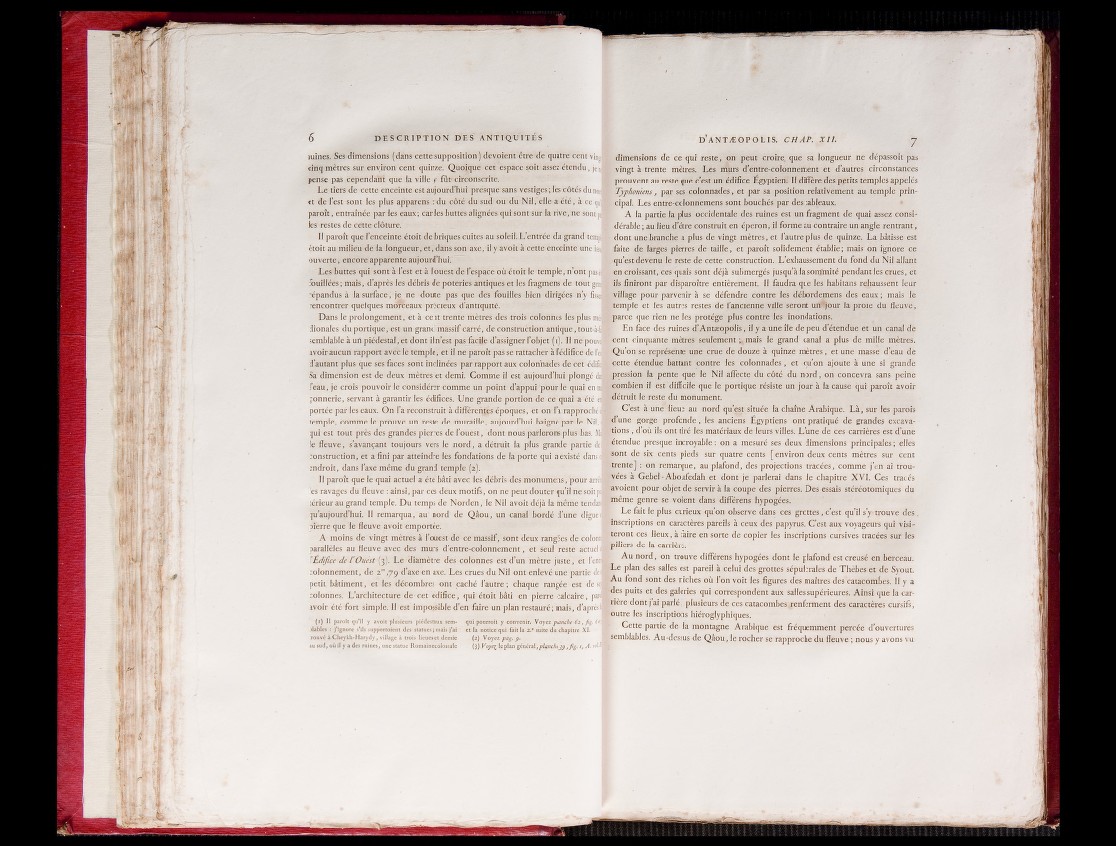
ruines. Ses dimensions (dans cette supposition) devoient etre de quatre cent v in ! dimensions de ce qui reste, on peut croire, que sa longueur ne dépassoit pas
cinq métrés sur environ cent quinze. Quoique cet espace soit assez etendu, je J vingt à trente mètres. Les murs d’entre-colonnement et d’autres circonstances
pense pas cependant que la ville y fût? circonscrite. prouvent au reste que c’est un édifice Égyptien. Il diffère des petits temples appelés
Le tiers de cette enceinte est aujourd’hui presque sans vestiges ; les côtés du nor! Typlioniens, par ses colonnades, et par sa position relativement au temple prin-
et de l’est sont les plus apparens : du côté du sud ou du Nil, elle a été, à ce qu’* , cipal. Les entre-colonnemens sont bouchés par des tableaux,
paroît, entraînée par les eaux; car les buttes alignées qui sont sur la rive, ne sont ptH A la partie la plus occidentale des ruines est un fragment de quai assez consi-
les restes de cette clôture. dérable ; au lieu d’être construit en éperon, il forme au contraire un angle rentrant,
Il paroît que l’enceinte étoit de briques cuites au soleil. L’entrée du grand teinn! dont une branche a plus de vingt mètres, et l’autre plus de quinze. La bâtisse est
étoit au milieu de la longueur, et, dans son axe, il y avoit à cette enceinte une issifl faite de larges pierres de taille, et paroît solidement établie ; mais on ignore ce
ouverte, encore apparente aujourd’hui. qu’est devenu le reste de cette construction. L ’exhaussement du fond du Nil allant
Les buttes qui sont à l’est et à l’ouest de l’espace où étoit le temple, n’ont pastlS en croissant, ces quais sont déjà submergés jusqu’à la sorn'mité pendantles crues, et
fouillées; mais, d’après les débris de poteries antiques et les fragmens de tout geiufl ils finiront par disparoître entièrement. Il faudra que les habitans rehaussent leur
répandus à la surface, je ne doute pas que des fouilles bien dirigées n’y fisse! village pour parvenir à se défendre contre les débordemens des eaux ; mais le
rencontrer quelques morceaux précieux d’antiquité. temple et les autres restes de l’ancienne ville seront un®jour la proie du fleuve,
Dans le prolongement, et à cent trente mètres des trois colonnes les plus me! parce que rien ne les protège plus contre les inondations,
dionales du portique, est un grand massif carré, de construction antique, tout-à-i^B En face des ruines d’Antæopolis, il y a une île de peu d étendue et un canal de
semblable à urt piédestal,« dont il n’est pas facile d’assigner l’objet (t). Il ne pouv! cent cinquante mètres seulement ;, mais le grand canal a plus de mille mètres,
avoir aucun rapport avec le temple, et il ne paroît passe rattacher à l’édifice deTel Qu’on se représente une crue de douze à quinze mètres, et une masse d’eau de
d’autant plus que ses faces sont inclinées par rapport aux colonnades de cet édifil cette étendue battant contre les colonnades, et qu’on ajoute à une si grande
Sa dimension est de deux mètres et demi. Comme il est aujourd’hui plongé iÆ pression la pente que le Nil affecte du côté du nord, on concevra sans peine
l’eau, je crois pouvoir le considérer comme un point d’appui pour le quai en 1 ! combien il est difficile que le portique résiste un jour à la cause qui paroît avoir
çonnerie, servant à garantir les édifices. Une grande portion de ce quai a été a^wlctruit le reste du monument.
portée par les eaux. On l’a reconstruit à différentes époques, et on l’a rapproche G est a une lieue au nord qu est située la chaîne Arabique. L à, sur les parois
temple, comme le prouve un reste de muraille, aujourd’hui baigné par le Nil,t ùune gorge profonde, les anciens Égyptiens ont pratiqué de grandes excavaqui
est tout près des grandes pierres de l’ouest, dont nous parlerons plus bas. Ma lions, d où ils ont tiré les matériaux de leurs villes. L une de ces carrières est d une
le fleuve, s’avançant toujours vers le nord, a détruit la plus grande partie d e l étendue presque incroyable: on a mesure ses deux dimensions principales; elles
construction, et a fini par atteindre les fondations de la porte qui a existé d a n s ! ”50111 s*x cents pieds sur quatre cents [environ deux cents métrés sur cent
endroit, dans l’axe même du grand temple (2). trente] : on remarque, au plafond, des projections tracées, comme j en ai trou-
II paroît que le quai actuel a été bâti avec les débris des monumens, pour arréiWvees a Gebel-Aboufedah et dont je parlerai dans le chapitre XVI. Ces tracés
les ravages du fleuve : ainsi, par ces deux motifs, on ne peut douter qu’il ne soit pc avoient pour objet de servir à la coupe des pierres. Des essais stéréotomiques du
térieur au grand temple. Du temps de Norden, le Nil avoit déjà la même tendait! meme genre se voient dans différens hypogées.
qu’aujourd’hui. Il remarqua, au nord de Qâou, un canal bordé d’une digue t B , Le fait le plus curieux quon observe dans ces grottes,cest qui lsy trouve des.
pierre que le fleuve avoit emportée. inscriptions en caractères pareils à ceux des papyrus. C’est aux voyageurs qui visi-
A moins de vingt mètres à l’ouest de ce massif, sont deux rangées de colonnB|grotlt; ces ^eux >a ^a' re en sorte de copier les inscriptions cursives tracées sur les
parallèles au fleuve avec des murs d’entre-colonnement, et seul reste a c t u e l ^ a carT*ère.
XÉdifice de l'Ouest (3). Le diamètre des colonnes est d’un mètre juste, et l’enn^B u nor(É on trouse différens hypogées dont le plafond est creuse en berceau,
colonnement, de 2“ ,79 d’axe en axe. Les crues du Nil ont enlevé une partie ée(BÉ‘e P^an ^es sa^es e[t Pare^ a ceùii des grottes sépulcrales de Thèbes et de Syout.
petiL bâtiment, et les décombres ont caché l’autre ; chaque rangée est de sffi U sont ^es n*^ies ou ^on vo’t ^es % lues des maîtres des catacombes. II y a
colonnes. L ’architecture de cet édifice, qui étoit bâti en pierre calcaire, partSpS Pa*ts e[ ^es galeries qui correspondent aux salles supérieures. Ainsi que la car-
avoir été fort simple. Il est impossible d’en faire un plan restauré; mais, d’aprèsijfg elC ontÎ ai parié, plusieurs de ces catacombes ¡renferment des caractères cursifs,
outre les inscriptions hiéroglyphiques.
(1) Il paroît qu’il y avoit plusieurs piédestaux sem- qui pourrait y convenir. Voyez planche 62, fig. Ha;. p t . a l * r / >
blables : j’ignore s’ils supportoient des statues; maïs j’ai et la notice qui fait la 2/suite du chapitre XI. M ^ Partie ^ Ia mOIltagne Arabique est fréquemment percee d Ouvertures
trouvé à Cheykh-Harydy, village à trois lieues et demie (2) Voyez fig.). ¿[semblables. Au-dessus de Qâou, le rocher se rapproche du fleuve ; nous y avons vu
au sud, où il y a des ruines, une statue Romaine colossale (3) Voye^ le plan général, p la n c h e jy ,fig> h A- vü/sUm - '