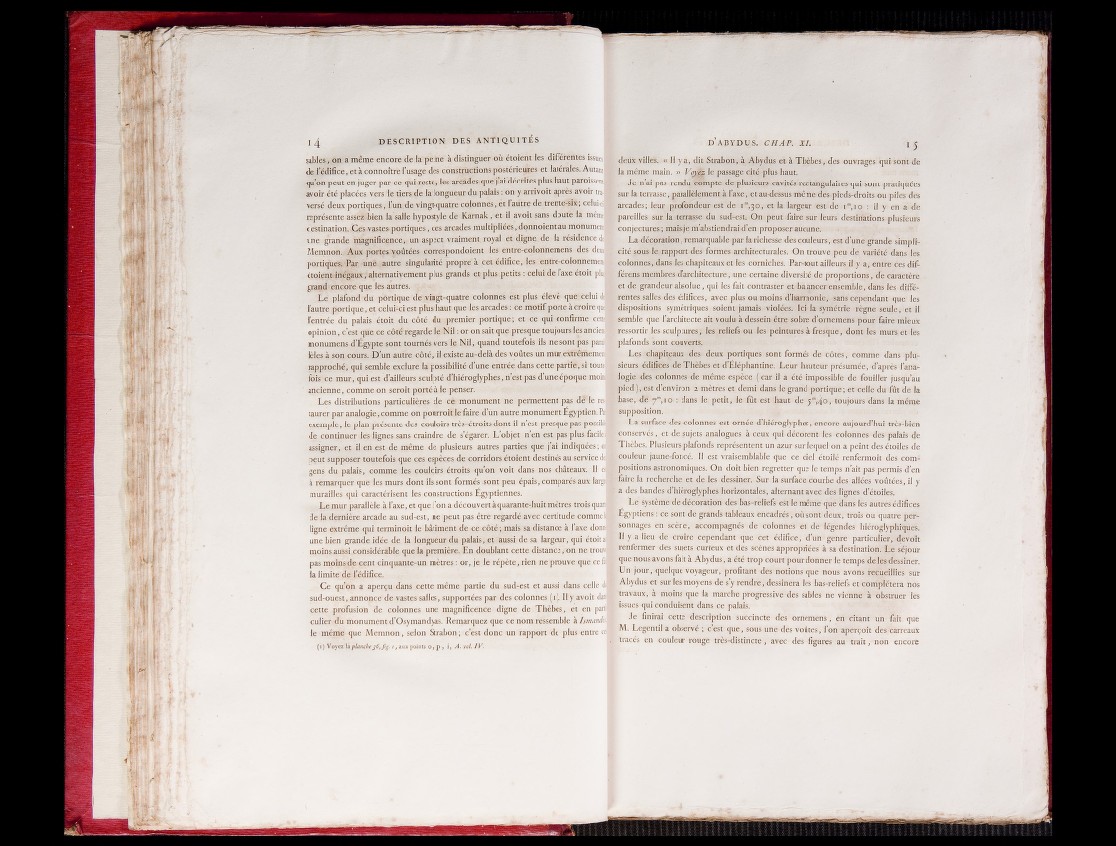
sables, on a même encore de la peine à distinguer ou etoient les différentes issues I
de l’édifice, et à connoître l’usage des constructions postérieures et latérales. Autant!
qu’on peut en juger par ce qui reste, les arcades que j ai décrites plus haut paroissentl
avoir été placées vers le tiers de la longueur du palais : on y arrivoit après avoir tra-l
versé deux portiques, l’un de vingt-quatre colonnes, et 1 autre de trente-six; celui-dl
représente assez bien la salle hypostyle de Karnak, et il avoit sans doute la meniej
destination. Ces vastes portiques, ces arcades multipliées, donnoient au monument!
une grande magnificence, un aspect vraiment royal et digne de la résidence de!
Memnon. Aux portes voûtées correspondoient les entre-colonnemens des demi
portiques. Par une autre singularité propre a cet édifice, les entre-colonnemeni|
étoient inégaux, alternativement plus grands et plus petits : celui de 1 axe etoit pluJ
grand encore que les autres.
Le plafond du portique de vingt-quatre colonnes est plus élevé que celui tli
l’autre portique, et celui-ci est plus haut que les arcades : ce motif porte a croire quel
l’entrée du palais étoit du côté du premier portique; et ce qui confirme cetttl
opinion, c’est que ce côté regarde le Nil : or on sait que presque toujours les anciens!
monumens d’Égypte sont tournés vers le Nil, quand toutefois ils ne sont pas parai
lèles à son cours. D ’un autre côté, il existe au-delà des voûtes un mur extrêmemenif
rapproché, qui semble exclure la possibilité d’une entrée dans cette partie, si toute!
fois ce mur, qui est d’aillèurs sculpté d’hiéroglyphes, n est pas d une epoque moini.j
ancienne, comme on seroit porté à le penser.
Les distributions particulières de ce monument ne permettent pas dé le res-l
taurer par analogie, comme on pourroit le faire d’un autre monument Egyptien. Pat j
exemple, le plan présente des couloirs très-étroits dont il n est presque pas possitltl
de continuer les lignes sans craindre de s’égarer. L ’objet n’en est pas plus facile!
assigner, et il en est de même de plusieurs autres parties que j’ai indiquées ; ol
peut supposer toutefois que ces espèces de corridors étoient destinés au service de|
gens du palais, comme les couloirs étroits qu’on voit dans nos châteaux. Il esl
à remarquer que les murs dont ils sont formés sont peu épais, comparés aux large!
murailles qui caractérisent les constructions Égyptiennes.
Le mur parallèle à l’axe, et que l’on a découvert à quarante-huit mètres trois quais
de la dernière arcade au sud-est, ne peut pas être regardé avec certitude commeIj
ligne extrême qui terminoit le bâtiment de ce côté ; mais sa distance à l’axe donna
une bien grande idée de la longueur du palais, et aussi de sa largeur, qui étoit a«
moins aussi considérable que la première. En doublant cette distance, on ne troim-
pas moins de cent cinquante-un mètres : or, je le répète, rien ne prouve que ce fil
la limite de l’édifice.
Ce qu’on a aperçu dans cette même partie du sud-est et aussi dans celle il
sud-ouest, annonce de vastes salles, supportées par des colonne^ (i). 11 y avoit d»
cette profusion de colonnes une magnificence digne de Thèbes, et en parti!
culier du monument d’Osymandyas. Remarquez que ce nom ressemble à IsmamtA
le même que Memnon, selon Strabon ; c’est donc un rapport de plus entre cesl
(i) Voyez la planche 3 G, f i g-1, aux points 0, p , i, A . vol. IV .
deux villes. « Il y a, dit Strabon, à Abydus et à Thèbes, des ouvrages qui sont de
la même main. » Ie passage cité plus haut.
Je n’ai pas rendu compte de plusieurs cavités rectangulaires qui sont pratiquées
sur la terrasse, parallèlement à l’axe, et au-dessus même des pieds-droits ou piles des
arcades; leur profondeur est de im,30, et la largeur est de im, 10 : il y en a de
pareilles sur la terrasse du sud-est. On peut faire sur leurs destinations plusieurs
conjectures ; mais je m’abstiendrai d’en proposer aucune.
La décoration, remarquable par la richesse des couleurs, est d’une grande simplicité
sous le rapport des formes architecturales. On trouve peu de variété dans les
colonnes, dans les chapiteaux et les corniches. Par-tout ailleurs il y a, entre ces difi-
férens membres d’architecture, une certaine diversité de proportions, de caractère
et de grandeur absolue, qui les fait contraster et balancer ensemble, dans les différentes
salles des édifices, avec plus ou moins d’harmonie, sans cependant que les
dispositions symétriques soient jamais violées. Ici la symétrie règne seule, et il
semble que l’architecte ait voulu à dessein être sobre d’ornemens pour faire mieux
ressortir les sculptures, les reliefs ou les peintures à fresque, dont les murs et les
plafonds sont couverts.
Les chapiteaux des deux portiques sont formés de côtes, comme dans plusieurs
édifices de Thèbes et d’Éléphantine. Leur hauteur présumée, d’après l’analogie
des colonnes de même espèce ( car il a été impossible de fouiller jusqu’au
pied), est d’environ z mètres et demi dans le grand portique; et celle du fût de la
base, de' 7 " ,io : dans le petit, le fût est haut de y”¡4&, toujours dans la même
supposition.
La surface des colonnes est ornée d’hiéroglyphes, encore aujourd’hui très-bien
conservés, et de sujets analogues à ceux qui décorent les colonnes des palais de
Thèbes. Plusieurs plafonds représentent un azur sur lequel on a peint des étoiles de
couleur jaune-foncé. Il est vraisemblable que ce ciel étoilé renfermoit des compositions
astronomiques. On doit bien regretter que le temps n’ait pas permis d’en
faire la recherche et de les dessiner. Sur la surface courbe des allées voûtées, il y
a des bandes d’hiéroglyphes horizontales, alternant avec des lignes d’étoiles.
Le système de décoration des bas-reliefs est le même que dans les autres édifices
Égyptiens : ce sont de grands tableaux encadrés, où sont deux, trois ou quatre personnages
en scène, accompagnés de colonnes et de légendes hiéroglyphiques.
II y a lieu de croire cependant que cet édifice, d’un genre particulier, devoit
renfermer des sujets curieux et des scènes appropriées à sa destination. Le séjour
que nous avons fait a Abydus, a été trop court pour donner le temps de les dessiner.
Un jour, quelque voyageur, profitant des notions que nous avons recueillies sur
Abydus et sur les moyens de s y rendre, dessinera les bas-reliefs et complétera nos
travaux, a moins que la marche progressive des sables ne vienne à obstruer les
issues qui conduisent dans ce palais.
Je finirai cette, description succincte des ornemens, en citant un fait que
Al. Legentil a observé ; cest que, sous une des voûtes, l’on aperçoit des carreaux
tracés en couleur rouge très-distincte, avec des figures au trait, non encore