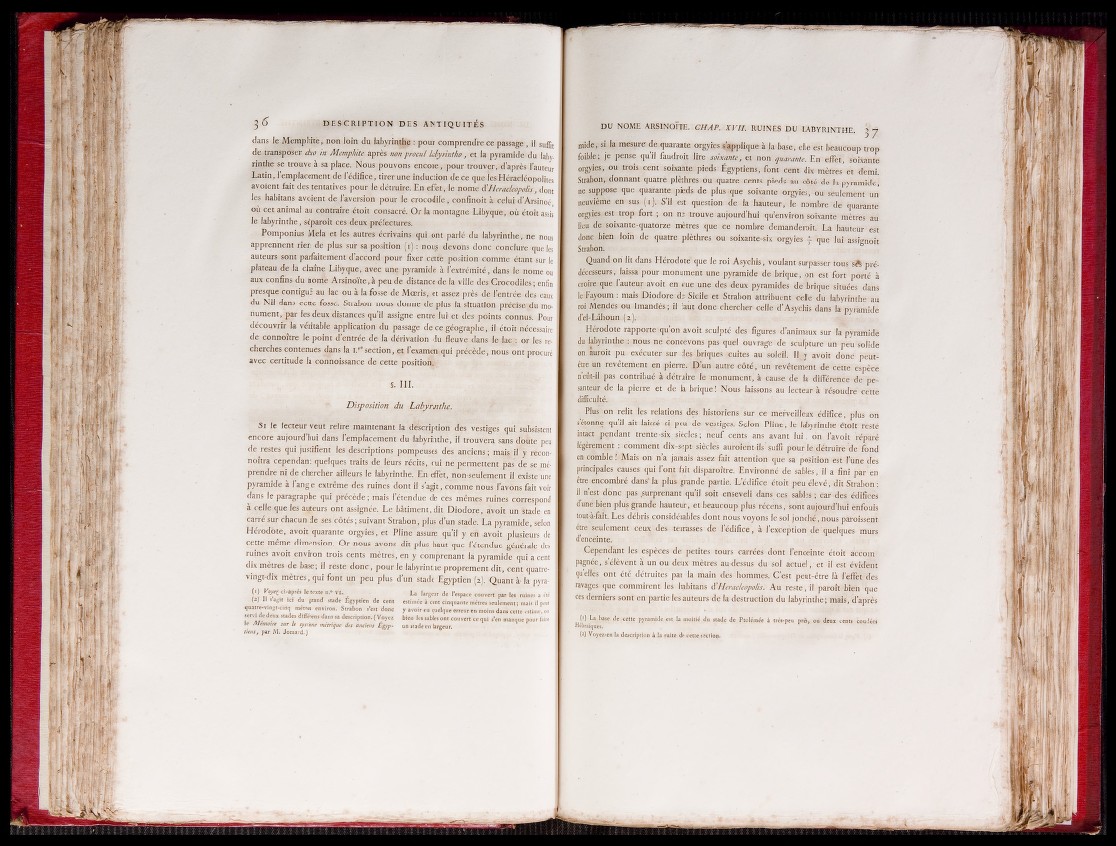
D E S C R I P T IO N D E S A N T IQ U IT É S
dans le Memphité, non loin du labyrinthe : pour comprendre ce passage , il suffit
de transposer duo in Memphitc après non procul labyrinthe, et la pyramide du laby-
rinthe se trouve a sa place. Nous pouvons encore, pour trouver, d’après l’auteur
Latin, 1 emplacement de l’édifice, tirer une induction de ce que lesHéracléopolites
avoient fait des tentatives pour le détruire. En effet, le nome d’Heracleopolis, dont
les habitans avoient de 1 aversion pour le crocodile, confinoit à celui d’Arsinoé
ou cet animal au contraire étoit consacré. Or la montagne Libyque, où étoit assis j
le labyrinthe, séparoit ces deux préfectures.
Pomponius Mêla et les autres écrivains qui ont parlé du labyrinthe, ne nous
apprennent rien de plus sur sa position (r) : nous devons donc conclure que les
auteurs sont parfaitement d accord pour fixer cette position comme étant sur le
plateau de la chaîne Libyque, avec une pyramide à l’extrémité, dans le nome ou
aux confins du nome Arsinoïte, à peu de distance de la ville des Crocodiles; enfin
presque contiguë au lac ou à la fosse de Moeris, et assez près de l’entrée des eaux
du Nil dans cette fosse. Strabon nous donne de plus la situation précise du monument,
par les deux distances qu’il assigne entre lui et des points connus. Pour I
découvrir la véritable application du passage de ce géographe, il étoit nécessaire I
de connoître le point d’entrée de la dérivation du fleuve dans le lac : or les re- I
cherches contenues dans la l.resection, et 1 examen qui précède, nous ont procuré I
avec certitude la connoissance de cette position.
S- III.
Disposition du Labyrinthe.
Si le lecteur veut relire maintenant la description des vestiges qui subsistent
encore aujourdhui dans l’emplacement du labyrinthe, il trouvera sans doute peu
de restes qui justifient les descriptions pompeuses des anciens ; mais il y recon-
noîtra cependant quelques traits de leurs récits, qui ne permettent pas de se mé-
piendre ni de chercher ailleurs le labyrinthe. En effet, non-seulement il existe une
pyramide à l’angle extrême des ruines dont il s’agit, comme nous l’avons fait voir
dans le paragraphe qui précède ; mais l’étendue de ces mêmes ruines correspond
à celle que les auteurs ont assignée. Le bâtiment, dit Diodore, avoit un stade en
carré sur chacun de ses côtés ; suivant Strabon, plus d’un stade. La pyramide, selon
Hérodote, avoit quarante orgyies, et Pline assure qu’il y en avoit plusieurs de
cette meme dimension. Or nous avons dit plus haut que l’étendue générale des
ruines avoit environ trois cents mètres, en y comprenant la pyramide qui a cent
dix métrés de base; il reste donc, pour le labyrinthe proprement dit, cent quatre-
vingt-dix mètres, qui font un peu plus d’un stade Egyptien (2). Quant à- la pyra-
( 1 ) ci-âp rés le te x te n.° VI.,
(2) II s'agit ici du grand stade Égyptien de cent
quatre-vingt-cinq mètres environ. Strabon s’est donc
servi de deux stades differens dans sa description. (Voyez
le Mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens,
par M. Jomard.)
La largeur de l’espace couvert par les ruines a été
estimee à cent cinquante mètres seulement; mais il peut
y avoir eu quelque erreur en moins dans cette estime, ou
bien les sables ont couvert ce qui s’en manque pour faire
un stade en largeur.
DU NOME ARSINOÏTE. C H A P . X V I I . RUINES DU LABYRINTHE. ^ y
mide, si la mesure de quarante orgyies s’applique à la base, elle est beaucoup trop
foible; je pense qu’il faudroit lire soixante, et non quarante. En effet, soixante
orgyies, ou trois cent soixante pieds: Égyptiens, font cent dix mètres'et demi.
Strabon, donnant quatre plèthres ou quatre cents pieds au côté de la pyramide,
ne suppose que quarante pieds de plus que soixante orgyies, ou seulement un
neuvième en sus (i). S’il est question de la hauteur, le nombre de quarante
orgyies est trop fort ; on ne trouve aujourd’hui qu'environ soixante mètres au
lieu de soixante-quatorze mètres que ce nombre demanderoit. La hauteur est
donc bien loin de quatre plèthres ou soixante-six orgyies ~ que lui assignoit
Strabon.
Quand ori lit dans Hérodote que le roi Asychis, voulant surpasser tous sft prédécesseurs,
laissa pour monument une pyramide de brique, on est fort porté à
croire que 1 auteur avoit en vue une des deux pyramides de brique situées dans
le Fayoum : mais Diodore de Sicile et Strabon attribuent celle du labyrinthe au
roi Mendès ou Imandès ; il faut donc chercher celle d’Asychis dans la pvramide
d’ei-Lâhoun (2).
Hérodote rapporte qu’on avoit sculpté des figures d’animaux sur la pyramide
du labyrinthe : nous ne concevons pas quel ouvrage de sculpture un peu solide
on auroit pu exécuter sur des briques cuites au soleil. H y avoit donc peut-
être un revêtement en pierre. D ’un autre côté, un revêtement de cette espèce
n’eût-il pas contribué à détruire le monument, à cause de la différence de pesanteur
de la pieire et de la brique! Nous laissons au lecteur à résoudre cette
difficulté.
Plus on relit les relations des historiens sur ce merveilleux édifice, plus on
s’étonne qu’il ait laissé si peu de vestiges. Sçlon Pline, le labyrinthe étoit'resté
intact pendant trente-six siècles; neuf cents ans avant lui, on l’avoit réparé
légèrement : comment dix-sept- siècles auroient-iJs' suffi pour le détruire de fond
en comble ! Mais on n a jamais assez fait attention que sa position est l’itne des
principales causes qui l’ont fait disparaître. Environné de sables, il a fini par en
être encombré dans- la plus grande partie. L ’édifice étoit peu élevé, dit Strabon:
il n’est donc pas surprenant qu’il soit enseveli dans ces sables ; car des édifices
d’une bien plus grande hauteur, et beaucoup plus récens, sont aujourd’hui enfouis
tout-a-fait. Les débris considérables dont nous voyons le sol jonché, nous paroissent
être seulement ceux des terrasses de l’édifice, à l’exception de quelques murs
d’enceinte.
Cependant les espèces de petites tours carrées dont l’enceinte étoit accom
pagnée, s’élèvent à un ou deux mètres au-dessus du sol actuel, ' et il est évident
qu’elles ont été détruites par la main des hommes. C’est peut-être là l’effet des
ravages que commirent les habitans d Heracleopolis. Au reste, il paroît bien que
ces derniers sont en partie les auteurs de la desmuction du labyrinthe; mais, d’après
(1) La base de cette pyramide est la moitié du stade de Ptolémée à très-peu près, ou deux cents coudées
Hébraïques.
(~) Voyez-en la description à la suite de cette section.