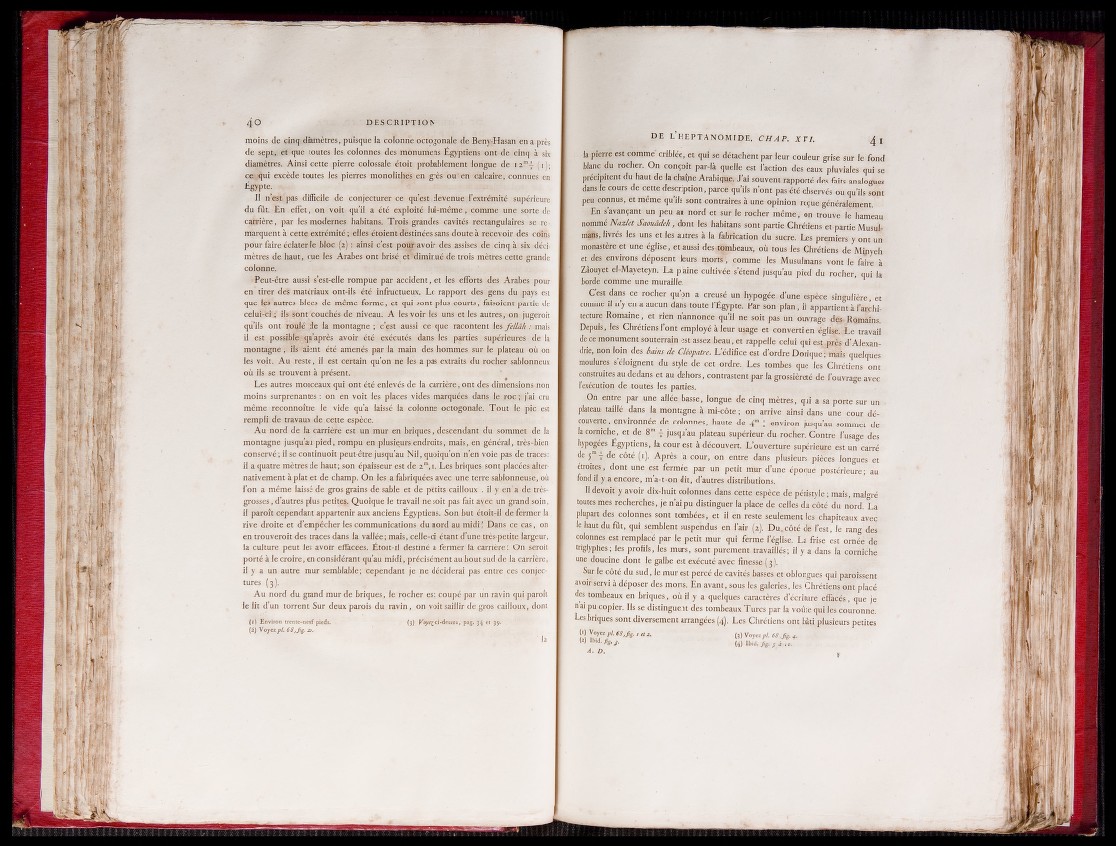
DESCRI PT ION
moins de cinq diamètres, puisque la colonne octogonale de Beny-Hasan en a près
de sept, et que toutes les colonnes des monumens Egyptiens ont de cinq à six
diamètres. Ainsi cette pierre colossale étoit probablement longue de i ?m4- (i);
ce qui excède toutes les pierres monolithes en grès ou en calcaire, connues en
Egypte.
Il n est pas difficile de conjecturer ce qu’est devenue l’extrémité supérieure
du fût. En effet, on voit qu’il a été exploité lui-même, comme une sorte de
carrière, par les modernes habitans. Trois grandes cavités rectangulaires se remarquent
à cette extrémité ; elles étoient destinées sans doute à recevoir des coins
pour faire éclater le bloc (2) : ainsi c’est pour avoir des .assises de cinq à six décimètres
de haut, que les Arabes ont brisé « diminué de trois mètres cette grande
colonne.
Peut-être aussi s’est-elle rompue par accident, et les efforts des Arabes pour
en tirer des matériaux ont-ils été infructueux. Le rapport des gens du pays est
que les autres blocs de même forme, et qui sont plus courts, faisoient partie de
celui-ci; ils sont couchés de niveau. A les voir les uns et les autres, on jugeroit
qu’ils ont roulé de la montagne ; c’est aussi ce que racontent les fcllâh : mais
il est possible qu’après avoir été exécutés dans les parties supérieures de la
montagne ; ils aient été amenés par la main des hommes sur le plateau où on
les voit. Au reste, il est certain qu’on ne les a pas extraits du rocher sablonneux
où ils se trouvent à présent.
Les autres morceaux qui ont été enlevés de la carrière, ont des dimensions non
moins surprenantes : on en voit les places vides marquées dans le roc ; j’ai cru
même reconnoître le vide qu’a laissé la colonne octogonale. Tout le pic est
rempli de travaux de cette espèce.
A u nord de la carrière est un mur en briques, descendant du sommet de la
montagne jusqu’au pied, rompu en plusieurs endroits, mais, en général, très-bien
conservé ; il se continuoit peut-être jusqu’au Nil, quoiqu’on n’en voie pas de traces:
il a quatre mètres de haut; son épaisseur est de zm, 1. Les briques sont placées alternativement
à plat et de champ. On les a fabriquées avec une terre sablonneuse, où
l’on a même laissé de gros grains de sable et de petits cailloux . il y en' a de très-
grosses , d’autres plus petites. Quoique le travail ne soit pas fait avec un grand soin,
il paroît cependant appartenir aux anciens Égyptiens. Son but étoit-il de fermer la
rive droite et d’empêcher les communications du nord au midi Dans ce cas, on
en trouveroit des traces dans la vallée; mais, celle-ci étant d’une très petite largeur,
la culture peut les avoir effacées. Étoit-il destiné à fermer la carrière ! On seroit
porté à le croire, en considérant qu’au midi, précisément au bout sud de la carrière,
il y a un autre mur semblable; cependant je ne déciderai pas entre ces conjectures
(3).
Au nord du grand mur de briques, le rocher est coupé par un ravin qui paroît
le lit d’un torrent. Sur deux parois du ravin, on voit saillir de gros cailloux, dont
(1) Environ trente-neuf pieds. (3) Voye^ ci-dessus, pag. 34 et 39.
(¿) Voyez pl, 68,fig. 20.
I ‘ la
la pierre est comme' criblée, et qui se détachent par leur couleur grise sur le fond
blanc du rocher. On conçoit par-là quelle est l’action des eaux pluviales qui se
précipitent du haut de la chaîne Arabique. J’ai souvent rapporté des faits analogues
dans le cours de cette description, parce qu'ils n’ont pas été observés ou qu’ils sont
peu connus, et même qu’ils sont contraires à une opinion reçue généralement.
En s avançant un peu au nord et sur le rocher même, on trouve le hameau
nommé Nazlet Saouâdeh, dont les habitans sont partie Chrétiens et partie Musulmans,
livres les uns et les autres a la fabrication du sucre. Les premiers y ont un
monastère et une église, et aussi des.tombeaux, où tous les Chrétiens de Myiyeh
et des environs déposent leurs morts-, comme les Musulmans vont le faire à
Zâouyet el-Maveteyn. La plaine cultivée s’étend jusqu’au pied du rocher, qui la
borde comme une muraille.
Cest dans ce rocher qupn a creusé un hypogée d’une espèce singulière, et
comme il n’y en a aucun dans toute l’Egypte. Par son plan, il appartient à l’architecture
Romaine, et rien n’annonce qu’il ne soit pas un ouvrage des Romains.
Depuis, les Chrétiens 1 ont employé à leur usage et converti en église. Le travail
de ce monument souterrain est assez beau, et rappelle celui qui est près d’Alexandrie,
non loin des bains de Cléopatre. L ’édifice est d’ordre Dorique^ mais quelques
moulures s éloignent du style de cet ordre. Les tombes que les Chrétiens ont
construites au dedans et au dehors, contrastent par la grossièreté de l’ouvrage avec
l’exccution de toutes les parties.
On entre par une allée basse, longue cle cinq mètres, qui a sa porte sur un
plateau taillé dans la montagne à mi-côte ; on arrive ainsi dans une cour découverte
, environnée de colonnes, haute de 4m 4- environ jusqu’au sommet de
la corniche, et de 8m ~ jusqu’au plateau supérieur du rocher. Contre l’usage des
hypogées Égyptiens, la cour est à découvert. L ’ouverture supérieure est un carré
de y T de coté (i). Apres la cour, on entre dans plusieurs pièces longues et
étroites, dont une est fermée par un petit mur d’une époque postérieure ; au
fond il y a encore, m’a-t-on dit, d’autres distributions.
Il devoit y avoir dix-huit colonnes dans cette espèce de péristyle ; mais, malgré
toutes mes recherches, je n’ai pu distinguer la place de celles du côté du nord. La
plupart des colonnes sont tombées, et il en reste seulement les chapiteaux avec
le haut du fût, qui semblent suspendus en l’air (2). Du.côté de l’est, le rang des
colonnes est remplacé par le petit mur qui ferme l’église. La frise est ornée de
triglyphes; les profils, les murs, sont purement travaillés; il y a dans la corniche
une doucine dont le galbe est exécuté avec finesse ( 3 ).
Sur le côté du sud, le mur est percé de cavités basses et oblongues qui paroissent
avoir servi à déposer des morts. En avant, sous les galeries, les Chrétiens ont placé
des tombeaux en briques, où il y a quelques caractères d’écriture effacés, que je
nai pu copier. Ils se distinguent des tombeaux Turcs par la voûte qui les couronne.
Les briques sont diversement arrangées (4). Les Chrétiens ont bâti plusieurs petites
['! W ‘S, fis- ■ a 2. (3) Voyez pl. 68 ,fg . 4.
(*) Ifod .fis. s- (4) ibid, a ,0.
^.z>. P