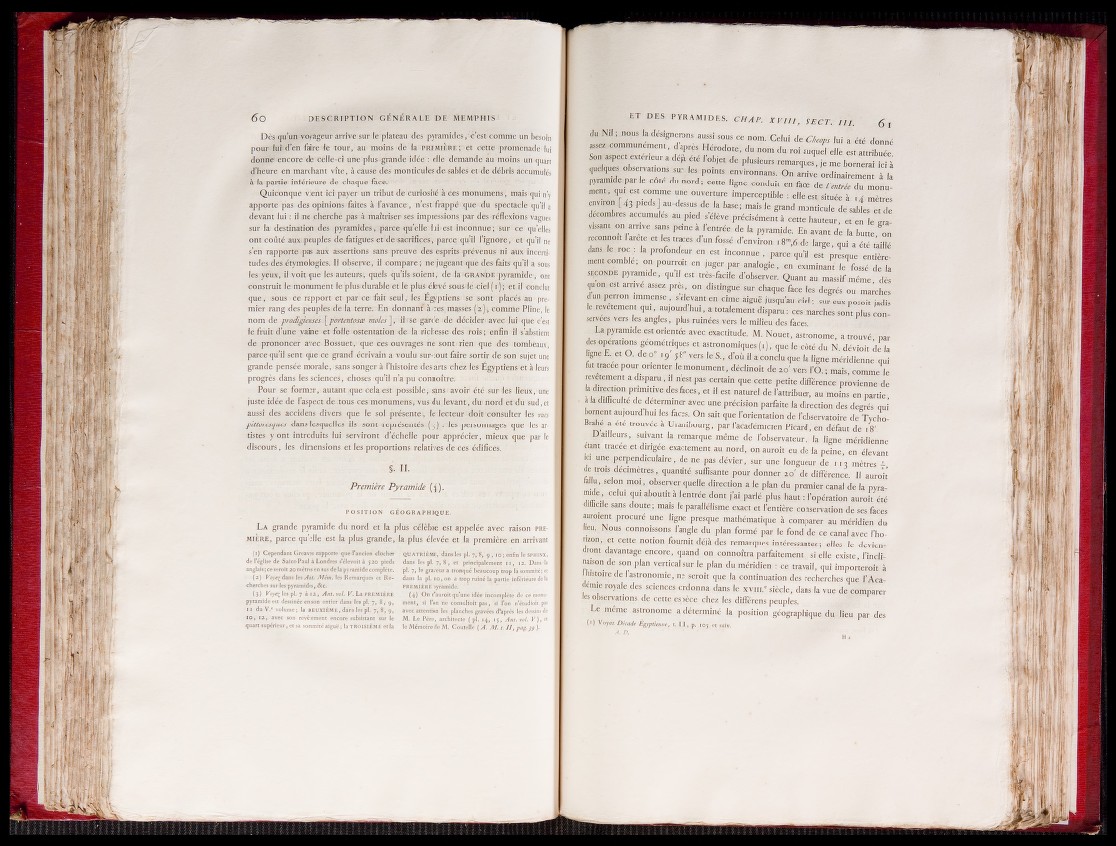
D ESC R IPT IO N GENERALE DE MEMPHIS’
Dès qu’un voyageur arrive sur le plateau des pyramides,'¿’est comme un besoin
pour lui d’en faire le tour, au moins de la PREMIERE“, -et cette promenade lui
donne" encore de celle-ci une plus grande idée : elle demande au moins un quart
d’heure en marchant vite, à cause des monticules de sablés et de débris accumulés
à la partie inférieure de chaque face,
Quiconque vient ici payer un tribut de curiosité à ces montimens, mais qui n’y
apporte pas des opinions faites à l’a vance, n’est frappé que du spectacle qu’il a
devant lui : il ne cherche pas à maîtriser- ses impressions par des-réflexions vagues
sur la destination des pyramides , parce qu’elle lui-est inconnue ; sur ce qu’elles
ont coûté aux peuples de fatigues et de sacrifices, parce qu’il l’ignore, et qu’il ne
s’en rapporte pas aux assertions sans preuve des esprits -prévenus ni aux incertitudes
des étymologies. Il observe, il compare; ne jugeant que des faits qu’il a sous
les yeux, il voit que les auteurs, quels qu’ils soient, de la g r a n d e pyramide, ont
construit le monument le plus durable et le plus élevé sous le -ciel ( t ) ; et il conclut
qu e , sous ce rapport et par ce fait seul, les Egyptiens se sont placés au premier
rang des peuples de la terre. En donnant à -ces masses (2)-, comme Pline, le
nom de prodigieuses [ portentosoe moles ], il- se garde de décider-avec lui que c’est
le fruit d’une vaine et folle ostentation de la richesse des rois ; enfin il s’abstient
de prononcer avec Bossuet, que ces ouvrages ne sont rien que des tombeaux,
parce qu’il sent que ce grand écrivain a voulu sur-tout faire sortir de son sujet une i
grande pensée morale, sans songer à l’histoire des arts chez les Égyptiens et à leurs
progrès dans les sciences, choses qu’il n’a pu connoître.
Pour se former, autant que cela-est possible; sans; avoir été sur les lieux,une
juste idée de l’aspect de .tous ces monumens, vus du levant, du; nord et'du sud,et
aussi des accidens divers que le sol présente-, le lecteur doit consulter les vues
pittoresques dans lesquelles ils sont représentés;(.3) : les personnages que les artistes
y ont introduits lui serviront d’échelle pour apprécier, mieux que par le
discours, les dimensions et les proportions relatives de ces édifices.
§. II.
Première Pyramide ( 4).
P O S I T I O N G E O G R A P H I Q U E .
L a grande pyramide du nord et la plus célèbre est appelée avec raison p r e m
i è r e , parce qu’elle est la plus grande, la plus élevée et la première en arrivant
(1) Cependant Greaves rapporte que l’ancien clocher
de l’église de Saint-Paul à Londres s’élevoit à 520 pieds
anglais; ce serait 20 mètres en sus de la pyramide complète.
(2) Voyez dans les Ant. A'Jém. les Remarques et Recherches
sur les pyramides, &c.
( 3 ) V°y% les pl. 7 à 1 2 , Ant. vol. V. La p r e m i è r e
p y ram id e est dessinée en son e n tie r dan s les pl. 7 , 8 g ,
11 d u V.e volum e ; la D EU X IÈM E, d an s les pl. 7, 8 , 9 ,
1 0 , 1 2 , av ec son rev êtem en t enco re subsistant su r le
q u a rt su p é rie u r, e t sa som m ité aig u ë ; la t r o i s i è m e et la
QUATRIÈME, dans les pl. 7, 8, 9 , 1 0 ; enfin le SPHINX,
d an s les pl. 7 , 8 , e t prin cip alem en t 1 1 , 12. D ans la
pl. 7» î®' g rav eu r a tro n q u é b eau co u p tro p la som m ité; et
dan s la pl. 1 0 , o n a tro p ru in é la p a rtie inférieure de la
PREMIÈRE pyram ide. ’
(4 ) On n’aurait qu’une idée incomplète de ce monument,
si Ion ne consultoit pas, si l’on n’étudioit pas
avec attention les planches gravées d*âprès les dessins de
M. Le Père, architecte (p l. 14, 15, Ant. vol. V ), et
le Mémoire de M. Coutelle ( A. M . t. I I , pag.jp ).
ET DES PYRAMIDES. CHAP. XV I I I , SECT. I I I . 6 l
du Nil ; nous la désignerons aussi sous ce nom. Celui de Cheops lui a été donné
assez communément, d après Hérodote, du nom du roi auquel elle est attribuTe
Son aspect exterreur a déjà été l’objet de plusieurs remarque^je me bornerai ici à
quelques observations sur les points environnans. O n arrive ordinairement à la
pyramide par le côté du nord; cette ligne conduit en face de l ’entrée du monument,
qui est comme une ouverture imperceptible ; elle est située à ,4 mètres
envron [ 43 pieds au-dessus de la base; mais le grand monticule de salles et de
décombres accumules au pied s’élève précisément à cette hauteur, et en le L a
vissant on arrive sans peine à l’entrée de la pyramide. En avant de la butte on
reconnoit 1 arete et les traces d un fossé d’environ 18ra,6 de large, qui a été taillé
dans le rpc : la profondeur en est inconnue , parce qu’il est presque entièrement
comble, on pourroit en juger par analogie, en examinant le fossé de la
S E C O N D E pyramide, qu il est très-facile d’observer. Quant au massif même dès
quon est arrive assez près, on distingue sur chaque face les degrés ou marches
d un perron immense, s élevant en cime aiguë jusqu’au c iel; sureu xp o so it jadis
le revetement qui, aujourd hui, a totalement disparu : ces marches sont plus conservées
vers les angles, plus ruinées vers le milieu des faces.
La pyramide est orientée avec exactitude. M. Nouet, astronome, a trouvé par
des opérations géométriques et astronomiques (1), que le côté du N. dévioit de la
ligne E e tO . d e o ° ,9 y 8" vers le S., d’où il a conclu que la ligne méridienne qui
fut tracee pour orienter le monument, déclinoit de 20' vers l’O. ; mais, comme le
revetement a disparu, il n’est pas certain que cette petite différence provienne de
desfkces- et fl est naturel de l’attribuer, au moins en partie
• a la difficulté de déterminer avec une précision parfaite la direction des degrés gui
bornent aujourd hui les faces. On sait que l’orientation de l’observatoire de Tycho-
ihahe a ete trouvée a Urambourg, par l’académicien Picard, en défaut de 18'.
, D ailleurs, suivant la remarque même de l’observateur, la ligne méridienne
étant tracee et dirigée exactement au nord, on auroit eu de la peine, en élevant
ici une perpendiculaire, de ne pas dévier, sur une longueur de 1 13 mètres -
de trois décimètres, quantité suffisante pour donner 20' de différence. Il auroit
fallu, selon m o i, observer quelle direction a le plan du premier canal de la pyramide
celui qui aboutit à l’entrée dont j’ai parlé plus haut : l’opération auroit été
difficile sans doute; mais le parallélisme exact et l’entière conservation de ses fkees
auroient procuré une ligne presque mathématique à comparer au méridien du
lieu. Nous connoissons l’angle du plan formé par le fond de ce canal avec l’horizon,
et cette notion fournit déjà des remarques intéressantes; elles le deviendront
davantage encore, quand on connoîtra parfaitement, si elle existe l’inclinaison
de son plan vertical sur le plan du méridien : ce travail, qui importeroit à
Ihistoire de 1 astronomie, ne seroit que la continuation des recherches que l’A c a démie
royale des sciences ordonna dans le x vm .' siècle, dans la vue de comparer
les observations de cette espèce chez les différens peuples.
Le même astronome a déterminé la position géographique du lieu par des
( 1 ) Voyez Décade Égyptienne, t. I I I , p. 105 et suiv.
A. D.
H 2