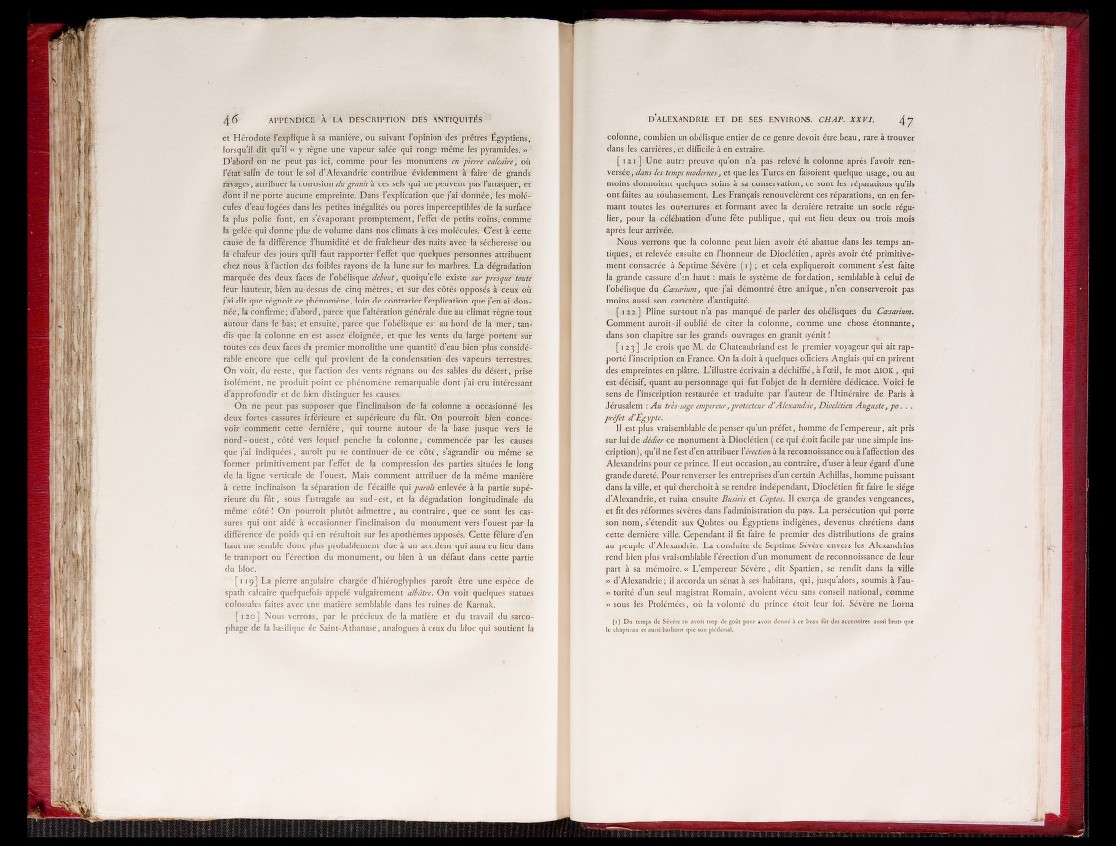
et Hérodote l’explique à sa manière, ou suivant l’opinion des prêtres Égyptiens,
lorsqu’il dit qu’il « y règne une vapeur salée qui ronge même les pyramides. » :
D ’abord on ne peut pas ici, comme pour les monumens en pierre calcaire ; où
l’état salin de tout le sol d’Alexandrie contribue évidemment à faire de grands
ravages, attribuer la corrosion du granit à ces sels qui ne peuvent pas l’attaquer, et
dont il ne porte aucune empreinte. Dans l’explication que j’ai donnée, les molécules
d’eau logées dans les petites inégalités ou pores imperceptibles de la surface
la plus polie font, en s’évaporant promptement, l’effet de petits coins, comme
la gelée qui donne plus de volume dans nos climats à ces molécules. C ’est à cette
cause de la différence d’humidité et de fraîcheur des nuits avec la sécheresse ou
là’chàléür des jours qu’il faut rapporter l’effet que quelques personnes attribuent
chez nous à l’action des foibles rayons de la lune sur les marbres. La dégradation
marquée dès deux faces de l’obélisque debout, quoiqu’elle existe sur presque toute
leur hauteur, bien au-dessus de cinq mètres, et sur des côtés opposés à ceux où
j’ai dit que régnoit ce phénomène, loin de contrarier l’explication que j’én ai donnée,
la confirme; d’abord, parce que l’altération générale due au climat règne tout
autour dans le bas; et ensuite, parce que l’obélisque est au bord de la mer, tandis
que la colonne en est assez éloignée, et que les vents du large portent sur
toutes cés deux faces du premier monolithe une quantité d’eau bien plus considérable
encore que celle qui provient de la condensation des vapeurs terrestres.
On voit, du reste, que l’action des vents régnans ou des sables du désert, prise
isolément, ne produit point ce phénomène remarquable dont j’ai cru intéressant
d’approfondir et de bien distinguer les causes.
On ne peut pas supposer que l’inclinaison de la colonne a occasionné les
deux fortes cassures inférieure et supérieure du fût. On pourroit bien concevoir
comment cette dernière, qui tourne autour de la base jusque vers lé
nord - ouest, côté vers lequel penche la colonne, commencée par les causes
que j’ai indiquées, auroit pu se continuer de ce cô té , s’agrandir ou même se
'former primitivement par l’effet de la compression des parties situées le long
de la ligne verticale de l’ouest. Mais comment attribuer de la même manière
à cette inclinaison la séparation de l’écaille qui paroît enlevée à la partie supérieure
du fû t, sous l’astragale au sud-est, et la dégradation longitudinale du
même côté î On pourroit plutôt admettre, au contraire, que ce sont les cassures
qui ont aidé à occasionner l’inclinaison du monument vers l’ouest par la
différence de poids qui en résultoit sur les apothèmes opposés. Cette fêlure d’en
haut me semble donc plus probablement due à un accident qui aura eu lieu dans
le transport ou l’érection du monument, ou bien à un défaut dans cette partie
du bloc.
■ [ i 19] La pierre angulaire chargée d’hiéroglyphes paroît être une espèce dé
spath calcaire quelquefois appelé vulgairement albâtre. On voit quelques statues
■colossales faites avec une matière semblable dans les ruines de Kamak.
[ n o ] Nous verrons, par le précieux de la matière et du travail du sarcophage
de la basilique de Saint-Athanase, analogues à ceux du bloc qui soutient la
colonne, combien un obélisque entier de ce genre devoit être beau, rare à trouver
dans les carrières, et difficile à en extraire.
[ 121 ] Une autre preuve qu’on n’a pas relevé la colonne après l’avoir renversée,
dans les temps modernes, et que les Turcs en faisoient quelque usage, ou au
moins donnoient quelques soins à sa conservation, ce sont les réparations qu’ils
ont faites au soubassement. Les Français renouvelèrent ces réparations, en en fermant
toutes les ouvertures et formant avec la dernière retraite un socle régulier,
pour la célébration d’une fête publique, qui eut lieu deux ou trois mois
après leur arrivée.
Nous verrons que la colonne peut bien avoir été abattue dans les temps antiques,
et relevée ensuite en l’honneur de Dioclétien, après avoir été primitivement
consacrée à Septime Sévère ( 1 ) ; et cela expliquerait comment s’est faite
la grande cassure d’en haut ; mais le système de fondation, semblable à celui de
l’obélisque du Coesarium, que-j’ai démontré être antique, n’en conserveroit pas
moins aussi son caractère d’antiquité.
[ 122] Pline sur-tout n’a pas manqué de parler des obélisques du Coesarium.
Comment auroit-il oublié de citer la colonne, comme une chose étonnante,
dans son chapitre sur les grands ouvrages en granit syénit !
[123] Je crois que M. de Chateaubriand est le premier voyageur qui ait rapporté
l’inscription en France. On la doit à quelques officiers Anglais qui en prirent
des empreintes en plâtre. L ’illustre écrivain a déchiffré, à 1 oeil, le mot AIOK , qui
est décisif, quant au personnage qui fut l’objet de la dernière dédicace. Voici le
sens de l’inscription restaurée et traduite par l’auteur de l’Itinéraire de Paris à
Jérusalem : Au trcs-sage empereur, protecteur eïAlexandrie, Dioclétien Auguste, po. . .
préfet d'Egypte.
II est plus vraisemblable de penser qu’un préfet, homme de l’empereur, ait pris
sur lui de dédier ce monument à Dioclétien ( ce qui étoit facile par une simple inscription),
qu’il ne l’est d’en attribuer l'érection à la reconnoissance ou à l’affection des
Alexandrins pour ce prince. Il eut occasion, au contraire, d’user à leur égard d’une
grande dureté. Pour renverser les entreprises d’un certain Achillas, homme puissant
dans la ville, et qui cherchoit à se rendre indépendant, Dioclétien fit faire le siège
d’Alexandrie, et ruina ensuite Busiris et Coptos. Il exerça de grandes vengeances,
et fit des réformes sévères dans l’administration du pays. La persécution qui porte
son nom, s’étendit aux Qobtes ou Égyptiens indigènes, devenus chrétiens dans
cette dernière ville. Cependant il fit faire le premier des distributions de grains
au peuple d’Alexandrie. La conduite de Septhne Sévère envers les Alexandrins
rend bien plus vraisemblable l’érection d’un monument de reconnoissance de leur
part à sa mémoire. « L ’empereur Sévère, dit Spartien, se rendit dans la ville
» d’Alexandrie; il accorda un sénat à ses habitans, qui, jusqu’alors, soumis à l’au-
» torité d’un seul magistrat Romain, avoient vécu sans conseil national, comme
» sous les Ptolémées, où la volonté du prince étoit leur loi. Sévère ne borna
(1) Du temps de Sévère on avoit trop de goût pour avoir donné à ce beau fût des accessoires aussi bruts que
le chapiteau et aussi barbares que son piédestal.