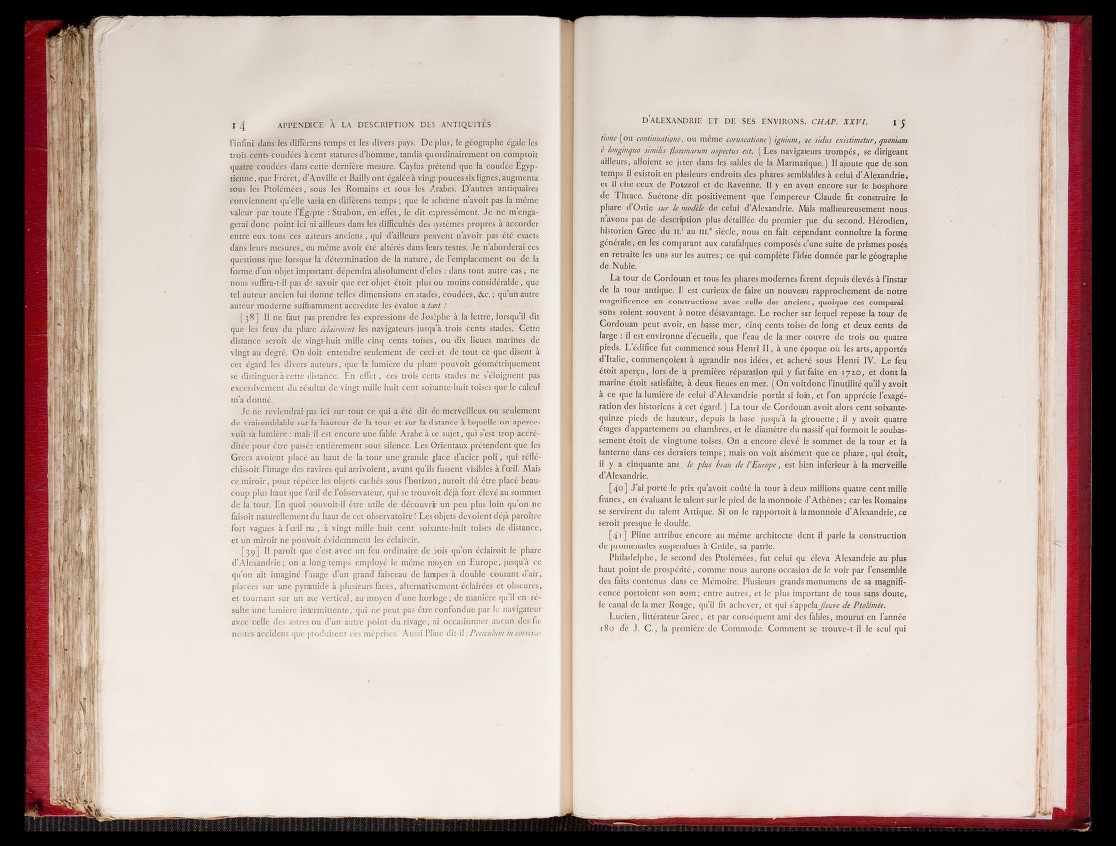
l’infini dans les différens temps et les divers pays. De plus, le géographe égale les
trois cents coudées à cent statures d’homme, tandis qu’ordinairement on comptoit
quatre coudées dans cette dernière mesure. Caylus prétend que la coudée Egyptienne,
que Fréret, d’Anville et Bailly ont égalée à vingt pouces six lignes, augmenta
sous les Ptolémées, sous les Romains et sous les Arabes. D ’autres antiquaires
conviennent qu’elle varia en differens temps ; que le schoene n’avoit pas la même
valeur par toute l’Egypte : Strabon, en effet, le dit expressément. Je ne m’engagerai
donc point ici ni ailleurs dans les difficultés des systèmes propres à accorder
entre eux tous ces auteurs anciens, qui d’ailleurs peuvent n’avoir pas été exacts
dans leurs mesures, ou même avoir été altérés dans leurs textes. Je n’aborderai ces
quèstions que lorsque la détermination de la nature, de l’emplacement ou de la
forme d’un objet important dépendra absolument d’elles : dans tout autre cas, ne
nous suffira-t-il pas de savoir que cet objet étoit plus ou moins considérable, que
telaiiteur ancien lui donne telles dhnensions en stades, coudées, &c. ; qu’un autre
auteur moderne suffisamment accrédité les évalue à tant !
[38] Il ne faut pas prendre les expressions de Josèphe à la lettre, lorsqu’il dit
que les feux du phare cclairoient les navigateurs jusqu’à trois cents stades. Cette
distance seroit de vingt-huit mille cinq cents toises, ou dix lieues marines de
vingt au degré. On doit entendre seulement de ceci et de tout ce que disent à
cet égard les divers auteurs, que la lumière du phare pouvoit géométriquement
se distinguer à cette distance. En effet, ces trois cents stades ne s’éloignent pas
excessivement du résultat de vingt mille huit cent soixante-huit toises que le calcul
m’a donné.
Je ne reviendrai pas ici sur tout ce qui a été dit de merveilleux ou seulement
de vraisemblable sur la hauteur de la tour et. sur la distance à laquelle on aperce-
voit sa lumière : mais i l est encore une fable Arabe à ce sujet, qui s’ést trop accréditée
pour être passée entièrement sous silence. Les Orientaux prétendent que les
Grecs avoient placé au haut de la tour une grande glace d’acier p o li, qui réflé-
cliissoit l’image des navires qui arrivoient, avant qu’ils fussent visibles à l’oeil. Mais
ce miroir., pour répéter les objets cachés sous l’horizon, auroit dû être placé beaucoup
plus haut que l’oeil de l’observateur, qui se trouvoit déjà fort élevé au sommet
de la tour. En quoi pouvoit-il être utile de découvrir un peu plus loin qu on ne
faisoit naturellement du haut de cet observatoire ! Les objets de voient déjà paroltre
fort vagues à l’oeil nu , à vingt mille huit cent soixante-huit toises de distance,
et un miroir ne pouvoit évidemment les éclaircir.
[39] E paroît que c’est avec un feu ordinaire de bois qu’on éclairoit le phare
d’Alexandrie; on a long temps employé le même moyen en Europe, jusqu’à ce
qu’on ait imaginé l’usage d’un grand faisceau de lampes à double courant dair,
placées sur une pyramide à plusieurs faces, alternativement éclairées et obscures,
et tournant sur un axe vertical, au moyen d’une horloge ; de manière qu’il en résulte
une lumière intermittente, qui ne peut pas être confondue par le navigateur
avec celle des astres ou d’un autre point du rivage, ni occasionner aucun des funestes
accidens que produisent ces méprises. Aussi Pline dit-il -.Pcriculum ¡11 cornv.itione
(ou continuatiçne, ou même coruscatione) ignium, ne sidus existimetur, quoniam
e longinquo similis flammarum aspectus est. ( Les navigateurs trompés, se dirigeant
ailleurs, alloient se jeter dans les sables de la Marmarique. ) Il ajoute que de son
temps il existoit en plusieurs endroits des phares semblables à celui d’Alexandrie,
et il cite ceux de Pouzzol et de Ravenne. Il y en avoit encore sur le bosphore
de Thrace. Suétone dit positivement que l’empereur Claude fit construire le
phare d Ostie sur le modèle de celui d’Alexandrie. Mais malheureusement nous
n avons pas de description plus détaillée du premier que du second. Hérodien,
historien Grec du n.c au 111.' siècle, nous en fait cependant connoître la forme
générale, en les comparant aux catafalques composés d’une suite de prismes posés
en retraite les uns sur les autres ; ce qui complète l’idée donnée par le géographe
de Nubie.
La tour de Cordouan et tous les phares modernes furent depuis élevés à l’instar
de ja tour antique. Il est curieux de faire un nouveau rapprochement de notre
magnificence en constructions avec celle des anciens, quoique ces comparaisons
soient souvent à notre désavantage. L e rocher sur lequel repose la tour de
Cordouan peut avoir, en basse mer, cinq cents toises de long et deux cents de
large : il est environné d’écueils, que l’eau de la mer couvre de trois ou quatre
pieds. L ’édifice fut commencé sous Henri II, à une époque où les arts, apportés
d Italie, commençoient à agrandir nos idées, et achevé sous Henri IV. Le feu
étôit aperçu, lors de la première réparation qui y fut faite en 1720, et dont la
marine étoit satisfaite, à deux lieues en mer. ( O n voit donc l’inutilité qu’il y avoit
à ce que la lumière de celui d’Alexandrie portât si loin, et l’on apprécie l’exagération
des historiens à cet égard. ) La touF de Cordouan avoit alors cent soixante-
quinze pieds de hauteur, depuis la base jusqu’à la girouette ; il y avoit quatre
étages d’appartemens ou chambres, et le diamètre du massif qui formoit le soubassement
étoit de vingt-une toises. On a encore élevé le sommet de la tour et la
lanterne dans ces derniers temps ; mais on vojt aisément que ce phare, qui étoit,
il y a cinquante ans, le plus beau de l'Europe, est bien inférieur à la merveille
d’Alexandrie.
[4o] J’ai porté le prix qu’avoit coûté la tour à deux millions quatre cent mille
francs, en évaluant le talent sur le pied de la monnoie d’Athènes ; car les Romains
se servirent du talent Attique. Si on le rapportoità la monnoie d’Alexandrie, ce
seroit presque le double.
[4 1 ] Pline attribue encore au même architecte dont il parle la construction
de promenades suspendues à Cnide, sa patrie.
Philadelphe, le second des Ptolémées. fut celui qui éleva Alexandrie au plus
haut point de prospérité, comme nous aurons occasion de le voir par l’ensemble
des faits contenus dans ce Mémoire. Plusieurs grands monumens de sa magnificence
portoient son nom; entre autres, et le plus important de tous sans doute,
le canal de la mer Rouge, qu’il fit achever, et qui s’appela_/?raw de Ptolémée.
Lucien, littérateur Grec, et par conséquent ami des fables, mourut en l’année
180 de J. C ., la première de Commode. Comment se trouve-t il le seul qui