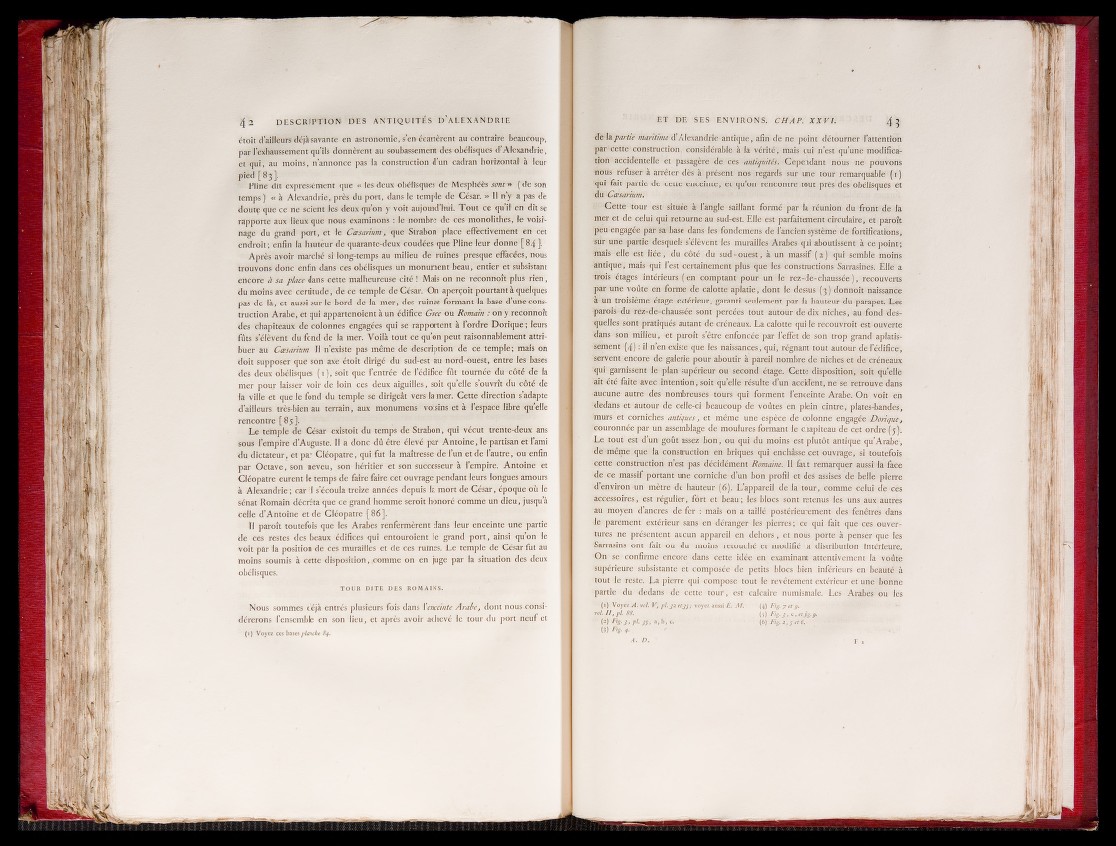
étoit d'ailleurs déjà savante en astronomie, s’en écartèrent au contraire beaucoup',
par l’exhaussement qu’ils donnèrent au soubassement des obéfisques d’Alexandrie,
et qui, au moins, n’annonce pas la construction d’un cadran horizontal à leur
pied [8 3 } •" ; ^
Pline dit expressément que « les deux obéfisques de Mesphéès sont. » ( de son
temps) « à Alexandrie,près du port, dans le temple de César. » Il n y a pas de
doute que ce ne soient les deux qu’on y voit aujourd’hui. Tout ce qu’il en dît se
rapporte aux lieux que nous examinons ; le nombre de ces monolithes, le voisinage
du grand port, et le Coesarium, que Strabon place effectivement en cet
endroit; enfin la hauteur de quarante-deux coudées que Pline leur donne [ 84 ].
Après avoir marché si long-temps au milieu de ruines presque effacées, nous
trouvons donc enfin dans ces obélisques un monument beau, entier et subsistant
encore à sa place dans cette malheureuse cité ! Mais on ne reconnoît plus rien,
du moins avec certitude, de ce temple de César. On aperçoit pourtant à quelques
pas de là, et aussi sur le bord de la mer, des ruines formant la base d’une construction
Arabe, et qui appartenoient à un édifice Grec ou Romain : on y reconnoît
des chapiteaux de colonnes engagées qui se rapportent à l’ordre Dorique ; leurs
fûts s’élèvent du fond de la mer. Voilà tout ce qu’on peut raisonnablement attribuer
au Coesarium. Il n’existe pas même de description de ce temple; mais on
doit supposer que son axe étoit dirigé du sud-est au nord-ouest, entre les bases
des deux obélisques ( 1 ), soit que l’entrée de l’édifice fût tournée du côté de la
mer pour laisser voir de loin ces deux aiguilles, soit qu’elle s’ouvrit du côté de
là ville et que le fond du temple se dirigeât vers la mer. Cette direction s’adapte
d’ailleurs très-bien au terrain, aux monumens voisins et à l’espace libre qu’elle
rencontre [8y],
Le temple de César existoit du temps de Strabon, qui vécut trente-deux ans
sous l’empire d’Auguste. Il a donc dû être élevé par Antoine, le partisan et l’ami
du dictateur, et par Cléopatre, qui fut la maîtresse de l’un et de l’autre, ou enfin
par Octave, son neveu, son héritier et son successeur à l’empire. Antoine et
Cléopatre eurent le temps de faire faire cet ouvrage pendant leurs longues amours
à Alexandrie; car il s’écoula treize années depuis la mort de César, époque où le
sénat Romain décréta que ce grand homme seroit honoré comme un dieu, jusqua
celle d’Antoine et de Cléopatre [86].
Il paroît toutefois que les Arabes renfermèrent dans leur enceinte une partie
de ces restes des beaux édifices qui entouroient le grand port, ainsi qu’on le
voit par la position de ces murailles et de ces ruines. Le temple de César fut au
moins soumis à cette disposition, .comme on en juge par la situation des deux
obélisques.
T O U R D I T E D E S R O M A I N S .
Nous sommes déjà entrés plusieurs fois dans l'enceinte Arabe, dont nous considérerons
l’ensemble en son lieu, et après avoir achevé le tour du port neuf et
(1) Voyez ces bases planche 84.
de Impartie maritime d Alexandrie antique, afin de ne point détourner l’attention
par cette construction, considérable à la vérité, mais qui n’est qu’une modification
accidentelle et passagère de ces antiquités. Cependant nous ne pouvons
nous refuser à arrêter dès à présent nos regards sur une tour remarquable ( 1 )
qui fait partie de cette enceinte, et qu’on rencontre tout près des obélisques et
du Coesarium.
Cette tour est située à l’angle saillant formé par la réunion du front de la
mer et de celui qui retourne au sud-est. Elle est parfaitement circulaire, et paroît
peu engagée par sa base dans les fondemens de l’ancien système de fortifications,
sur une partie desquels s’élèvent les murailles Arabes qui aboutissent à ce point;
mais elle est liée , du côté du sud-ouest, à un massif (2) qui semble moins
antique, mais qui l’est certainement plus que les constructions Sarrasines. Elle a
trois étages intérieurs (en comptant pour un le rez-de-chaussée), recouverts
par une voûte en forme de calotte aplatie, dont le dessus (3) donnoit naissance
à un troisième étage extérieur, garanti seulement par la hauteur du parapet. Les
parois du rez-de-chaussée sont percées tout autour de dix niches, au fond desquelles
sont pratiqués autant de créneaux. La calotte qui le recouvroit est ouverte
dans son milieu, et paroît s’être enfoncée par l’effet de son trop grand aplatissement
(4) : il n’en existe que les naissances, qui, régnant tout autour de l’édifice,
servent encore de galerie pour aboutir à pareil nombre de niches et de créneaux
qui garnissent le plan supérieur ou second étage. Cette disposition, soit qu’elle
ait été faite avec intention, soit qu’elle résulte d’un accident, ne se retrouve dans
aucune autre des nombreuses tours qui forment l’enceinte Arabe. On voit en
dedans et autour de celle-ci beaucoup de voûtes en plein cintre, plates-bandes,
murs et corniches antiques, et même une espèce de colonne engagée Dorique,
couronnée par un assemblage de moulures formant le chapiteau de cet ordre (y).
Le tout est d’un goût assez bon, ou qui du moins est plutôt antique qu’Arabe,
de même que la construction en briques qui enchâsse cet ouvrage, si toutefois
cette construction n’est pas décidément Romaine. Il faut remarquer aussi la face
de ce massif portant une corniche d’un bon profil et des assises de belle pierre
d environ un mètre de hauteur (6). L ’appareil de la tour, comme celui de ces
accessoires, est régulier, fort et beau; les blocs sont retenus les uns aux autres
au moyen d’ancres de fer : mais on a taillé postérieurement des fenêtres dans
le parement extérieur sans en déranger les pierres ; ce qui fait que ces ouvertures
ne présentent aucun appareil en dehors, et nous porte à penser que les
Sarrasins ont fait ou du moins retouché et modifié la distribution intérieure.
On se confirme encore dans cette idée en examinant attentivement la voûte
supérieure subsistante et composée de petits blocs bien inférieurs en beauté à
tout le reste. La pierre qui compose tout le revêtement extérieur et une bonne
partie du dedans de cette tour, est calcaire numismate. Les Arabes ou les
(1) Voyez A . vol. V, p l.32 et j j ; voyez aussi È. A l.' (4) Fig. y et p.
ml. I l , pl. SS. (5) Fig-J, c , et fig.).
' (-) Fig-J, p l-JS, a ,b , c, ■ (6) Fig. 2, ; a 6 .
(3) Fis- *■
A . D . F ,