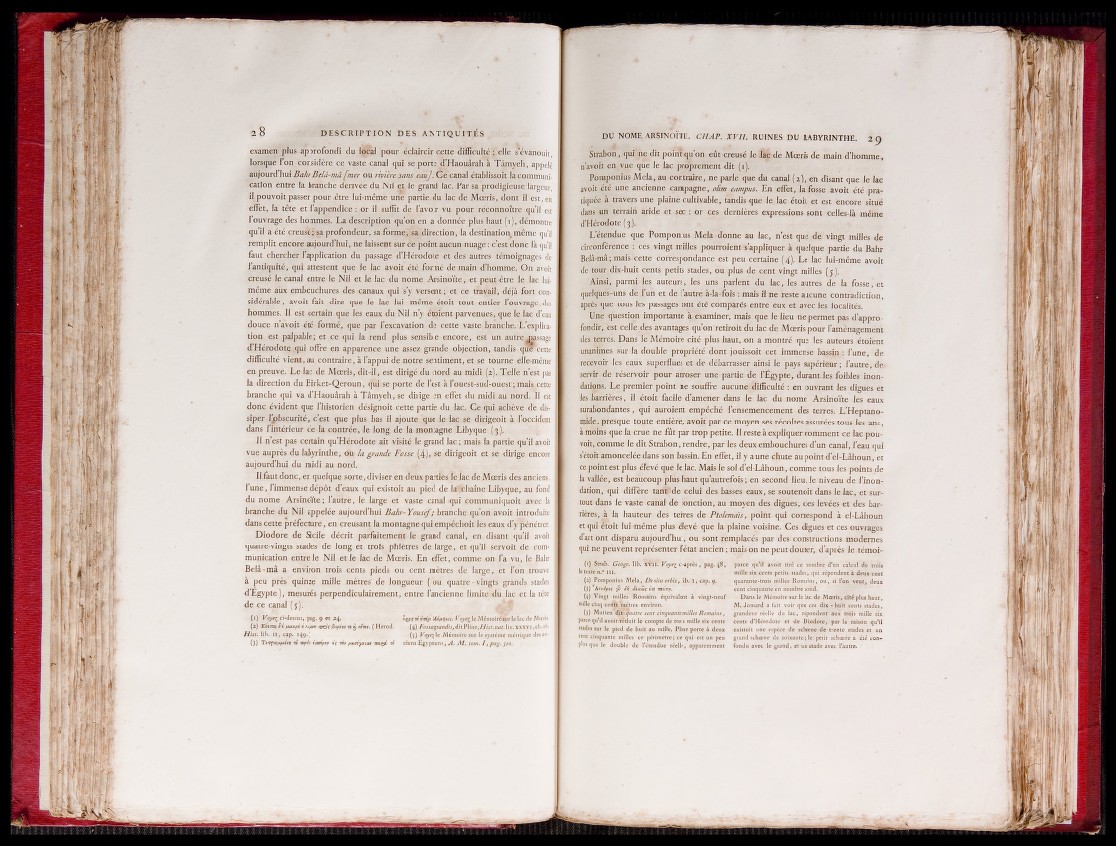
examen plus approfondi du local pour éclaircir cette difficulté ; elle s évanouit
lorsque l’on considère ce vaste canal qui se porte d’Haouârah à Tâmyeh, appelé
aujourd hui Bahr Belâ-mâ [mer ou rivière sans eau]. C e canal établissoit la communication
entre la branche dérivée du Nil et le grand lac. Par sa prodigieuse largeur,
il pouvoit passer pour être lui-même une partie du lac de Mceris, dont il est, en
effet, la tête et l’appendice : or il suffit de l’avoir vu pour réconnoftre qu’il est
1 ouvrage des hommes. La description qu’on en a donnée plus haut (i), démontre
qu’il a été creusé; sa profondeur, sa forme, sa.direction, la destination, même qu’il
remplit encore aujourd’hui, ne laissent sur ce point aucun nuage : c’est donc là qu’il
faut chercher l’application du passage d’Hérodote et des autres témoignages de
l’antiquité, qui attestent que le lac avoit été formé de main d’homme. On avoit
creusé le canal entre le Nil et le lac du nome Arsinoïte, et peut être le lac lui-
même aux embouchures des canaux qui s’y versent; et ce travail, déjà fort con- j
sidérable, avoit fait dire que le lac lui-même étoit tout entier l'ouvrage des
hommes. Il est certain que les eaux du Nil n’y étoient parvenues, que le lac d’eau
douce n’avoit été formé, que par J’excavation de cette vaste branche. L ’explication
est palpable; et ce qui la rend plus sensible encore, est un autre massage
d Hérodote qui offre en apparence une assez grande objection, tandis que cette
difficulté vient, au contraire, à l’appui de notre sentiment, et se tourne elle-même
en preuve. Le lac de Mceris, dit-il, est dirigé du nord au midi (2). Telle n’est pas
la direction du Birket-Qeroun, qui se porte de l’est à l’ouest-sud-ouest ; mais cette
branche qui va d’Haouârah à Tâmyeh, se dirige en effet du midi au nord. Il est
donc évident que l’historien désignoit cette partie du lac. Ce qui achève de dissiper
l’pbscurité, c’est que plus bas il ajoute que le lac se dirigeoit à l’occident
dans l’intérieur de la contrée, le long de la montagne Libyque (3).
II n’est pas certain qu’Hérodote ait visité le grand lac ; mais la partie qu’il avoit I
vue auprès du labyrinthe, ou la grande Fosse (4 ), se dirigeoit et se dirige encore I
aujourd’hui du midi au nord.
Il faut donc, en quelque sorte, diviser en deux parties le lac de Mceris des anciens. I
lun e, l’immense dépôt d’eaux qui existoit au pied de la chaîne Libyque, au fond I
du nome Arsinoïte; l’autre, le.large et vaste canal qui communiquoit avec la I
branche du Nil appelée aujourd’hui Bahr-Yousef; branche qu’on avoit introduite I
dans cette préfecture, en creusant la montagne qui empêchoit les eaux d’y pénétrer. I
Diodore de Sicile décrit parfaitement le grand canal, en disant qu’il avoit I
quatre-vingts stades de long et trois phlètres de large, et qu’il servoit de com- I
munication entre le Nil et le lac de Mceris. En effet, comme on l’a vu, le Bahr I
Belâ-mâ a environ trois cents pieds ou cent mètres de large, et l’on trouve I
a peu près quinze mille mètres de longueur (o u quatre-vingts grands stades I
d’Egypte), mesurés perpendiculairement, entre l’ancienne limite du lac et la tête I
de ce canal (5).
(1) Voye% ci-dessus, pgg. 9 et 24.
oçpçn Ù7iy> Mtpap/oç. Voyeç le Mémoire sur le lac de M ceris.
(2) K€Éitq JV juanpiü « hifjum l&opi'w n Kj roW. ( Herod.
(4) Fossa grandis, dit Pline, H ¡ st. nat. liv. xxx V 1, ch. 16.
Hist. iih. 11, cap. 149* )
(?) Mémoire sur le système métrique des anciens
(3) T i'rçcifAfx.ÎYYi 1v >Bf>èç iaotpnn iç rir /Mmycttaut m&t 7i
Egyptiens, A . M . tout. I,pa g . yio.
Strabon, qui ne dit point qu on eut creuse le lac de Moeris de main d’homme,
n’avoit en vue que le lac proprement dit (1).
Ponaponius Mêla, au contraire, ne parle que du canal (2), en disant que le lac
avoir été une ancienne campagne, olim campus. En effet, la fosse avoit été pratiquée
à travers une plaine cultivable, tandis que le lac étoit et est encore situé
dans un terrain aride et sec : or ces dernières expressions sont celles-là même
d’Hérodote (3).
L’étendue que Pomponius Mêla donne au lac, n’est que de vingt milles de
circonférence : ces vingt milles pourraient s’appliquer à quelque partie du Bahr
Belâ-mâ ; mais cette correspondance est peu certaine (4 ). Le lac lui-même avoit
de tour dix-huit cents petits stades, ou plus de cent vingt milles (y).
Ainsi, parmi les auteurs, les uns parlent du lac, les autres de la fosse) et
quelques-uns de l’un et de l’autre à-la-fois : mais il ne reste aucune contradiction,
après que tous les passages ont été comparés entre eux et avec les localités.
Une question importante à examiner, mais que le lieu ne permet pas d’approfondir,
est celle des avantages qu’on retiroit du lac de Moeris pour l’aménagement
des terres. Dans le Mémoire cité plus haut, 011 a montré que les auteurs étoient
unanimes sur la double propriété dont jouissoit cet immense bassin : l’une, de
recevoir les eaux superflues et de débarrasser ainsi le pays supérieur; l’autre, de
servir de réservoir pour arroser une partie de l’Égypte, durant.les foibles inon-
dations. Le premier point ne souffre aucune difficulté : en ouvrant les digues et
Jes barrières, il étoit facile d’amener dans le lac du nome Arsinoïte les eaux
surabondantes, qui auroient empêché l’ensemencement des terres. L ’Heptano-
mide, presque toute entière, avoit par ce moyen ses récoltes assurées tous les ans,
à moins que la crue ne fût par trop petite. Il reste à expliquer comment ce lac pouvoit,
comme le dit Strabon, rendre, par les deux embouchures d’un canal, l’eau qui
s’ctoit amoncelée dans son bassin. En effet, il y aune chute au point d’el-Lâhoun, et
ce point est plus éfevé que le lac. Mais le sol d’el-Lâhoun, comme tous les points de
la vallée, est beaucoup plus haut qu’autrefois; en second lieu, le niveau de l’inondation,
qui diffère tant de celui des basses eaux, se soutenoit dans le lac, et surtout
dans le vaste canal de jonction, au moyen des digues, des levées et des barrières,
à la hauteur des terres de Ptolemais, point qui correspond à el-Lâhoun
et qui étoit lui-même plus élevé que la plaine voisine. Ces digues et ces ouvrages
d art ont disparu aujourd’hui, ou sont remplacés par des constructions modernes
qui ne peuvent représenter l’état ancien ; mais on ne peut douter, d’après le témoi-
(1) Strab. Gcogr. lîb. XVII. Voye^ ci-après, pag. 48,
parce qu’il avoit tiré ce nombre d’un calcul de trois
le texte n.° n i.
mille six cents petits stades, qui répondent à deux cent
(2) Pomponius Mêla, De situ orbis, Iib. I , cap. 9.
quarante-trois milles Romains, ou, si l’on veut, deux
(3) Avutyoç yb «f>» Jïirw ç est tout».
cent cinquante en nombre rond.
(4) Vingt milles Romains équivalent à vingt-neuf
• Dans le Mémoire sur le lac de Mceris, cité plus haut,
mille cinq cents mètres environ.
M. Jomard a fait voir que ces dix - huit cents stades,
(5) Mutien dit ■quatre cent cinquante milles Romains,
grandeur réelle du lac, répondent aux trois mille six
parce qu’il avoit réduit le compte de trois mille six cents
cents d’Hérodote et de Diodore, par la raison qu’il
stades sur le pied de huit au mille. Pline porte à deux
existoit une espèce de schcene de trente stades et un
cent cinquante milles ce périmètre; ce qui est un peu
grand schoene de soixante; le petit schcene a été confondu
plus que le double d e l'étendue réelle, apparemment
avec le grand, et un stade avec l’autre.