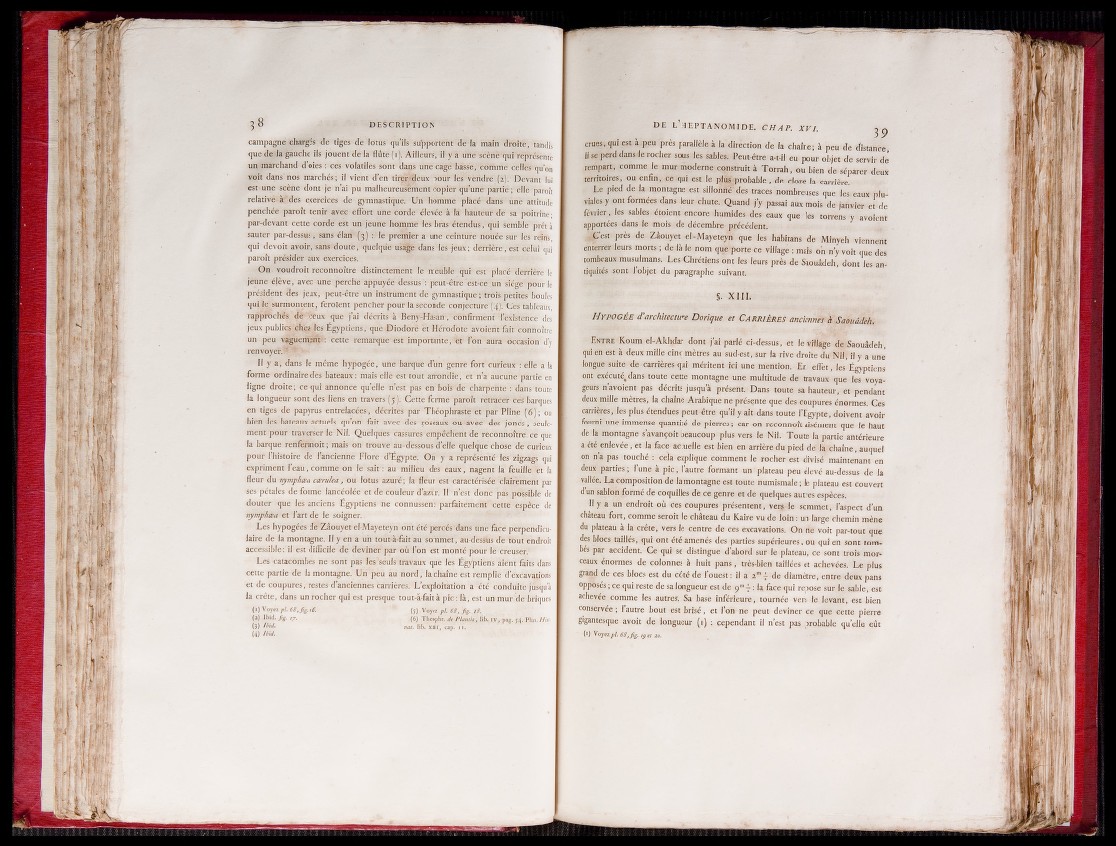
campagne chargés de tiges de lotus qu’ils supportent de la main droite, tandis
que de la gauche ils jouent de la flûte (i). Ailleurs, il y a une scène qui représente
un marchand d oies : ces volatiles sont dans une cage basse, comme celles q u ’on
voit dans nos marchés; il vient d’en tirer'deux pour les vendre (2). Devant lui
est une scène dont je n’ai pu malheureusement copier qu’une partie ; elle paroît
relative à des exercices de gymnastique. Un homme placé dans une attitude
penchée paroît tenir avec effort une corde élevée à là hauteur de sa poitrine;
par-devant cette corde est un jeune homme les bras étendus, qui semble prêt à
sauter par-dessus, sans élan (3) ; le premier a une ceinture nouée sur les reins,
qui devoit avoir, sans doute, quelque usage dans les jeux; derrière, est celui qui
paroît présider aux exercices.
On voudrait reconnoîtrè distinctement le meuble qui est placé derrière le
jeune élève, avec une perche appuyée dessus : peut-être est-ce un siège pour le
président des jeux, peut-être un instrument de gymnastique ; trois petites boules
qui le surmontent, feraient pencher pour la seconde conjecturé ( d j . Ces tableaux,
rapprochés de ceux que j’ai décrits à Beny-Hasan , confirment l’existence des
jeux publics chez les Egyptiens, que Diodorê et Hérodote avoient fait connoîcre
un peu vaguement : cette remarque est importante, et l’on aura occasion d’y
renvoyer.?!^
Il y a, dans le même hypogée, une barque d’un genre fort curieux : elle a la
forme ordinaire des bateaux: mais elle est tout arrondie, et n’a aucune partie en
ligne droite; ce qui annonce qu’elle n’est pas en bois de charpente : dans toute
la longueur sont des liens en travers (y). Cette forme paroît retracer ces barques
en tiges de papyrus entrelacées, décrites par Théophraste et par Pline (6); ou
bien les bateaux actuels qu’on fait avec des yoseaux ou avec des jonés, seulement
pour traverser le Nil. Quelques cassures empêchent de reconnoître. ce que
la barque renferinoit ; mais on trouve au-dessous d’elle quelque chose de curieux
pour I histoire de 1 ancienne Flore d’Égypte. On y a représenté les' zigzags qui
expriment 1 eau, comme on le sait : au milieu des eaux, nagent la feuille et la
fleur du nymphæa cærulea, ou lotus azuré ; la fleur est caractérisée clairement par
ses pétales de forme lancéolée et de couleur d’azur. Il n’est donc pas possible de
douter que les anciens Égyptiens ne connussent parfaitement cette espèce de
nymphæa et l’art de le soigner.
Les hypogées de Zâouyet el-Mayeteyn ont été percés dans une face perpendiculaire
de la montagne. Il y en a un tout-à-fait au sommet, au-dessüs de tout endroit
accessible: il est difficile de deviner par où l’on est monté pour le creuser.
Les catacombes ne sont pas les 'seuls travaux que les Égyptiens aient faits dans
cette partie de la montagne. Un peu au nord, la chaîne est remplie d’excavations
et de coupures, restes d’anciennes carrières. L ’exploitation a été conduite jùsciua
la crête, dans un rocher qui est presque tout-a-fait à pic : là, est un mur de briques
(1) Voyez pl. 6S,f,g. ,S. ' (5) Voyez p i 68, Jîg.jS.
(2) lbid. ,y.
(3) nu.
(4) lbid.
(6) Theophr. de P l a n u s , lib. i v , pag. 5 4 . Plin. Hisi.
nat. lib. x i i i , cap. 11.
WjWPi
crues, qui est à peu près parallèle à la direction de la chaîne; à peu de distance
il se perd dans le rocher sous les sables. Peut-être a-t-il eu pour objet de servir dé
rempart, comme le mur moderne construit à Torrah, ou bien de séparer deux
territoires, ou enfin, ce qui est le plus probable , de clore la carrière.
Le pied de la montagne est sillonné1 des traces nombreuses que les eaux pluviales
y ont formées dans leur chute. Quand j’y passai aux mois de janvier et de
février , les sables étoient encore humides des eaux que les torrens y avoient
apportées dans le mois de décembre précédent.
^ e s t près de Zaouyet el-Mayeteyn que les habftans de Mlnyeh viennent
enterrer leurs morts ; de là le nom que porte ce village : mais on n’y voit que des
tombeaux musulmans. Les Chrétiens ont les leurs près de Saouâdeh, dont les antiquités
sont l’objet du paragraphe suivant.
§. X I I I .
H y p o g é e d’architecture Dorique et C a r r iè r e s anciennes à Saouâdeh.
E n t r e Koum el-Akhdar dont j’ai parié ci-dessus, et le village de Saouâdeh,
qui en est à deux mille cinq mètres au sud-est, sur la rive droite du Nil, il y a une
longue suite de carrières qui méritent ici une mention. En effet, les Égyptiens
ont exécuté^ dans toute cette montagne une multitude de travaux que les voyageurs
n’avoient pas décrits jusqu’à présent. Dans toute sa hauteur, et pendant
deux mille métrés, la chaîne Arabique ne présente que des coupures énormes. Ces
carrières, les plus étendues peut être qu’il y ait dans toute l’Égypte, doivent avoir
fourni une immense quantité de pierres ; car on reconnoît aisément que le haut
de la montagne s avançoit beaucoup plus vers le Nil. Toute la partie antérieure
a été enlevée, et la face actuelle est bien en arrière du pied de la chaîne, auquel
on n’a pas touché : cela explique comment le rocher est divisé maintenant en
deux parties ; l’une à p ic , l’autre formant un plateau peu élevé au-dessus de la
vallée. La composition de la montagne est toute numismale ; le plateau est couvert
d un sablon formé de coquilles de ce genre et de quelques autres espèces.
Il y a un endroit où ces coupures présentent, ver? le sommet, l’aspect d’un
château fort, comme seroit le château du Kaire vu de loin : un large chemin mène
du plateau à la crête, vers le centre de ces excavations. On ne voit par-tout que
des blocs taillés, qui ont été amenés des parties supérieures, ou qui en sont tombés
par accident. Ce qui se distingue d’abord sur le plateau, ce sont trois morceaux
énormes de colonnes à huit pans, très-bien taillées et achevées. Le plus
grand de ces blocs est du côté de 1 ouest: il a 2m -j- de diamètre, entre deux pans
opposés ; ce qui reste de salongueur est de : ]a face qUi repose sur le sable, est
achevée comme les autres. Sa base inférieure, tournée vers le levant, est bien
conservée ; 1 autre bout est brisé, et l’on ne peut deviner ce que cette pierre
gigantesque avoit de longueur (i) : cependant il n’est pas probable qu’elle eût
(0 Voyez pl. 68,fig. /p et 2o.