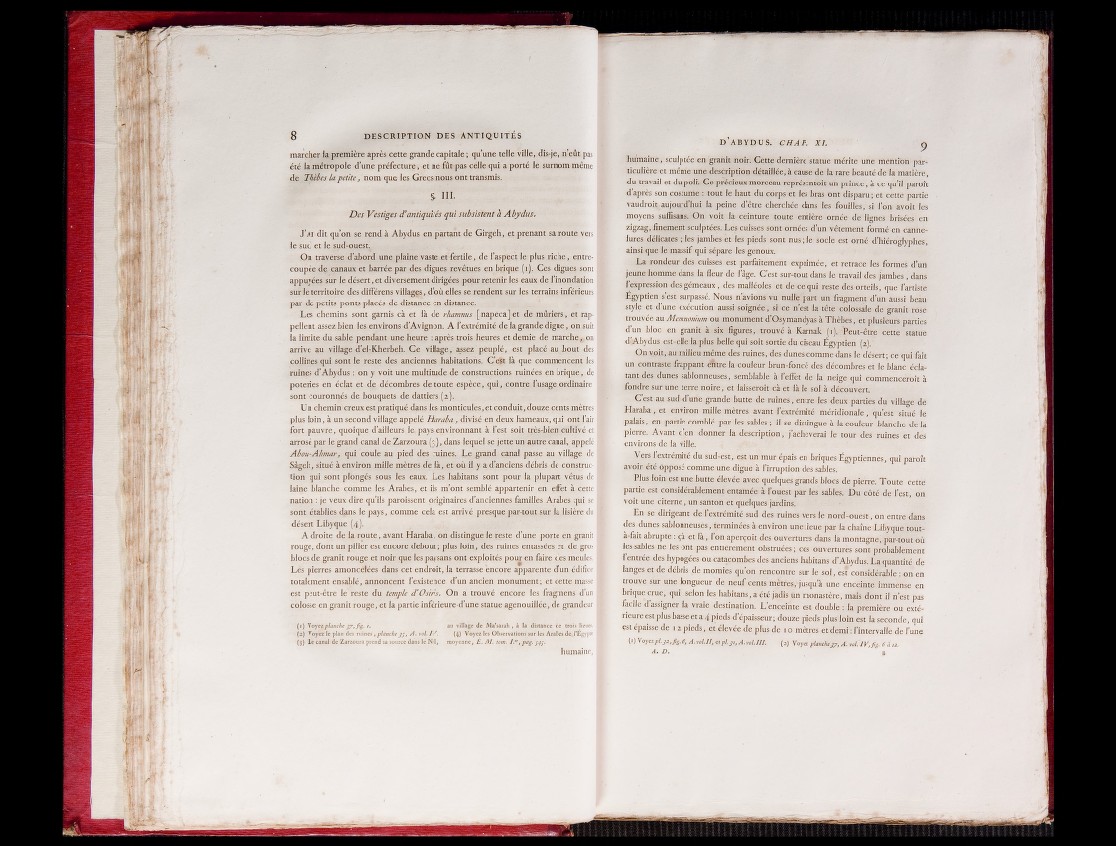
marcher la première après cette grande capitale ; qu’une telle ville, dis-je, n’eût pas
été la métropole d’une préfecture, et ne fût pas celle qui a porté le surnom même
de Thcbes la petite, nom que les Grecs nous ont transmis.
§. III.
Des Vestiges d’antiquités qui subsistent a Abydus.
J ’a i dit qu’on se rend à Abydus en partant de Girgeh, et prenant sa route vers
le sud et le sud-ouest.
On traverse d’abord une plaine vaste et fertile, de l’aspect le plus riche, entrecoupée
de canaux et barrée par des digues revêtues en brique (i). Ces digues sont
appuyées sur le désert, et diversement dirigées pour retenir les eaux de l’inondation
sur le territoire des différens villages, d’où elles se rendent sur les terrains inférieurs
par de petits ponts placés de distance en distance.
Les chemins sont garnis cà et là de rhamnus [napecajet de mûriers, et rappellent
assez bien les environs d’Avignon. A l’extrémité de la grande digue, on suit
la limite du sable pendant une heure : après trois heures et demie de marche, on
arrive au village d’el-Kherbeh. C e village, assez peuplé, est placé au bout des
collines qui sont le reste des anciennes habitations. C ’est là que commencent les
ruines d’Abydus : on y voit une multitude de constructions ruinées en brique, de
poteries en éclat et de décombres de toute espèce, qui, contre l’usage ordinaire
sont couronnés de bouquets de dattiers (z).
Un chemin creux est pratiqué dans les monticules, et conduit, douze cents mètres
plus loin, à un second village appelé Haraba, divisé en deux hameaux, qui ont l’air
fort pauvre, quoique d’ailleurs le pays environnant à l’est soit très-bien cultivé et
arrosé par le grand canal de Zarzoura (3 ), dans lequel se jette un autre canal, appelé
Abou-Alimar, qui coule au pied des ruines. Le grand canal passe au village de
Sâgeh, situé à environ mille mètres de là, et où il y a d’anciens débris de construction
qui sont plongés sous les eaux. Les habitans sont pour la plupart vêtus de
laine blanche comme les Arabes, et ils m’ont semblé appartenir en effet à cette
nation : je veux dire qu'ils paroissent originaires d’anciennes familles Arabes qui se
sont établies dans le pays, .comme cela est arrivé presque par-tout sur la lisière du
désert Libyque (4).
A droite de la route, avant Haraba, on distingue le reste d’une porte en granit
rouge, dont un pilier est encore debout; plus loin, des ruines entassées et de gros
blocs de granit rouge et noir que les paysans ont exploités pour en faire des meules.
Les pierres amoncelées dans cet endroit, la terrasse encore apparente d’un édifice
totalement ensablé, annoncent l’existence d’un ancien monument; et cette masse
est peut-être le reste du temple d'Osiris. On a trouvé encore les fragmens d’un
colosse en granit rouge, et la partie inférieured’une statue agenouillée, de grandeur
(1) Voyezplanche 37,fig. ¡. au village de Ma'sarah , à la distance de trois lieues.
(2) Voyez le plan des ruines, planche35, A . vol. IV . (4) Voyez les Observations sur les Arabes de l’Egypte
{3) Le canal de Zarzoura prend sa source dans le Nil, moyenne, E. M . rom. I.,r ,pag. jsf-f i
d ’ a B Y D US . CHAP. XI. rt
humaine, sculptée en granit noir. Cette dernière statue mérite une mention particulière
et même une description détaillée, à cause de la rare beauté de la matière,
du travail et du poli. Ce précieux morceau représentoit un prince, à ce qu’il paroît
d’après son costume : tout le haut du corps et les bras ont disparu; et cette partie
vaudrait aujourd’hui la peine d’être cherchée dans les fouilles, si l’on avoit les
moyens suffisans. On voit la ceinture toute entière ornée de lignes brisées en
zigzag, finement sculptées. Les cuisses sont ornées d’un vêtement formé en cannelures
délicates ; les jambes et les pieds sont nus ; le socle est orné d’hiéroglyphes,
ainsi que le massif qui sépare les genoux.
La rondeur des cuisses est parfaitement exprimée, et retrace les formes d’un
jeune homme dans la fleur de l’âge. C’est sur-tout dans le travail des jambes , dans
l’expression des gémeaux, des malléoles et de ce qui reste des orteils, que l’artiste
Egyptien s’est surpassé. Nous n’avions vu nulle part un fragment d’un aussi beau
style et d’une exécution aussi soignée, si ce n’est la tête colossale de granit rose
trouvée au Memnomum ou monument d’Osymandyas à Thèbes, et plusieurs parties
d’un bloc en granit à six figures, trouvé à Karnak (t). Peut-être cette statue
d ’Abydus est-elle la plus belle qui soit sortie du ciseau Égyptien (z).
On voit, au milieu même des ruines, des dunes comme dans le désert; ce qui fait
un contraste frappant éfttre la couleur brun-foncé des décombres et le blanc éclatant
des dunes sablonneuses, semblable à l’effet de la neige qui commenceroit à
fondre sur une terre noire, et laisseroit cà et là le sol à découvert.
C ’est au sud d’une grande butte de ruines, entre les deux parties du village dé
Haraba, et environ mille mètres avant l’extrémité méridionale, qu’est situé lé
palais, en partie comblé par les sables; il se distingue à la couleur blanche delà
pierre. Avant d’en donner la description, j’acheverai le tour des ruines et des
environs de la ville.
Vers 1 extiemite du sud-est, est un mur épais en briques Égyptiennes, qui paroît
avoir été ôpposé comme une digue à l’irruption des sables.
Plus loin est une butte élevée avec quelques grands blocs de pierre. Toute cette
partie est considérablement entamée à l’ouest par les sables. Du côté de l’est, on
voit une citerne, un santon et quelques jardins.
En se dirigeant de 1 extrémité sud des ruines vers le nord-ouest, on entre dans
des dunes sablonneuses, terminées à environ une lieue par la chaîne Libyque tout-
a-fait abiupte : çà et la1 1 on aperçoit des ouvertures dans la montagne, par-tout où
les sables ne les ont pas entièrement obstruées; ces ouvertures sont probablement
l’entrée des hypogées ou catacombes des anciens habitans d’Abydus. La quantité de
langes et de débris de momies qu’on rencontre sur le sol, est considérable : on en
trouve sur une longueur de neuf cents mètres, jusqu’à une enceinte immense en
brique crue, qui, selon les habitans, a été jadis un monastère, mais dont il n’est pas
facile d assigner la vraie destination. L ’enceinte est double : la première ou extérieure
est plus basse et a 4 pieds d épaisseur; douze pieds plus loin est la seconde, qui
est épaisse de i z pieds, et élevée de plus de i o mètres et demi : l’intervalle de l’une
(i) Vo yezpl.j2,fis . e, A.voL/Ij a p l.ji,A .v o l.U I . (2) Voyez planchtjp, A. m l.'lV .fg - 6 à a .
A. D . B