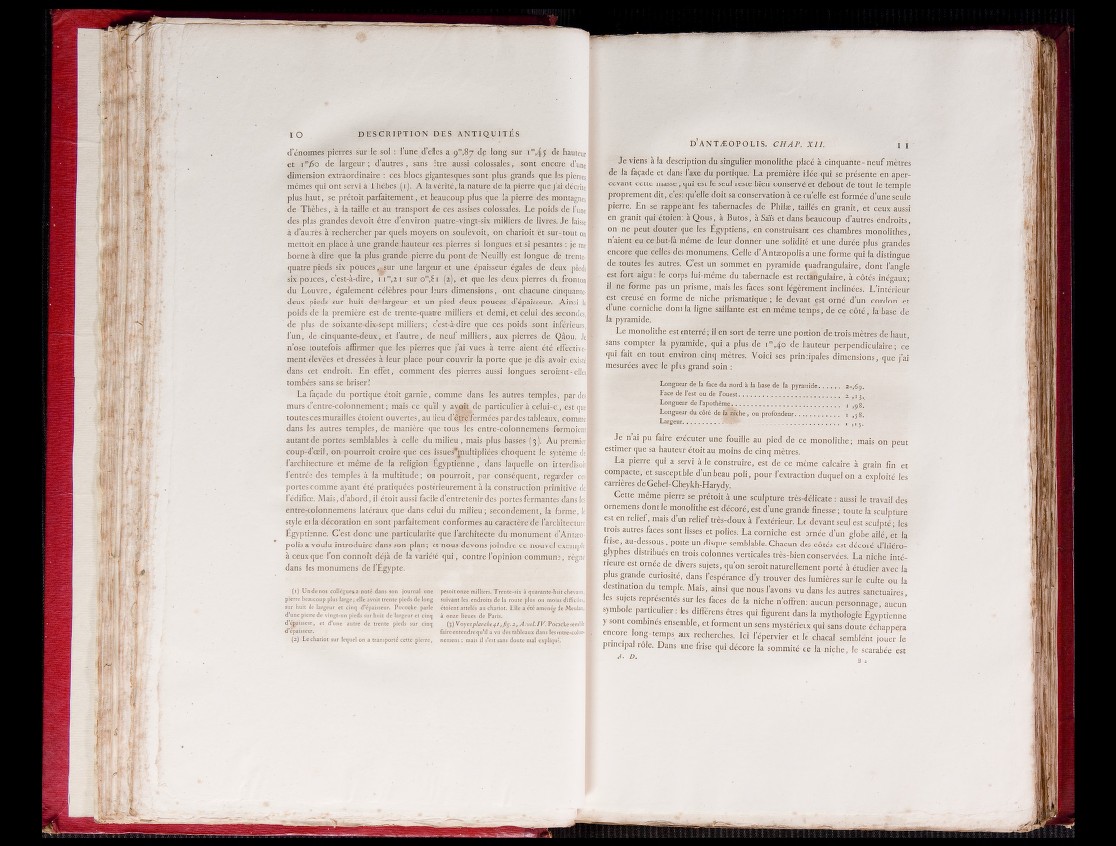
d’énormes pierres sur le sol : l’une d’elles a 9”,87 de long sur im,4y de hauteur!
et i ”,6o de largeur; d’autres, sans être aussi colossales, sont encore d’une|
dimension extraordinaire : ces blocs gigantesques sont plus grands que les pierres |
mêmes qui ont servi àThèbes (1). A la vérité, la nature de la pierre que j’ai décrite |
plus haut, se prêtoit parfaitement, et beaucoup plus que la pierre des montagnes!
de Thèbes, à la taille et au transport de ces assises colossales. Le poids de l'une |
des plus grandes devoit être d’environ quatre-vingt-six milliers de livres. Je laisse I
à d’autres à rechercher par quels moyens on souievoit, on charioit ’èt sur-tout on I
mettoit en place à une grande hauteur ces pierres si longues et si pesantes : je mel
borne à dire que la plus grande pierre du pont de Neuilly est longue de trente-1
quatre pieds six pouces ,>sur une largeur et une épaisseur égales de deux pieds I
six pouces, c’est-à-dire, 1 1",21 sur o'",81 (2), et que les deux pierres du frontonI
du Louvre, également célèbres pour leurs dimensions, ont chacune cinquante!
deux pieds sur huit de/-largeur et un pied deux pouces d’épaisseur. Ainsi Ici
poids de la première est de trente-quatre milliers et demi, et celui des secondes,!
de plus de soixante-dix-sept milliers; c’est-à-dire que ces poids sont inférieurs,!
l’un, de cinquante-deux, et l’autre, de neuf milliers, aux pierres de Qâou. Jej
n’ose toutefois affirmer que les pierres que j’ai vues à terre aient été effective-!
ment élevées et dressées à leur place pour couvrir la porte que je dis avoir existe!
dans cet endroit. En effet, comment des pierres aussi longues seraient-ellesI
tombées sans se briser!
La façade du portique étoit garnie, comme dans les autres temples, par des!
murs d’entre-colonnement ; mais ce qu’il y avait de particulier à celui-ci, est quel
toutes ces murailles étoient ouvertes, au lieu d’êtfe'fermées pardes tableaux, comme!
dans les autres temples, de manière que tous les entre-colonnemens formoient!
autant de portes semblables à celle du milieu, mais plus basses (3). Au premier
coup-d’oe il, on pourroit croire que ces issuesPmultipliées choquent le système de
l’architecture et même de la religion Egyptienne, dans laquelle on interdisoit
l’entrée des temples à la multitude; on pourroit, par conséquent, regarder ces
portes comme ayant été pratiquées postérieurement à la construction primitive de
l’édifice. Mais, d’abord, il étoit aussi facile d’entretenir des portes fermantes dans les
entre-colonnemens latéraux que dans celui du milieu; secondement, la forme, le
style et la décoration en sont parfaitement conformes au caractère de l’architecture
Egyptienne. C ’est donc une particularité que l’architecte du monument d’Antæo-
polis a voulu introduire dans son plan; et nous devons joindre ce nouvel exemple
à ceux que l’on connoît déjà de la variété qui, contre l’opinion commune, règne
dans les monumens de l’Egypte.
(1) Un'de nos collègues a noté dans son journal une pesoitonze milliers. Trente-six à quarante-huit chevaux,!
pierre beaucoup plus large ; elle avoit trente pieds de long suivant les endroits de la route plus ou moins difficiles,]
sur huit de largeur et cinq d’épaisseur. Pocooke parle étoient attelés au chariot. Elle a été amenée de Meulan, I
d’une pierre de vingt-un pieds sur huit de largeur et cinq à onze lieues de Paris,
d’épaisseur, et d’une autre de trente pieds sur cinq (3) Voyeiplanchc+l¿fig.2, A.'vol.IV. Pocockesemble I
d épaisseur. faire entendre qu’il a vu des Tableaux dans les entrc-colon« I
(2) Le chariot sur lequel on a transporté cette pierre, nemens ; mais il s’est sans doute mal expliqué.
Je viens à la description du singulier monolithe placé à cinquante-neuf mètres
de la façade et dans l’axe du portique. La première idée qui se présente en apercevant
cette masse, qui est le seul reste bien conservé et debout de tout le temple
proprement dit, c’est qu’elle doit sa conservation à ce qu’elle est formée d’une seule
pierre. En se rappelant les tabernacles de Philæ, taillés en granit, et ceux aussi
en granit qui étoient àQous, à Butos, à Sais et dans beaucoup d’autres éndroits,
on ne peut douter que les Égyptiens, en construisant ces chambres monolithes,
n’aient eu ce but-là même de leur donner une solidité et une durée plus grandes
encore que celles des monumens. Celle d’Antæopolis a une forme qui la distingue
de toutes les autres. Cest un sommet en pyramide quadrangulaire, dont l’angle
est fort aigu: le corps lui-même du tabernacle est rectangulaire, à côtés inégaux;
il ne forme pas un prisme, mais les faces sont légèrement inclinées. L ’intérieur
est creusé en forme de niche prismatique ; lé devant est orné d’un cordon et
d une corniche dont la ligne saillante est en même temps, de ce côté , la base de
la pyramide.
Le monolithe est enterré ; il en sort de terre une portion de trois mètres de haut
sans compter la pyramide, qui a plus de i ” ,4o de hauteur perpendiculaire; ce
qui fait en tout environ, cinq mètres. Voici ses principales dimensions, que j’ai
mesurées avec le plus grand soin :
Longueur de la face du nord à la base de la pyramide 2 .,dp.
Face de l’est ou de l’ouest.................................................................. 2 , ,
Longueur de l’apothème. ................................................................. , „ g .
Longueur du côté de la niche, ou profondeur................................ 1 ,58.
Largeur........................ ............................................................................... , , ,3 .
Je n ai pu faire exécuter une fouille au pied de ce monolithe ; mais on peut
estimer que sa hauteur étoit au moins de cinq mètres.
La pierre qui a servi à le construire, est de ce même calcaire à grain fin et
compacte, et susceptible d un beau poli, pour l’extraction duquel on a exploité les
carrières deGebel-Cheykh-Harydy.
Cette même pierre se prêtoit à une sculpture très-délicate : aussi le travail des
ornemens dont le monolithe est décoré, est d’une grande finesse ; toute la sculpture
est en relief, mais d’un relief très-doux à l’extérieur. Le devant seul est sculpté ; les
trois autres faces sont lisses et polies. La corniche est ornée d’un globe ailé, et la
frise, au-dessous , porte un disque semblable. Chacun des côtés est décoré d’hiéroglyphes
distribués en trois colonnes verticales très-bien conservées. La niche intérieure
est ornee de divers sujets, qu’on serait naturellement porté à étudier avec la
plus grande curiosité, dans l’espérance d’y trouver des lumières sur le culte ou la
destination du temple. Mais, ainsi que nous l’avons vu dans les autres sanctuaires
les sujets représentés sur les faces dê la niche n’offrent aucun personnage, aucun
symbole particulier : les différens êtres qui figurent dans la mythologie Égyptienne
y sont combinés ensemble, et forment un sens mystérieux qui sans doute échappera
encore ong-temps aux recherches. Ici l’épervier et le chacal semblent jouer le
puncipal rôle. Dans une frise qui décore la sommité de la niche, le scarabée est
D - B 2