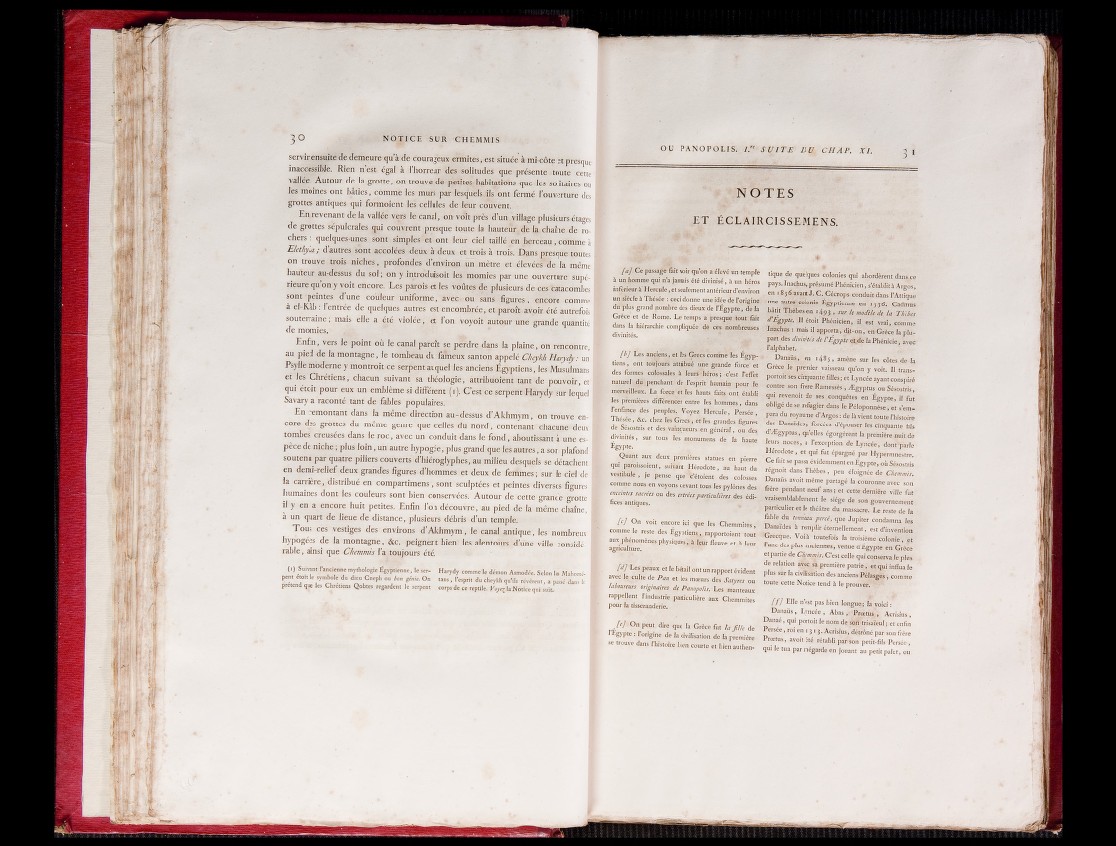
servir ensuite de demeure qu’à de courageux ermites, est située à mi-côte et presque
inaccessible. Rien n est égal a i horreur des solitudes que présente toute cette
vallée. Autour de la grotte, on trouve de petites habitations que les solitaires ou
les moines ont bâties, comme les murs par lesquels ils ont fermé l’ouverture des
grottes antiques qui formoient les cellules de leur couvent.
En revenant de la vallee vers le canal, on voit près d’un village plusieurs étages
de grottes sépulcrales qui couvrent presque toute la hauteur de la chaîne de rochers
: quelques-unes sont simples et ont leur ciel taillé en berceau, comme à
Eletlyla; d autres sont accolées deux à deux et trois à trois. Dans presque tomes
on trouve trois niches, profondes d’environ un mètre et élevées"de la même
hauteur au-dessus du sol ; on y introduisoit les momies par une ouverture supérieure
qu on y voit encore. Les parois et les voûtes de plusieurs de ces catacombes
sont peintes d’une co'uleur uniforme, avec ou sans figures, encore comme
à el-Kâb : l’entrée de quelques autres est encombrée, et paroit.avoir été autrefois
souterraine ; mais elle a été violée, et l’on voyoit autour une grande quantité
de momies.
Enfin, vers le point ou le canal paroît se perdre dans la plaine, on rencontre,
au pied de la montagne, le tombeau du fameux santon appelé Chykh Harydy: un
Psylle moderne y montroit ce serpent auquel les anciens Égyptiens, les Musulmans
et les Chrétiens, chacun suivant sa théologie, attribuoient tant de pouvoir, et
qui étoit pour eux un emblème si différent (i). C ’est ce serpent Harydy sur lequel
Savary a raconte tant de fables populaires.
En remontant dans la même direction au-dessus d’Akhmym, on trouve en- j
core des grottes du meme genre que celles du nord, contenant chacune deux
tombes creusées dans le roc, avec un conduit dans le fond, aboutissant à une espèce
de niche ; plus loin, un autre hypogée, plus grand que les autres, a son plafond I
soutenu par quatre piliers couverts d’hiéroglyphes, au milieu desquels se détachent j
en demi-relief deux grandes figures d’hommes et deux de femmes ; sur le ciel de I
la carrière, distribué en compartimens, sont sculptées et peintes diverses figures I
humaines dont les couleurs sont bien conservées. Autour de cette grande grotte I
il y en a encore huit petites. Enfin l’on découvre, au pied de la même chaîne, I
à un quart de lieue de distance, plusieurs débris d’un temple.
Tous ces vestiges des environs d’Akhmym, le canal antique, les nombreux I
hypogées de la montagne, &c. peignent bien les alentours d’une ville considé- I
table, ainsi que Chemmis l’a toujours été.
(.) Suivant l’ancienne mythologie Égyptienne, le ser- Harydy comme le démon Asmodée. Selon les Mal,orné- I
peut étoit le symbole du dieu Cneph ou bon génie. On tans, l’esprit du cheykh qu’ils révèrent, a passé dans le I
prétend que les Chrétiens Qobtes regardent le serpent corps de ce reptile. Yo/<z la Notice qui suit.
N O T E S
E T É C L A IR C I S S EM E N T
[ a ] C e passage fait voir qu’on a élevé un temple
à un homme qui n’a jamais été divinisé, à un héros
inférieur k' HercuJe, et seulement antérieur d’environ
un siècfe à Thésée : ceci donne une idée de l ’origine
du plus grand nombre des dieux de I’É g ypte, de la
Grèce et de Rome. L e temps a presque tout fait
dans la hiérarchie compliquée de ces nombreuses
divinités.
[ b ] Les anciens, et les Grecs comme les É gyp tiens
, ont toujours attribué une grande force’ et
des formes colossales à leurs héros ; c’est f effet
naturel du penchant de l'esprit humain pour ie
merveilleux. La force et les hauts faits ont établi
les premières différences entre les hommes, dans
l’eniance des peuples. Voyez Hercule, P ersée,
Thésée, &c. chez les Grecs , et les grandes ligures
de Sésostris et des vainqueurs en général, ou des.
divinités, sur tous les monumens de la haute
Egypte.
Quant aux deux premières statues en pierre
qui paroissoient, suivant Hérodote, au haut du
vestibule , je pense que’V étoient des colosses
comme nous en voyons devant tous les pylônes des
enceintes sacrées ou des entrées particulières des édifices
antiques.
[ c ] O n voit encore ici que les Chemmites,
comme le reste des Égyptiens,, rapportoient tout
aux phénomènes physiques ¿ à leur fleuve et à leur
agriculture.
[ d ] Les peaux et le bétail ont un rapport évident
avec le culte de Pan et les moeurs des Satyres ou
laboureurs originaires de Panopolis. Les manteaux
rappellent l'industrie particulière aux Chemmites
pour la tisseranderie.
[ t ] On peut dire que la Grèce fut la f i lle de
l’Egypte : l ’origine de la civilisation de la première
se trouve dans l’histoire bien courte et bien authentique
de quelques colonies qui abordèrent dans ce
pays.Inachus,présumé Phénicien, s’élablità Argos,
en i 8 5 (S avant J. C . Cécrops conduit dans J’Attique
une autre colonie Égyptienne en 1556. Cadmus
bâtit Thèbes en t/tpj , sur le modèle de la Thèbes
d Egypte. 11 étoit Phénicien, il est vrai, comme
Inachus : mais il apporta, dit-on, en Grèce la plupart
des divinités de l ’Égypte el.de la Phénicie, avec
l’alphabet.
Danaüs, en 1485, amène sur les côtes de la
Grèce le premier vaisseau qu’on y voit. Il trans-
portoit ses cinquante filles; et Lyncée ayant conspiré
contre son frère Ramessès , Ægyptus ou Sésostris,
qui revenoit de ses conquêtes en É g yp te , il fut
obligé de se réfugier dans le Péloponnèse, et s’empara
du royaume d'Argos: de là vient toute l'histoire
des Danaïdes, forcées d’épouser les cinquante fils
d’Æ gyptus, qu’elles égorgèrent la première nuit.de
leurs noces, à l’exception de Lyncé e, dont’parle
Hérodote, et qui fût épargné par Hypermnestre.
C e fait se passa évidemment en É g yp te , où Sésostris
régnott dans T h èb e s , peu éloignée de Chemmis.
Danaiis avoit même partagé la couronne avec son
frère pendant neuf ans; et cette dernière ville fut
vraisemblablement le siège de son gouvernement
particulier et le théâtre du massacre. Le reste de la
fable du tonneau percé, que Jupiter condamna les
Danaïdes à remplir éternellement, est d’invention
-Grecque. Voilà toutefois la troisième colon ie , et
Tune des plus anciennes, venue d’Égypte en Grèce
et partie de Chemmis. C ’est celle qui conserva le plus
de relation avec sa première patrie , et qui influa le
plus sur la civilisation des anciens P é lasge s , comme
toute cette Notice tend à le prouver. '
[ f ] Elle n est pas bien longue ; la voici :
Danaüs, L y n c é e , Abas , Proètus , Acrisius ,
Danaé, qui portoit le nom de son trisaïeul ; et enfin
P ersée, roi en 13 1 3. A crisius, détrôné par son frère
Proetus, avoit été rétabli par son petit-fils Persée,
qui le tua par mégarde en jouant au petit palet, ou