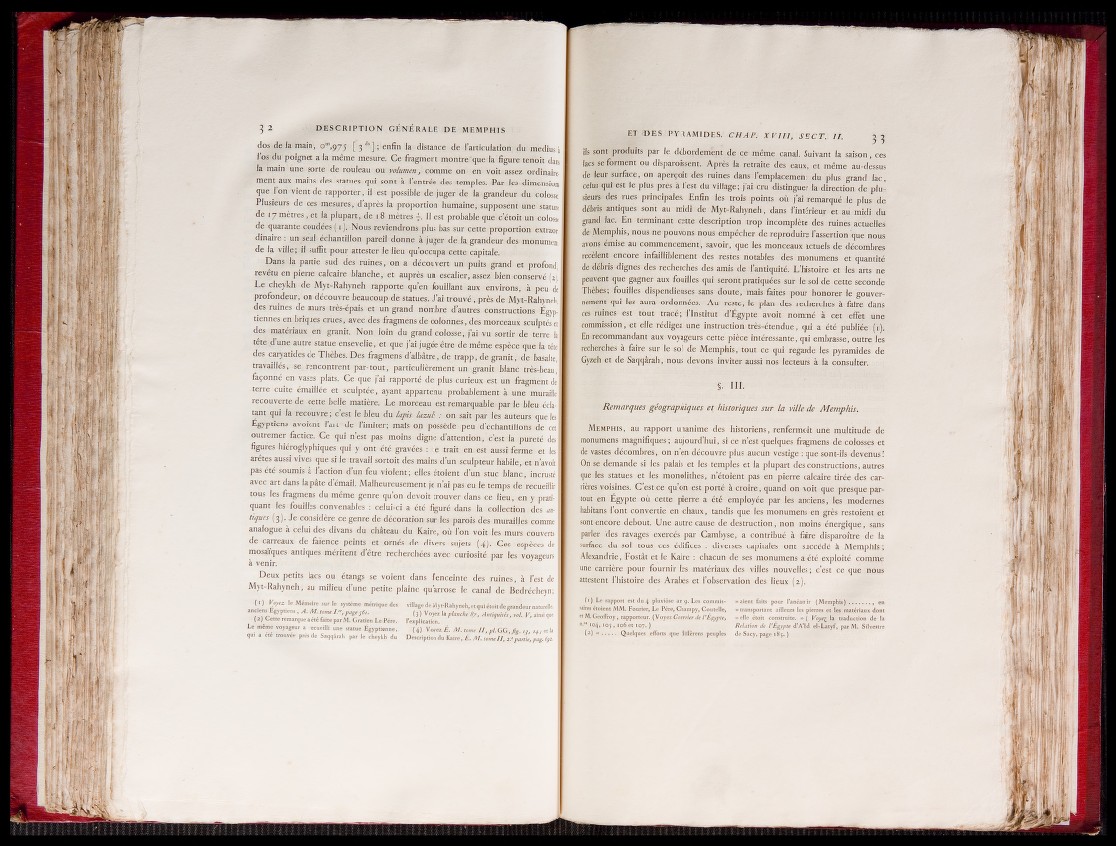
DE SCRIPTION GENERALE DE MEMPHIS
dos de la main, om,97J [ 3 d‘ ] ; enfin ia distance de l’articulation du médius à
1 os du poignet a la même mesure. Ce fragment montre'que la figure tenoit dans
la main une sorte de rouleau ou volumen, comme on en voit assez ordinairement
aux mains des statues qui sont à l’entrée des temples. Par les dimensions
que l’on vient de rapporter, il est possible de juger de la grandeur du colosse.
Plusieurs de ces mesures, d’après la proportion humaine, supposent une stature
de 17 mètres , et la plupart, de 18 mètres A, Il est probable que c’étoit un colosse
de quarante coudées ( 1 ). Nous reviendrons plus bas sur cette proportion extraordinaire
: un seul échantillon pareil donne à juger de fa grandeur des monumens
de la ville; il suffit pour attester le lieu qu’occupa cette capitale.
Dans la partie sud des ruines, on a découvert un puits grand et profond,
revetu en pierre calcaire blanche, et auprès un escalier, assez bien conservé (ai
L e cheykh de Myt-Rahyneh rapporte qu’en fouillant aux environs, à peu de
profondeur, on découvre beaucoup de statues. J’ai trouvé, près de Myt-Rahyneh,
des ruines de murs très-épais et un grand nombre d’autres constructions Égyptiennes
en briques crues, avec des fragmens de colonnes, des morceaux sculptés et
des matériaux en granit. Non loin du grand colosse, j’ai vu sortir de terre la
tête d’une autre statue ensevelie, et que j’ai jugée être de même espèce que la tête
des caryatides de Thèbes. Des fragmens d’albâtre, de trapp, de granit, de basalte,
travaillés, se rencontrent par-tout, particulièrement un granit blanc très-beau,
façonné en vases plats. Ce que j’ai rapporté de plus curieux est un fragment de I
terre cuite émaillée et sculptée, ayant appartenu probablement à une muraille I
recouverte de cette belle matière. Le morceau est remarquable par le bleu écla- I
tant qui la recouvre; cest le bleu du lapis lazuli : on sait par les auteurs que les I
Égyptiens avoient lart de limiter; mais on possède peu d’échantillons de cet I
outremer factice. Ce qui n’est pas moins digne d’attention, c’est la pureté des I
figures hiéroglyphiques qui y ont été gravées ; le trait en. est aussi ferme et les I
arêtes aussi vives que si le travail sortoit des mains d’un sculpteur habile, et n’avoit I
pas été soumis à 1 action dun feu violent; elles étoient d’un stuc blanc, incrusté I
avec art dans la pâte d’émail. Malheureusement je n’ai pas eu le temps de recueillir I
tous les fragmens du même genre qu’on devoit trouver dans ce lieu, en y prati- I
quant les fouilles convenables : celui-ci a été figuré dans la collection des an- I
tiques (3). Je considère ce genre de décoration sur les parois des murailles comme I
analogue a celui des divans du château du Kaire, où l’on voit les murs couverts I
de carreaux de faïence peints et ornés de divers sujets (4). Ces espèces de I
mosaïques antiques méritent d’être recherchées avec curiosité par les voyageurs I
à venir.
Deux petits lacs ou étangs se voient dans l’enceinte des ruines, à l’est de I
Myt-Rahyneh, au milieu d’une petite plaine qu’arrose le canal de Bedrécheyn; I
( 1 ) Voyez le Mémoire sur le système métrique des
anciens Egyptiens , A . M. tome / ." page 561.
(2) Cette remarque a été faite par M. Gratien Le Père.
Le même voyageur a recueilli une statue Égyptienne,
qui a été trouvée près de Saqqârah par le cheykh du
village de Myt*Rahyneh, et qui étoit de grandeur naturelle.
(3) Voyez la planche 8 7 , Antiquités, vol. V» ainsi que
l’explication.
( 4 ) Voyez É . M . tome I I , p l.G G ,J ig . i j , tq ; et la
Description du Kaire, £. M . tome II, 2 /partie, pag. 691.
ds sont produits par le débordement de ce même canal. Suivant la saison, ces
lacs se forment ou disparoissent. Après la retraite des eaux, et même au-dessus
de leur surface, on aperçoit des ruines dans l’emplacement du plus grand lac,
celui qui est le plus près à l’est du village; j’ai cru distinguer la direction de plusieurs
des rues principales. Enfin les trois points où j’ai remarqué le plus de
débris antiques sont au midi de Myt-Rahyneh, dans l’intérieur et au midi du
grand lac. En terminant cette description trop incomplète des ruines actuelles
de Memphis, nous ne pouvons nous empêcher de reproduire l’assertion que nous
avons émise au commencement, savoir, que les monceaux actuels de décombres
recèlent encore infailliblement des restes notables des monumens et quantité
de débris dignes des recherches des amis de 1 antiquité. L ’histoire et les arts ne
peuvent que gagner aux fouilles qui seront pratiquées sur le sol de cette seconde
Thebes, fouilles dispendieuses sans doute, mais faites pour honorer le gouvernement
qui les aura ordonnées. A u reste, le plan des recherches à faire dans
ces ruines est tout tracé; 1 Institut d’Égypte avoit nommé à cet effet une
commission, et elle rédigea une instruction très-étendue, qui a été publiée (t).
En recommandant aux voyageurs cette pièce intéressante, qui embrasse, outre les
recherches a faire sur le sol de Memphis, tout ce qui regarde les pyramides de
Gyzeh et de Saqqârah, nous devons inviter aussi nos lecteurs à la consulter.
§. III.
Remarques géographiques et historiques sur la ville de Memphis.
M e m p h i s , au rapport unanime des historiens, renfermoit une multitude de
monumens magnifiques; aujourdhui, si ce n’est quelques fragmens de colosses et
de vastes décombres, on n’en découvre plus aucun vestige : que sont-ils devenus!
On se demande si les palais et les temples et la plupart des constructions, autres
que les statues et les monolithes, n’étoient pas en pierre calcaire tirée des carrières
voisines. C est ce qu’on est porté à croire, quand on voit que presque partout
en Égypte où cette pierre a été employée par les anciens, les modernes
habitans lont convertie en chaux, tandis que les monumens en grès restoient et
sont encore debout. Une autre cause de destruction, non moins énergique, sans
parler des ravages exercés par Cambyse, a contribué à faire disparoître de la
surface du sol tous ces édifices : diverses capitales ont succédé à Memphis ;
Alexandrie, Fostât et le Kaire : chacun de ses monumens a été exploité comme
une carrière pour fournir les matériaux des villes nouvelles ; c’est ce que nous
attestent l’histoire des Arabes et l’observation des lieux (2).
Í 1 ) Le rapport est du 4 pluviôse an 9. Les commissaires
étoient MM. Fourier, Le Père, Champy, Coutelle,
et M. Geoffroy, rapporteur. (Voyez Courrier de l ’Egypte,
n-0' 104, 105, 106 et 107. )
(2) « ......... Quelques efforts que différens peuples
»aient faits pour l’anéantir (Memphis)............... , en
» transportant ailleurs les pierres et les matériaux dont
»elle étoit construite. » ( Voyeç ia traduction de la
Relation de l’Egypte d’A’bd el-Latyf, par M. Silvestre
de Sacy, page 185. )