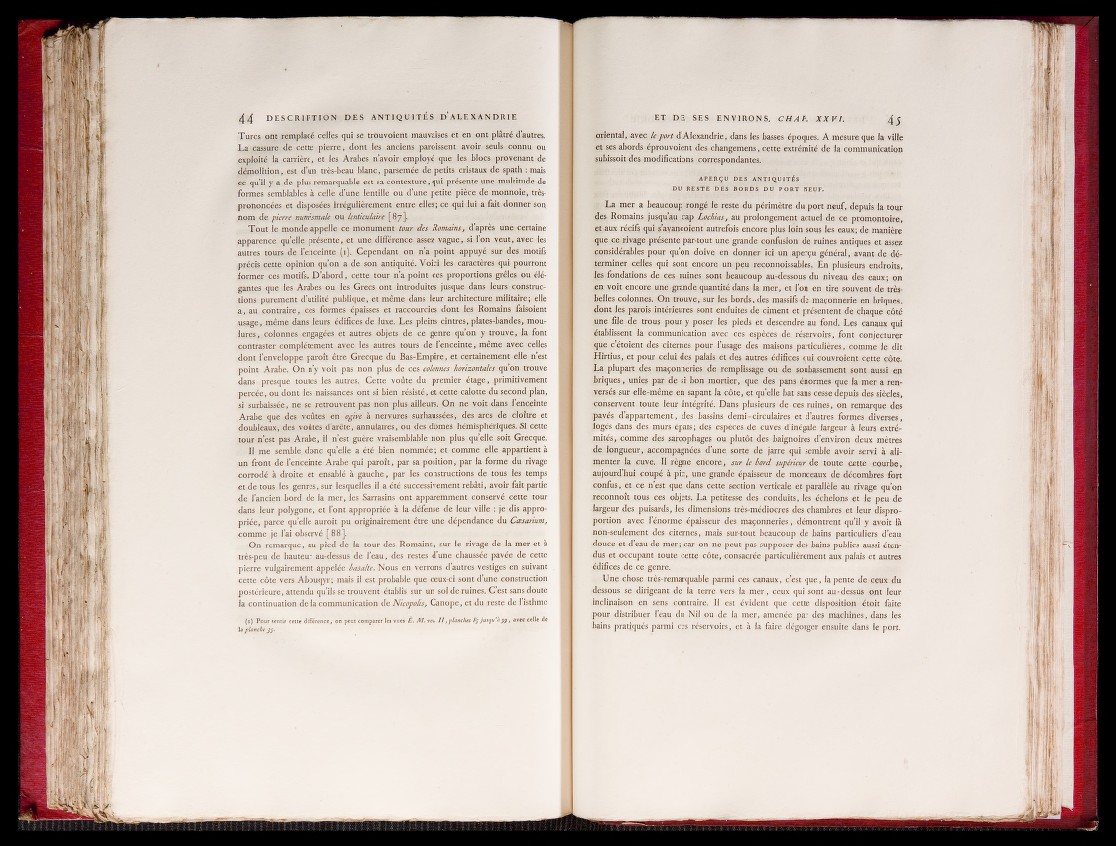
Turcs ont remplacé celles qui se trouvoient mauvaises et en ont plâtré d’autres.
La cassure de cette pierre, dont les anciens paroissent avoir seuls connu ou
exploité la carrière, et les Arabes n’avoir employé que les blocs provenant de
démolition, est d’un très-beau blanc, parsemée de petits cristaux de spath : mais
ce qu’il y a de plus remarquable est sa contexture, qui présente une multitude de
formes semblables à celle d’une lentille ou d’une petite pièce de monnoie, très-
prononcées et disposées irrégulièrement entre elles; ce qui lui a fait donner son
nom de pierre numismale ou lenticulaire [87].
Tout le monde appelle ce monument tour des Romains, d’après une certaine
apparence qu’elle présente, et une différence assez vague,.si l’on veut, avec les
autres tours de l’enceinte (1). Cependant on n’a point appuyé sur des motifs
précis cette opinion qu’on a de son antiquité. Voici les caractères qui pourront
former ces motifs. D ’abord, cette tour n’a point ces proportions grêles ou élégantes
que les Arabes ou les Grecs ont introduites jusque dans leurs constructions
purement d’utilité publique, et même dans leur architecture militaire; elle
a, au contraire, ces formes épaisses et raccourcies dont les Romains faisoient
usage, même dans leurs édifices de luxe. Les pleins cintres, plates-bandes, moulures,
colonnes engagées et autres objets de ce genre qu’on y trouve, la font
contraster complètement avec les autres tours de l’enceinte, même avec celles
dont l’enveloppe paroît être Grecque du Bas-Empire, et certainement elle n’est
point Arabe. On n’y voit pas non plus de ces colonnes horizontales qu on trouve
dans presque toutes les autres. Cette voûte du premier étage, primitivement
percée, ou dont les naissances ont si bien résisté, et cette calotte du second plan,
si surbaissée, ne se retrouvent pas non plus ailleurs. On ne voit dans l’enceinte
Arabe que des voûtes en ogive à nervures surhaussées, des arcs de cloître et
doubleaux, des voûtes d’arête, annulaires, ou des dômes hémisphériques. Si cette
tour n’est pas Arabe, il n’est guère vraisemblable non plus qu’elle soit Grecque.
Il me semble donc qu’elle a été bien nommée ; et comme elle appartient à
un front de l’enceinte Arabe qui paroît, par sa position, par la forme du rivage
corrodé à droite et ensablé à gauche, par les constructions de tous les temps
et de tous les genres, sur lesquelles il a été successivement rebâti, avoir fait partie
de l’ancien bord de la mer, les Sarrasins ont apparemment conservé cette tour
dans leur polygone, et l’ont appropriée à la défense de leur ville : je dis appropriée,
parce qu’elle auroit pu originairement être une dépendance du Coesarium,
comme je l’ai observé [88],
On remarque, au pied de la tour des Romains, sur le rivage de la mer et à
très-peu de hauteur au-dessus de l’eau, des restes d’une chaussée pavée de cette
pierre vulgairement appelée basalte. Nous en verrons d’autres vestiges en suivant
cette côte vers Abouqyr; mais il est probable que ceux-ci sont d’une construction
postérieure, attendu qu’ils se trouvent établis sur un sol de ruines. C ’est sans doute
la continuation de la communication de Nicopolis, Canope, et du reste de 1 isthme
(1) Pour sentir cette différence, on peut comparer les vues E. M . vol. I I , planches Sp jusqu'à pp, avec celle de
la planche jp .
oriental, avec le port d Alexandrie, dans les basses époques. A mesure que la ville
et ses abords éprouvoient des changemens, cette extrémité de la communication
subissoit des modifications correspondantes.
A P E R Ç U D E S A N T I Q U I T É S
D U R E S T E D E S B O R D S D U P O R T N E U F .
La mer a beaucoup rongé le reste du périmètre du port neuf, depuis la tour
des Romains jusqu’au cap Lochias, au prolongement actuel de ce promontoire,
et aux récifs qui s’ayançoient autrefois encore plus loin sous les eaux; de manière
que ce rivage présente par-tout une grande confusion de ruines antiques et assez
considérables pour qu’on doive en donner ici un aperçu général, avant de déterminer
celles qui sont encore un peu reconnoissables, En plusieurs endroits,
les fondations de ces ruines sont beaucoup au-dessous du niveau des eaux; on
en voit encore une grande quantité dans la mer, et l’on en tire souvent de très-
belles colonnes. On trouve, sur les bords, des massifs de maçonnerie en briques,
dont les parois intérieures sont enduites de ciment et présentent de chaque côté
une file de trous pour y poser les pieds et descendre au fond. Les canaux qui
établissent la communication avec ces espèces de réservoirs, font conjecturer
que c étoient des citernes pour l’usage des maisons particulières, comme le dit
Hirtius, et pour celui des palais et des autres édifices qui çouvroient cette côte.
La plupart des maçonneries de remplissage ou de soubassement sont aussi en
briques, unies par de si bon mortier, que des pans énormes que la mer a renversés
sur elle-même en sapant la côte, et qu’elle bat sans cesse depuis des siècles,
conservent toute leur intégrité. Dans plusieurs de ces ruines, on remarque des
pavés d’appartement, des bassins demi-circulaires et d’autres formes diverses,
logés dans des murs épais; des espèces de cuves d’inégale largeur à leurs extrémités,
comme des sarcophages ou plutôt des baignoires d’environ deux mètres
de longueur, accompagnées d’une sorte de jarre qui semble avoir servi à alimenter
la cuve. Il règne encore, sur le bord supérieur de toute cette courbe,
aujourd’hui coupé à pic, une grande épaisseur de monceaux de décombres fort
confus, et ce n’est que dans cette section verticale et parallèle au rivage qu’on
reconnoît tous ces objets. La petitesse des conduits, les échelons et le peu de
largeur des puisards, les dimensions très-médiocres des chambres et leur disproportion
avec l’énorme épaisseur des maçonneries, démontrent qu’il y avoit là
non-seulement des citernes, mais sur-tout beaucoup de bains particuliers d’eau
douce et d’eau de mer; car on ne peut pas supposer des bains publics aussi étendus
et occupant toute cette côte, consacrée particulièrement aux palais et autres
édifices de ce genre.
Une chose très-remarquable parmi ces canaux, c’est que, la pente de ceux du
dessous se dirigeant de la terre vers la mer, ceux qui sont au-dessus ont leur
inclinaison en sens contraire. Il est évident que cette disposition étoit faite
pour distribuer l’eau du Nil ou de la mer, amenée par des machines, dans les
bains pratiqués parmi ces réservoirs, et à la faire dégorger ensuite dans le port.