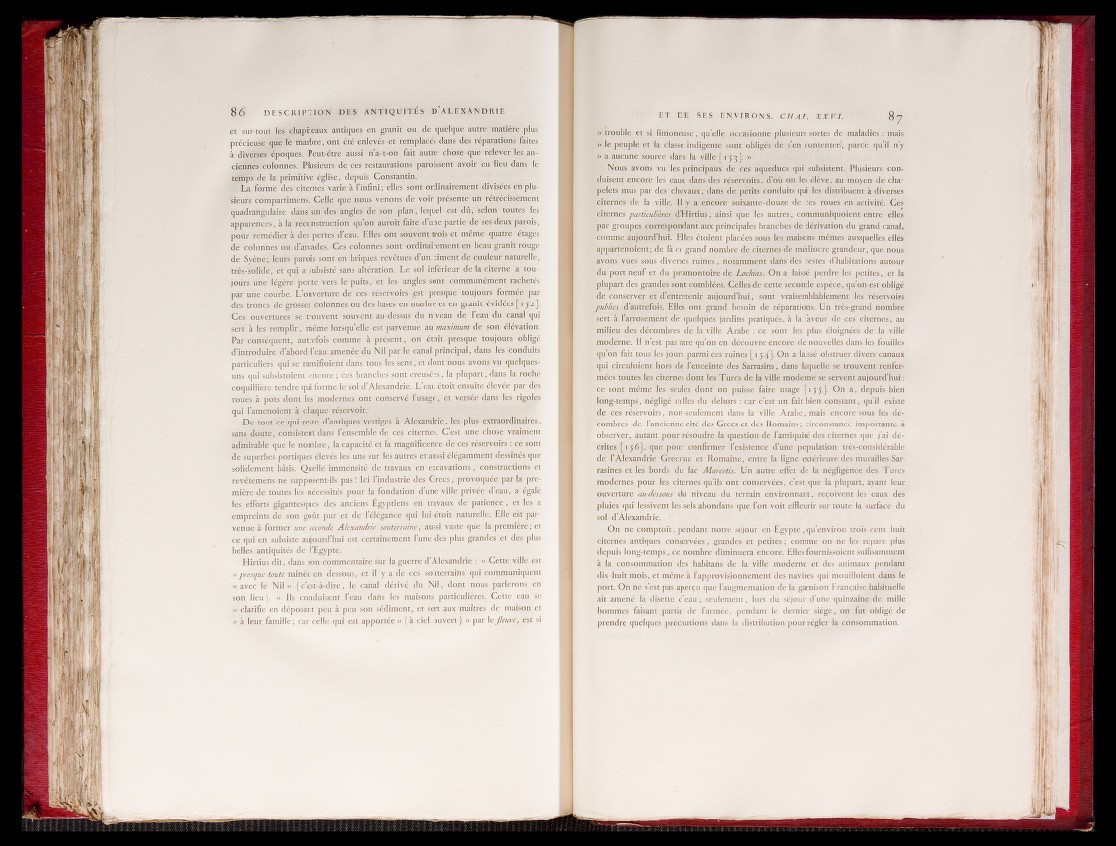
et sur-tout les chapiteaux antiques en granit ou de quelque autre matière plus
précieuse que le marbre, ont été enlevés et remplacés dans des réparations faites
à diverses époques. Peut-être aussi n’a-t-on fait autre chose que relever les anciennes
colonnes. Plusieurs de ces restaurations paroissent avoir eu lieu dans le
temps de la primitive église, depuis Constantin.
La.forme des citernes varie à l’infini; elles sont ordinairement divisées en plusieurs
compartimens. Celle que nous venons de voir présente un retçecissement
quadrangulaire dans un des angles de son plan, lequel est dû, selon toutes les
apparences, à la reconstruction qu’on auroit faite d’une partie de ses deux parois,
pour remédier à des pertes d’eau. Elles ont souvent trois et même quatre étages
de colonnes ou d’arcades. Ces colonnes sont ordinairement en beau granit rouge
de Syène; leurs parois sont en briques revêtues d’un ciment de couleur naturelle,
très-solide, et qui a subsisté sans altération. Le sol inférieur de la citerne a toujours
une légère pente vers le puits, et les angles sont communément rachetés
par une courbe. L ’ouverture de ces réservoirs £sl presque toujours formée par
des troncs de grosses colonnes ou des bases en marbre et en granit évidées [ 152].
Ces ouvertures se trouvent souvent au-dessus du niveau de l’eau du canal qui
sert à les remplir, même lorsqu’elle est parvenue au maximum de son élévation.
Par conséquent, autrefois comme à présent, on étoit presque toujours obligé
d’introduire d’abord l’eau amenée du Nil par le canal principal, dans les conduits
particuliers qui se ramifioient dans tous les sens, et dont nous avons vu quelques-
uns qui subsistoient encore ; ces branches sont creusées, la plupart, dans la roche
coquillière tendre qui forme le sol d Alexandrie. L eau etoit ensuite elevée par des
roues à pots dont les modernes ont conservé l’usage, et versée dans les rigoles
qui l’amenoient à chaque réservoir.
De tout ce qui reste d’antiques vestiges à Alexandrie, les plus extraordinaires,
sans doute, consistent dans l’ensemble de ces citernes. C ’est une chose vraiment
admirable que le nombre, la capacité et la magnificence de ces réservoirs ; ce sont
de superbes portiques élevés les uns sur les autres et aussi élégamment dessinés que
solidement bâtis. Quelle immensité de travaux en excavations, constructions et
revétemens ne supposent-ils pas ! Ici l’industrie des Grecs, provoquée par la première
de toutes les nécessités pour la fondation d’une ville privée d’eau, a égalé
les efforts gigantesques des anciens Égyptiens en travaux de patience, et les a
empreints de son goût pur et de l’élégance qui lui étoit naturelle. Elle est parvenue
à former une seconde Alexandrie souterraine, aussi vaste que la première ; et
ce qui en subsiste aujourd’hui est certainement l’une des plus grandes et des plus
belles antiquités de l’Egypte.
Hirtius dit, dans son commentaire sur la guerre d’Alexandrie : « Cette ville est
» presque toute minée en dessous, et il y a de ces souterrains qui communiquent
» avec le N il» ( c ’est-à-dire, le canal dérivé du Nil, dont nous parlerons en
son lieu). <c Us conduisent l’eau dans les maisons particulières. Cette eau se
» clarifie en déposant peu à peu son sédiment, et sert aux maîtres de maison et
» à leur famille; car celle qui est apportée » ( à ciel ouvert ) « par \z fleuve, est si
» trouble et si limoneuse , qu’elle occasionne plusieurs sortes de maladies : mais
» le peuple et la classe indigente sont obligés de s’en contenter;', parce qu’il n’y
» a aucune source dans la ville [ 153]. »
Nous avons vu les principaux de ces aqueducs qui subsistent. Plusieurs conduisent
encore les eaux dans des réservoirs, d’où on les élève, au moyen de chapelets
mus par des chevaux, dans de petits conduits qui les distribuent à diverses
citernes de la ville. Il y a encore soixante-douze de ces roues en activité. Ces
citernes particulières d’Hirtius, ainsi que les autres, communiquoient entre elles
par groupes correspondant aux principales branches de dérivation du grand canal,
comme aujourd’hui. Elles étoient placées sous les maisons mêmes auxquelles elles
appartenoient; de là ce grand nombre de citernes de médiocre grandeur, que nous
avons vues sous diverses ruines, notamment dans des restes d’habitations autour
du port neuf et du promontoire de Lochias. On a laissé perdre les petites, et la
plupart des grandes sont comblées. Celles de cette seconde espèce, qu’on est obligé
de conserver et d’entretenir aujourd’hui, sont vraisemblablement les réservoirs
publics d’autrefois. Elles ont grand besoin de réparations. Un très-grand nombre
sert à l’arrosement de quelques jardins pratiqués, à la faveur de ces citernes, au
milieu des décombres de la ville Arabe ; ce sont les plus éloignées de la ville
moderne. Il n’est pas rare qu’on en découvre encore de nouvelles dans les fouilles
qu’on fait tous les jours parmi ces ruines [ 1 y 4 ]- On a laissé obstruer divers canaux
qui circuloient hors de l’enceinte des Sarrasins, dans laquelle se trouvent renfermées
toutes les citernes dont les Turcs de la ville moderne se servent aujourd’hui :
ce sont même les seules dont on puisse faire usage [155]. On a, depuis bien
long-temps, négligé celles du dehors : car c’est un fait bien constant, qu’il existe
de ces réservoirs, non-seulement dans la ville Arabe, mais encore sous les décombres
de l’ancienne cité des Grecs et des Romains ; circonstance importante à
observer, autant pour résoudre la question de l’antiquité des citernes que j’ai décrites
[ 1 y6], que pour confirmer l’existence d’une population très-considérable
de l’Alexandrie Grecque et Romaine, entre la ligne extérieure des murailles Sar-
rasines et les bords du lac Mareotis. Un autre effet de la négligence des Turcs
modernes pour les citernes qu’ils ont conservées, c’est que la plupart, ayant leur
ouverture au-dessous du niveau du terrain environnant, reçoivent les eaux des
pluies qui lessivent les sels abondans que l’on voit effleurir sur toute la surface du
sol d’Alexandrie.
On ne comptoit, pendant notre séjour en Egypte , qu’environ trois cent huit
citernes antiques conservées, grandes et petites ; comme on ne les répare plus
depuis long-temps, ce nombre diminuera encore. Elles fournissoient suffisamment
à la consommation des habitans de la ville moderne et des animaux pendant
dix-huit mois, et même à l’approvisionnement des navires qui mouilloient dans le
port. On ne s’est pas aperçu que l’augmentation de la garnison Française habituelle
ait amené la disette d’eau ; seulement, lors du séjour d’une quinzaine de mille
hommes faisant partie de l’armée, pendant le dernier siège, on fut obligé de
prendre quelques précautions dans la distribution pour régler la consommation.