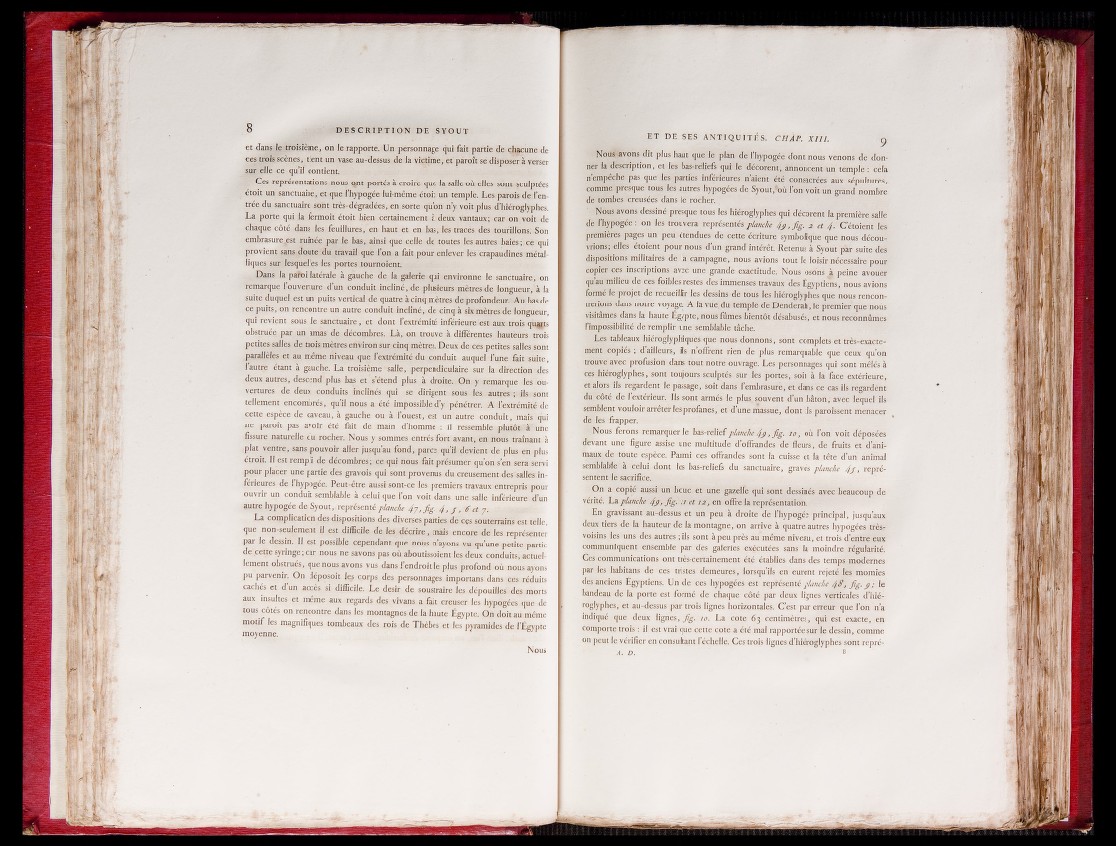
et dans le troisième, on le rapporte. Un personnage qui fait partie de chacune de
ces trois scènes, tient un vase au-dessus de la victime, et paroît se disposer à verser
sur elle ce qu’il contient.
Ces représentations nous ont portés à croire que la salle où elles sont sculptées
étoit un sanctuaire, et que l’hypogée lui-même étoit un temple. Les parois de l’en-
tree du sanctuaire sont très-dégradées, en sorte qu’on n’y voit plus d’hiéroglyphes.
La porte qui la fermoit étoit bien certainement à deux vantaux; car on voit de
chaque côté dans les feuillures, en haut et en bas, les traces des tourillons. Son
embrasure,est ruinée par le bas, ainsi que celle de toutes les autres baies g ce qui
provient sans doute du travail que l’on a fait pour enlever les crapaudines métalliques
sur lesquelles les portes tournoient.
Dans la paroi latérale à gauche de la galerie qui environne le sanctuaire, on
remarque l’ouverture d’un conduit incliné, de plusieurs mètres de longueur, à la
suite duquel est un puits vertical de quatre à cinq mètres de profondeur. Au bas de
ce puits, on rencontre un autre conduit incliné, de cinq à six mètres de longueur,
qui revient sous le sanctuaire, et dont l’extrémité inférieure est aux trois qugjts
obstruée par un amas de décombres. Là, on trouve à différentes hauteurs trois
petites salles de trois mètres environ sur cinq mètres. Deux de ces petites salies sont
parallèles et au même niveau que l’extrémité du conduit auquel l’une fait suite,
1 autre étant à gauche. La troisième salle, perpendiculaire sur la direction des
deux autres, descend plus bas et s’étend plus à droite. On y remarque les ouvertures
de deux conduits inclinés qui se dirigent sous les. autres ; ils sont
tellement encombrés, qu’il nous a été impossible d’y pénétrer. A l’extrémité de
cette espèce de caveau, à gauche ou à l’ouest, est un autre conduit, mais qui
ne paroît pas avoir été fait de main d’homme : il ressemble plutôt à une
fissure naturelle du rocher. Nous y sommes entrés fort avant, en nous traînant à
plat ventre, sans pouvoir aller jusqu’au fond, parce qu’il devient de plus en plus
étroit. Il est rempli de décombres; ce qui nous fait présumer qu’on s’en sera servi
pour placer une partie des gravois qui sont provenus du creusement des salles inférieures
de 1 hypogée. Peut-etre aussi sont-ce les premiers travaux entrepris pour
ouvrir un conduit semblable à celui que l’on voit dans une salie inférieure d'un
autre hypogée de Syout, représenté planche 47, fig- 4 , J , g et y.
La complication des dispositions des diverses parties de cçs souterrains est telle,
que non-seulement il est difficile de les décrire, mais encore de les représenter
par le dessin. II est possible cependant que nous n’ayons vu qu’une petite partie
de cette syringe, car nous ne savons pas ou aboutissoient les deux conduits, actuellement
obstrues, que nous avons vus dans l’endroit le plus profond où nous ayons
pu parvenir. On déposoit les corps des personnages importans dans ces réduits
cachés et d un accès si difficile. Le désir de soustraire les dépouilles des morts
aux insultes et même aux regards des vivans a fait creuser les hypogées que de
tous côtés on rencontre dans les montagnes de la haute Égypte. On doit au même
motif les magnifiques tombeaux des rois de Thèbes et les pyramides de i’Égypte
moyenne.
Nous
E T D E S E S A N T I Q U I T É S . C H À P . X I I I . ÿ
Nous avons dit plus haut que le plan de l’hypogée dont nous venons de donner
la description, et les bas-reliefs qui le décorent, annoncent un temple : cela
n’empêche pas que les parties inférieures n’aient été consacrées aux sépultures,
comme presque tous les autres hypogées de Syout,*où l’on voit un grand nombre
de tombes creusées dans le rocher.
Nous avons dessiné presque tous les hiéroglyphes qui décorent la première salle
de l’hypogée: on les trouvera représentés planche 4p ,fig . 2 et 4. Cétoient les
premières pages un peu étendues de cette écriture symbolique que nous découvrions;
elles étoient ppur nous d’un grand intérêt. Retenus à Syout par suite des
dispositions militaires de la campagne, nous avions tout le loisir nécessaire pour
copier ces inscriptions avec une grande exactitude. Nous osons à peine avouer
qu au milieu de ces foibles restes des immenses travaux des Égyptiens, nous avions
forme le piojet de recueillir les dessins de tous les hiéroglyphes que nous rencontrerions
dans notre voyage. A la vue. du temple de Denderah, le premier que nous
visitâmes dans la haute Égypte, nous fûmes bientôt désabusés, et nous reconnûmes
l’impossibilité de remplir une semblable tâche.
Les tableaux hiéroglyphiques que nous donnons, sont complets et très-exactement
copies ; d ailleurs, ils n offrent rien de plus remarquable que ceux qu’on
trouve avec profusion dans tout notre ouvrage. Les personnages qui sont mêlés à
ces hiéroglyphes, sont toujours sculptés sur les portes, soit à la face extérieure,
et alors ils regardent le passage, soit dans 1 embrasure, et dans ce cas ils regardent
du côté de l’extérieur. Ils sont armés le plus souvent d’un bâton, avec lequel ils
semblent vouloir arrêter les profanes, et d une massue, dont ils paroissent menacer
de les frapper.
Nous ferons remarquer le bas-relief planche 4^ , fig- 10, où l’on voit déposées
devant une figure assise une multitude d’offrandes de fleurs, de fruits et d’animaux
de toute empece. Parmi ces offrandes sont la cuisse et la tête d’un animal
semblable a celui dont les bas-reliefs du sanctuaire, gravés planche 4 j > représentent
le sacrifice.
On a copie aussi un bouc et une gazelle qui sont dessinés avec beaucoup de
vérité. La planche 4 <), fig■ u et 12 , en offre la représentation.
En gravissant au-dessus et un peu à droite de l’hypogée principal, jusqu’aux
deux tiers de la hauteur de la montagne, on arrive à quatre autres hypogées très-
voisins les uns des autres ; ils sont à peu près au même niveau, et trois d’entre eux
communiquent ensemble par des galeries exécutées sans la moindre régularité.
Ces communications ont très-certainement été établies dans des temps modernes
par les habitans de ces tristes demeures, lorsqu’ils en eurent rejeté les momies
des anciens Égyptiens. Un de ces hypogées est représenté planche 4 8 , fig- J) ; le
bandeau de la porte est formé de chaque côté par deux lignes verticales d’hié-
roglyphes, et au-dessus par trois lignes horizontales. C’est par erreur que l’on n’a
indique que deux lignes, fig. 10. La cote 63 centimètres, qui est exacte, en
comporte trois : il est vrai que cette cote a été mal rapportée sur le dessin, comme
on peut le vérifier en consultant l’échelle. Ces trois lignes d’hiéroglyphes sont repré-
A. d . b