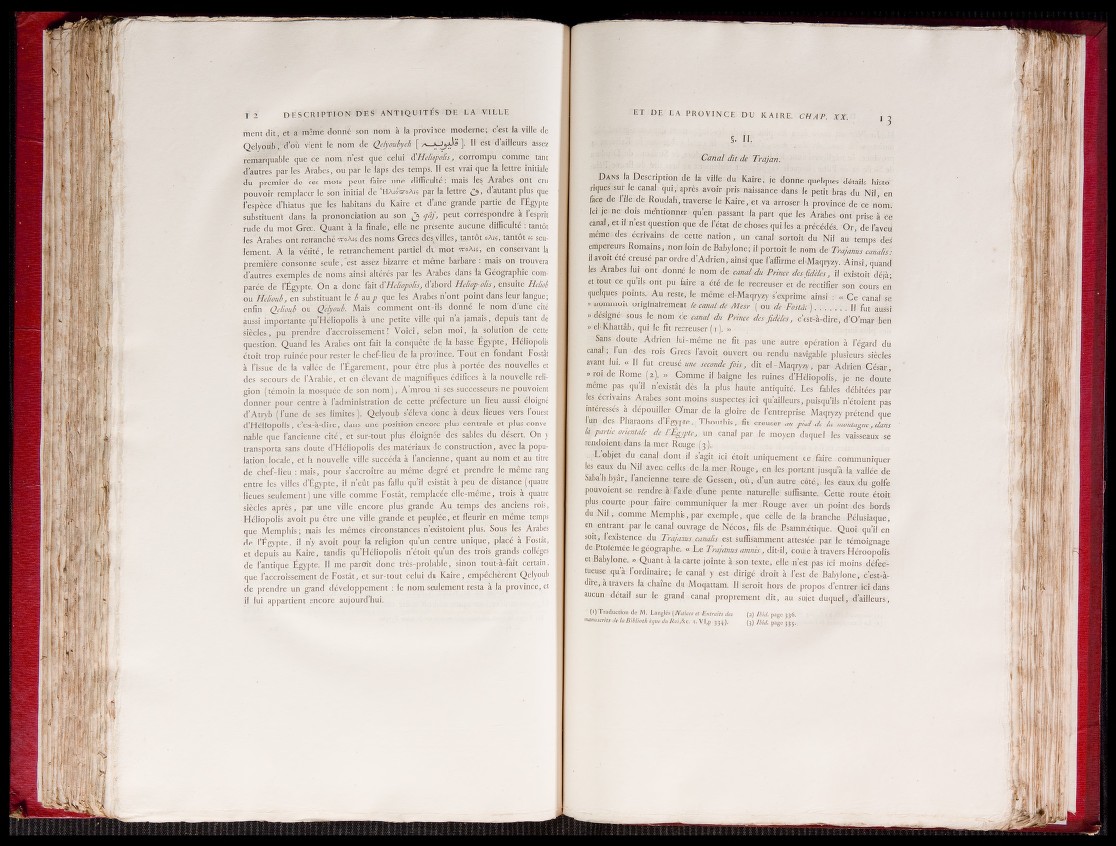
ment dit, et a même donné son nom à la province moderne; c'est la ville de
Qelyoub, 'd’où vient le nom de Qelyoubycli [/>— O jx la ]. Il est d ailleurs assez
remarquable que ce nom n’est que celui SHeliopolis, corrompu comme tant
d'autres par les Arabes, ou par le laps des temps. Il est vrai que la lettre initiale
du premier de ces mots peut faire une difficulté; mais les Arabes ont cru
pouvoir remplacer le son initial de HAjo'za'oAiç par la lettre , d autant plus que
l’espèce d’hiatus que les habitans du Kaire et d’une grande partie de l’Égypte
substituent dans la prononciation au son ¿5 qâf, peut correspondre a 1 esprit
rude du mot Grec. Quant à la finale, elle ne présente aucune difficulté : tantôt
les Arabes ont retranché vroAtç des noms Grecs destvilles, tantôt oAiç, tantôt seulement.
A la vérité, le retranchement partiel du mot vroAis, en conservant la
première consonne seule, 'est assez bizarre et même barbare : mais on trouvera
d’autres exemples de noms ainsi altérés par les Arabes dans la Géographie comparée
de l’Égypte. On a donc fait SHeliopolis, d’abord Heliop-olis, ensuite Heliol
ou Helioub, en substituant le b aup que les Arabes n’ont point dans leur langue;
enfin Qelioub ou Qelyoub. Mais comment ont-ils donne le nom dune cite
aussi importante qu’Héliopolis a une petite ville qui n a jamais, depuis tant de
siècles, pu prendre d’accroissement 1 V o ic i, selon moi, la solution de cette
question. Quand les Arabes ont fait la conquête de la basse Egypte, Héliopolis
étoit trop ruinée pour rester le chef-lieu de la province. Tout en fondant Fostât
à l’issue de la vallée de l’Égarement, pour etre plus a portée des nouvelles et
des secours de l’Arabie, et en élevant de magnifiques édifices à la nouvelle religion
(témoin la mosquée de son nom ), A mrou ni ses successeurs ne pouvoient
donner pour centre à l’administration de cette préfecture un lieu aussi éloigné
d’Atryb (l’une de ses limites). Qelyoub s’éleva donc à deux lieues vers l’ouest
d’H éliopolis, c’est-à-dire, dans une position encore plus centrale et plus convenable
que l’ancienne c ité , et sur-tout plus éloignée des sables du désert. On y
transporta sans doute d’Héliopolis des matériaux de construction, avec la population
locale, et la nouvelle ville succéda à l’ancienne, quant au nom et au titre
de chef-lieu ; mais, pour s’accroître au même degré et prendre le même rang
entre les villes d’Égypte, il n’eût pas fallu qu’il existât à peu de distance (quatre
lieues seulement) une ville comme Fostât, remplacée elle-même, trois a quatre
siècles après, par une ville encore plus grande. A u temps des anciens rois.
Héliopolis avoit pu être une ville grande et peuplée, et fleurir en même temps
que Memphis ; mais les mêmes circonstances n’existoient plus. Sous les Arabes
de l’Égypte, il n’y av.oit pour la religion qu’un centre unique, placé à Fostât,
et depuis au Kaire, tandis qu’Héliopolis n’étoit qu’un des trois grands collèges
de l’antique Égypte. Il me paroît donc très-probable, sinon tout-à-fait certain,
que l’accroissement de Fostât, et sur-tout celui du Kaire, empêchèrent Qelyoub
de prendre un grand développement : le nom seulement resta a la province, et
il lui appartient encore aujourd’hui.
§. II.
Canal dit de Trajan.
D a n s la Description de la ville du Kaire, je donne quelques détails historiques
sur le canal qui, après avoir pris naissance dans le petit bras du Nil, en
face de Ifie dè Roudah, traverse le Kaire, et va arroser la province de ce nom
Ici je ne dois mentionner qu’en passant la part que les Arabes ont prise à ce
canal, et il n’est question que de l’état de choses qui lès a précédés. Or, de l’aveu1
même, des écrivains de cette nation, un canal sortoit du Nil au temps deâ
empereurs Romains, .non loin deBabylone; il portoit le nom d e Trajanus canalis ':
il avoit été creusé par ordre d’Adrien, ainsi que l’affirme el-Maqryzy. Ainsi, quand
les Arabes lui ont donné le nom de canal du Prince des fidèles, il existoit déjà;
et tout ce qu ils ont pu faire a été de le recreuser ët de rectifier son cours en
quelques points. A u reste, le même el-Maqryzy s’exprime ainsi : « Ce canal së
k nommoit originairement le canal de Mesr ( ou de Fostât ) ...............Ij fut aussi
» désigne ro n s le nom de canal du Prince des fidèles, c’est-à-dire, d’O ’mar ben
s ebKhattâb, qui le fit recreuser ( 1 ). »
Sans doute Adrien lui-même ne fit pas une autre opération à l’égard du
canal ; lun des rois Grecs l’avoit ouvert ou rendu navigable plusieurs siècles
avant lui. « Il fut creusé une seconde fo is , dit el-Maqryzy, par Adrien César,
»roi de Rome (2). » Comme il baigne les ruines d’Héliopolis, je ne douté
même pas qu’il n’existât dès la plus haute antiquité. Les fables débitées par
les écrivains Arabes, sont, moins suspectes; ici qu’ailleurs, puisqu’ils n’étoient pas
intéressés à dépouiller O’mar de la gloire de l’entreprise. Maqryzy prétend que
lun des Pharaons d’Égypte, Thouthis, fit creuser au pied de la montagne, dans
là partie orientale de l ’Égypte, un canal par Je moyen duquel les vaisseaux se
tendoient: dans la mer Rouge (.3^
■L objet du canal dont il s’agit ici étoit uniquement de faire communiquer
les eaux du Nil avec celles de la mer Rouge, en les portant jusqu’à la .vallée de
Saba’h bÿâr, l’ancienne terre de Gessen, où, d’un autre côté,, les eaux du golfe
pouvoient se rendre à l’aide d’unè pente naturelle suffisante. Cette route étoit
plus courte pour faire communiquer la mer Rouge avec un point des bords
du N il, comme Memphis, par exemple, que celle de la branche Pélusiaque,
en entrant par le canal ouvrage de Nécos, fils de Psammétique. Quoi qu’il en
sort, 1 existence du Trajanus canalis est suffisamment attestée par le témoignage
de Ptolémée le géographe. « L e Trajanus amnis, dit-il, coule à travers Héroopolis
et Babylone. » Quant à la carte jointe à son texte, elle n’est pas ici moins défectueuse
qu’à l’ordinaire; le canal y est dirigé droit à l’est de Babylone, c’est-à-
dire, a tiavers la chaîne du Moqattam. Il seroit hors de propos d’entrer ici dans
aucun détail sur le grand canal proprement dit, au sujet duquel, d’ailleurs,
(1) Traduction de M. Langlès (Notices et Extraits des (2) Ibid. page 336.
manuscrits de laBiblioth iquedu t. VI,p 334). (3) Ibid. page 33 c,