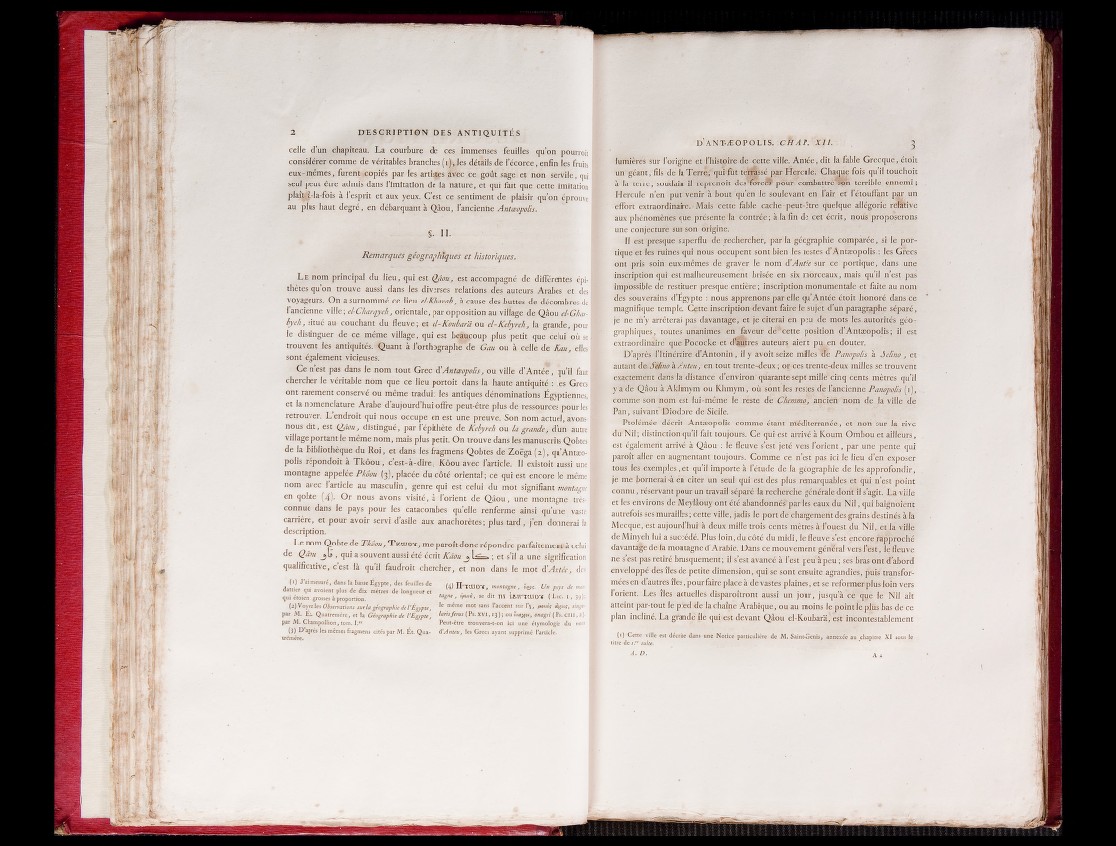
celle d’un chapiteau. La courbure de ces immenses feuilles qu’on pourroit
considérer comme de véritables branches (i),les détails de l’écorce, enfin les fruits
eux-mêmes, furent copiés par les artisfes avec ce goût sage et non servile, qui
seul peut être admis dans l’imitation de la nature, et qui fait que cette imitation
plaît-à-la-fois à l’esprit et aux yeux. C’est ce sentiment de plaisir qu’on éprouve
au plus haut degré, en débarquant à Qâou, l’ancienhe Antoeopolis.
§. II.
Remarques géographiques et historiques.
L e nom principal du lieu, qui est Qâou, est accompagné de différentes épi-
thetes qu on trouve aussi dans les diverses relations des auteurs Arabes et des
voyageurs. On a surnommé ce lieu el-Klmrab, à cause des buttes de décombres de
1 ancienne ville; d-Charqyeh, orientale, par opposition au village de Qâou el-Ghar-
byeh, situe au couchant du fleuve; et el-Koubara ou el-Kebyreli, la grande, pour
le distinguer de ce même village, qui est beaucoup plus petit que celui où se
trouvent les antiquités. Quant à l’orthographe de Gau ou à celle de Kau, elles
sont également vicieuses.
Ce n est pas dans le nom tout Grec d’Antoeopolis, ou ville d’A n té e , qu’il faut
chercher le véritable nom que ce lieu portoit dans la haute antiquité : les Grecs
ont rarement conservé ou même traduit les antiques dénominations Égyptiennes,
et la nomenclature Arabe daujourdhui offre peut-être plus de ressources pour les
letrouver. L endroit qui noiis occupe en est une preuve. Son nom actuel, avons-
nous dit, est Qâou, distingue, par 1 épithète de Kebyreh ou lu grande, d’un autre
village portant le même nom, mais plus petit. On trouve dans les manuscrits Qobtes
de la Bibliothèque du Roi, et dans les fragmens Qobtes de Zoëga (2), quAntæo-
polis repondoit a T k o o u , cest-à-dire, Kôou avec l’article. Il existoit aussi une
montagne appelée Pkoou (3), placée du côté oriental; ce qui est encore le même
nom avec 1 article au masculin, genre qui est celui du mot signifiant montagm\
en qobte (4 )* Or nous avons visité, à 1 orient de Qâou, une montagne très-
connue dans le pays pour les catacombes qu’elle renferme ainsi qu’une vaste
carrière, et pour avoir servi d’asile aux anachorètes; plus tard, j’en donnerai la
description.
Le nom Qobte de Tkoou, Truict*, me paroît donc répondre parfaitement à celui
de Qaou , qui a souvent aussi été écrit Kâou ^ li===> ; et s’il a une signification I
qualificative, cest là quil faudroit chercher, et non dans le mot à’AntSe, des I
(1) J’ai mesuré, dans la basse Égypte, des feuilles de tt\ n „ , n r . „ « , T ,
• _ . . - , , (4i IJVTCJLIOY, montagne, o& ç . Un pays de mon■ I
dattier qui avoient plus de dix métrés de longueur et , ,
qui étoiem grosses à proportion. ' •/*"»> !e dit ™ S S rn tU O V (Luc. I , 39);
(2) Voyez les Observations su r la g éa g ra p h ieile l'É g fp ie, ,e m™ c mot sam l’accent sur I’ j , pmit <?»<*, singa- I
par M. Et. Quatremère, et la Géographie de l'É g y p te , b m f i n u (Ps. X V I , 13); ou ïrajfw, onagri (Ps. C I 1 1 ,2). I
par t/i. Champoliion, tom. I.cr Peut-être trouvera-t-on ic i une étymologie du nom I
(3) D ’après les memes fragmens cités par M. Et. Qua- àïAnteu, les Grecs ayant supprime l’article,
trémère.
lumières sur l’origine et l’histoire de cette ville. Antée, dit la fable Grecque, étoit
un géant, fils de la Terre, qui fût terrassé par Hercule. Chaque fois qu’il touchoit
à la terre, soudain il reprenoit des‘force? pour; combattre -son terrible ennemi;
Hercule n’en put venir à bout qu’en le soulevant en l’air et’ l’étouffant par un
effort extraordinaire. • Mais cette fable cache -peut-être quelque allégorie relative
aux phénomènes que présente la contrée; à la fin de cet écrit, nous proposerons
une conjecture sur son origine.
Il est presque superflu de rechercher, parla géographie comparée, si le portique
et les ruines qui nous occupent sont bien les restes d’Antæopolis,: les Grecs
ont pris soin eux-mêmes de graver le nom d'Antée sur ce portique, dans une
inscription qui est malheureusement brisée en six morceaux, mais qu'il n’est pas
impossible de restituer presque entière; inscription monumentale et faite au nom
des souverains d’Egypte : nous apprenons par elle qu’Antée étoit honoré dans ce
magnifique temple. Cette inscription devant faire le sujet d’un paragraphe séparé,
je ne m’y arrêterai pas davantage, et je citerai en peu de mots les. autorités géographiques,
toutes unanimes en faveur de cette position d’Antæopolis; il est
extraordinaire que Pococke et d’autres auteurs aient pu en douter.
D ’après l’Itinéraire d’Antonin, il y avoit seize milles oe Panopolis à Selino, et
autant de- Séino \Anteu, en tout trente-deux ; or ces trente-deux milles se trouvent
exactement dans la distance d’environ quarante:sept mille cinq cents mètres qu’il
y a de Qâou à Akhmym ou Khmym, où sont les restes de l’ancienne Panopolis (t),
comme son nom est lui-même le reste de Chemmo, ancien nom de la ville de
Pan, suivant Diodore de Sicile.
Ptolémée décrit Antæopolis comme étant méditerranée, et non sur la rive
du Nil; distinction qu’il fait toujours. Ce qui est arrivé à Koum Ombou et ailleurs,
est également arrivé à Qâou : le fleuve s’est jeté vers l’o rient, par une pente qui
paroît aller en augmentant toujours. Comme ce n’est pas ici le lieu d’en exposer
tous les exemples, et qu’il importe à l’étude de la géographie de les approfondir,
je me bornerai-à én citer un seul qui est des plus remarquables et qui n’est point
connu, réservant pour un travail séparé la recherche générale dont il s’agit. La ville
et les environs de Meylâouy ont été abandonnés* par les eaux du N il, qui baignoient
autrefois ses murailles ; cette ville, jadis le port de chargement des grains destinés à la
Mecque, est aujourd’hui à deux mille trois cents mètres à l’ouest du Nil, et la ville
de Minyeh lui a succédé. Plus loin, du côté du midi, le fleuve s’est encore rapproché
davantage de la montagne d’Arabie, Dans ce mouvement général vers l’est, le fleuve
nés est pas retire brusquement ; il s’est avancé à l’est peu à peu ; ses bras ont d’abord
enveloppé des îles de petite dimension, qui se sont ensuite agrandies, puis transformées
en d’autres îles, pourfaire place à dévastés plaines, et se reformer plus loin vers
l’orient. Les îles actuelles disparoîtront aussi un jour, jusqu’à ce que le Nil ait
atteint par-tout le pied de la chaîne Arabique, ou au moins le point le plus bas de ce
plan incline. La grande' île qui est devant Qâou el-Koubara, est incontestablement
(1) C e t te v ille est d éc r ite dans une N o t ic e pa rticu lière d e M . S a in t-G e n is , an n ex ée au chapitre X I sous le
titre de suite.