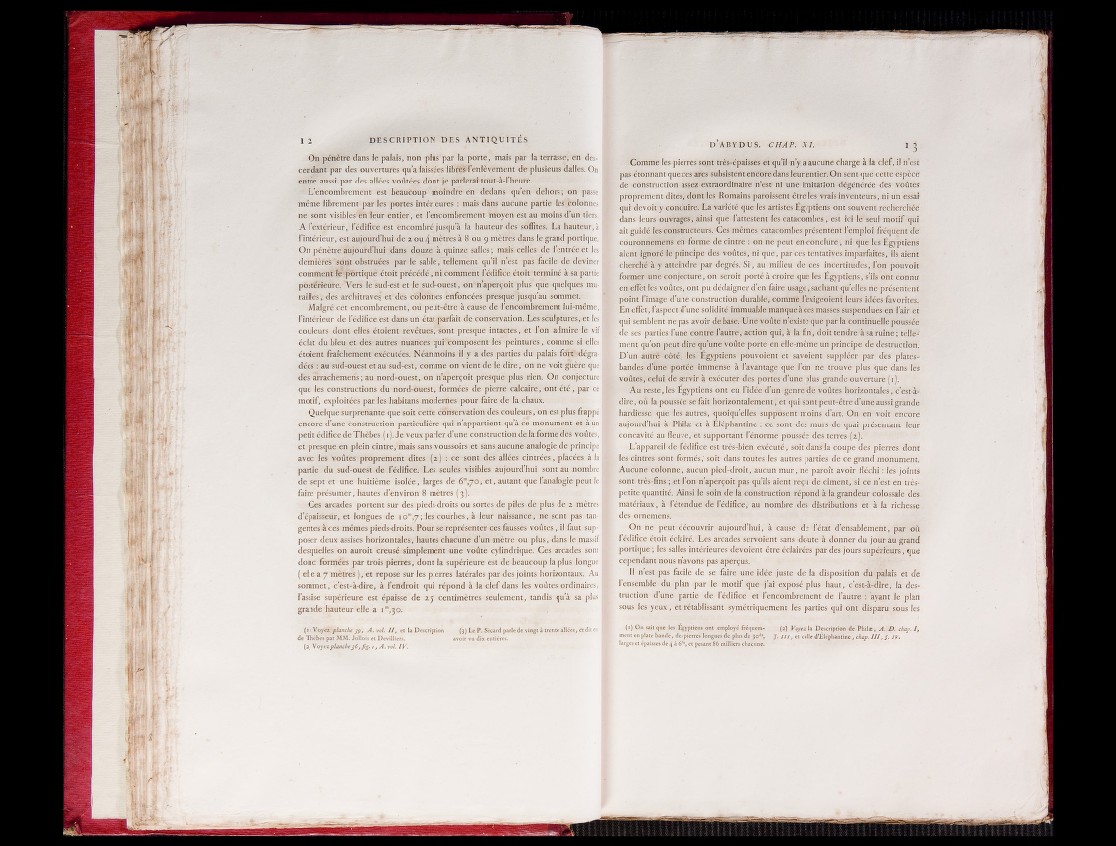
On pénètre dans Je palais, non plus par la porte, mais par la terrasse, en descendant
par des ouvertures qu’a laissées librês l’enlèvement de plusieurs dalles. On
entre aussi par des allées voûtées dont je parlerai tout-à-l’heure.
L ’encombrement est beaucoup moindre en dedans qu’en dehors ; on passe
même librement par les portes intérieures : mais dans aucune partie les colonnes
ne sont visibles en leur entier, et l’encombrement moyen est au moins d’un tiers.
A l’extérieur, l’édifice est encombré jusqu’à la hauteur des soffiteS. La hauteur, à
l’intérieur, est aujourd’hui de 2 ou 4 mètres à 8 ou 9 mètres dans le grand portique.
On pénètre aujourd’hui dans douze à quinze salles ; mais celles de l’entrée et les
dernières sont obstruées par le sable, tellement qu’il n’est pas facile de deviner
comment le portique étoit précédé, ni comment l’édifice étoit terminé à sa partie
postérieure. Vers le sud-est et le sud-ouest, on n’aperçoit plus que quelques murailles
, des architraves et des colonnes enfoncées presque jusqu’au sommet.
Malgré cet encombrement, ou peut-être à cause de l’encombrement lui-même,
l’intérieur de l’édifice est dans un état parfait de conservation. Les sculptures, et.Ies
couleurs dont elles étoient revêtues, sont presque intactes, et l’on admire le vif
éclat du bleu et des autres nuances qui composent les peintures, comme si elles
étoient fraîchement exécutées. Néanmoins il y a des parties du palais fort dégradées
: au sud-ouest et au sud-est, comme on vient de le dire, on ne voit guère que
des arrachemens ; au nord-ouest, on n’aperçoit presque plus rien. On conjecture
que les constructions du nord-ouest, formées de pierre calcaire, ont été, par ce
motif, exploitées par les habitans modernes pour faire de la chaux.
Quelque surprenante que soit cette conservation des couleurs, on est plus frappé
encore d’une construction particulière qui n’appartient qu’à ce monument et à un
petit édifice de Thèbes (1). Je veux parler d’une construction de la forme des voûtes,
et presque en plein cintre, mais sans voussoirs et sans aucune analogie de principe
avec les voûtes proprement dites ( 2 ) : ce sont des allées cintrées, placées à la
partie du sud-ouest de l’édifice. Les seules visibles aujourd’hui sont au nombre
de sept et une huitième isolée, larges de 6”,70, et, autant que l’analogie peut le
faire présumer, hautes d’environ 8 mètres ( 3 ).
Ces arcades portent sur des pieds-droits ou sortes de piles de plus de 2 mètres
d’épaisseur, et longues de 1 o " ,7 ; les courbes, à leur naissance, ne sont pas tangentes
à ces mêmes pieds-droits. Pour se représenter ces fausses voûtes, il faut supposer
deux assises horizontales, hautes chacune d’un mètre ou plus, dans le massif
desquelles on auroit creusé simplement une voûte cylindrique. Ces arcades sont
donc formées par trois pierres, dont la supérieure est de beaucoup la plus longue
( elle a 7 mètres ), et repose sur les pierres latérales par des joints horizontaux. Au
sommet, c’est-à-dire, à l’endroit qui répond à la clef dans les voûtes ordinaires,
l’assise supérieure est épaisse de 2 y centimètres seulement, tandis qu’à sa plus
grande hauteur elle a i^ o .
(1) Voyez planche 39, A. vol. I I , et la Description (3) Le P. Sicard parlede vingt à trente allées, e't dit ei
de Thèbes par MM. Joli ois et Devilliers. avoir vu dix entières.
(2) Voyez planche jdjJig- / , A . vol, IV.
Comme les pierres sont très-épaisses et qu’il n’y a aucune charge a la clef, il n’est
pas étonnant que ces arcs subsistent encore dans leur entier. On sent que cette espèce
de construction assez extraordinaire n’est ni une imitation dégénérée des voûtes
proprement dites, dont les Romains paroissent être les vrais inventeurs, ni un essai
qui devoit y conduire. La variété que les artistes Egyptiens ont souvent recherchée
dans leurs ouvrages, ainsi que l’attestent les catacombes, est ici le seul motif qui
ait guidé les constructeurs. Ces mêmes catacombes présentent l’emploi fréquent dé
couronnemens en forme de cintre : on ne peut en conclure, ni que les Égyptiens
aient ignoré le principe des voûtes, ni que, par ces tentatives imparfaites, ils aient
cherché à y atteindre par degrés. Si, au milieu de ces incertitudes, l’on pouvoit
former une conjecture, on seroit porté à croire que les Egyptiens, s’ils ont connu
en effet les voûtes, ont pu dédaigner d’en faire usage, sachant qu’elles ne présentent
point l’image d’une construction durable, comme l’exigeoient leurs idées favorites.
En effet, l’aspect d’une solidité immuable manque à ces masses suspendues en l’air et
qui semblent ne pas avoir de base. Une voûte n’existe que par la continuelle poussée
de ses parties l’une contre l’autre, action qui, à la fin, doit tendre à sa ruine; tellement
qu’on peut dire qu’une voûte porte en elle-même un principe de destruction.
D ’un autré côté, les Égyptiens pouvoient et savoient suppléer par des plates-
bandes d’une portée immense à l’avantage que l’on ne trouve plus que dans les
voûtes, celui de servir à exécuter des portes d’une plus grande ouverture (i).
Au reste,les Égyptiens ont eu l’idée d’un genre de voûtes horizontales, c’est-à-
dire, où la poussée se fait horizontalement, et qui sont peut-être d’une aussi grande
hardiesse que les autres, quoiqu’elles supposent moins d’art. On en voit encore
aujourd’hui- à Philæ et à Éléphantine : ce sont des murs de quai présentant leur
concavité au fleuve, et supportant l’énorme poussée des terres (2).
L ’appareil de l’édifice est très-bien exécuté, soit dans la coupe des pierres dont
les cintres sont formés; soit dans toutes les autres parties de ce grand monument.
Aucune colonne, aucun pied-droit, aucun mur, ne paroît avoir fléchi : les joints
sont très-fins ; et l’on n’aperçoit pas qu’ils aient reçu de ciment, si ce n’est en très-
petite quantité. Ainsi le soin de la construction répond à la grandeur colossale des
matériaux, à l’étendue de l’édifice, au nombre des distributions et à la richesse
des ornemens.
On ne peut découvrir aujourd’hui, à cause de l’état d’ensablement, par ofl
l’édifice étoit éclairé. Les arcades servoient sans doute à donner du jour au grand
portique ; les salles intérieures devoient être éclairées par des jours supérieurs, que
cependant nous n’avons pas aperçus.
Il n’est pas facile de se faire une idée juste de la disposition du palais et de
l’ensemble du plan par le motif que j’ai exposé plus haut, c’est-à-dire, la destruction
d’une partie de l’édifice et l’encombrement de l’autre : ayant le plan
sous les yeux, et rétablissant symétriquement les parties qui ont disparu sous les
(1) On sait que les Égyptiens ont employé fréquem- (a) Voyez la Description de Phila», A. D. chap. 1,
ment en plate bandé, des pierres longues de plus de 3od*, J\ m , et celle d’ÉIéphantine, chap, I I I , /. IV .
larges et épaisses de 4 à 6,ls, et pesant 86 milliers chacune.