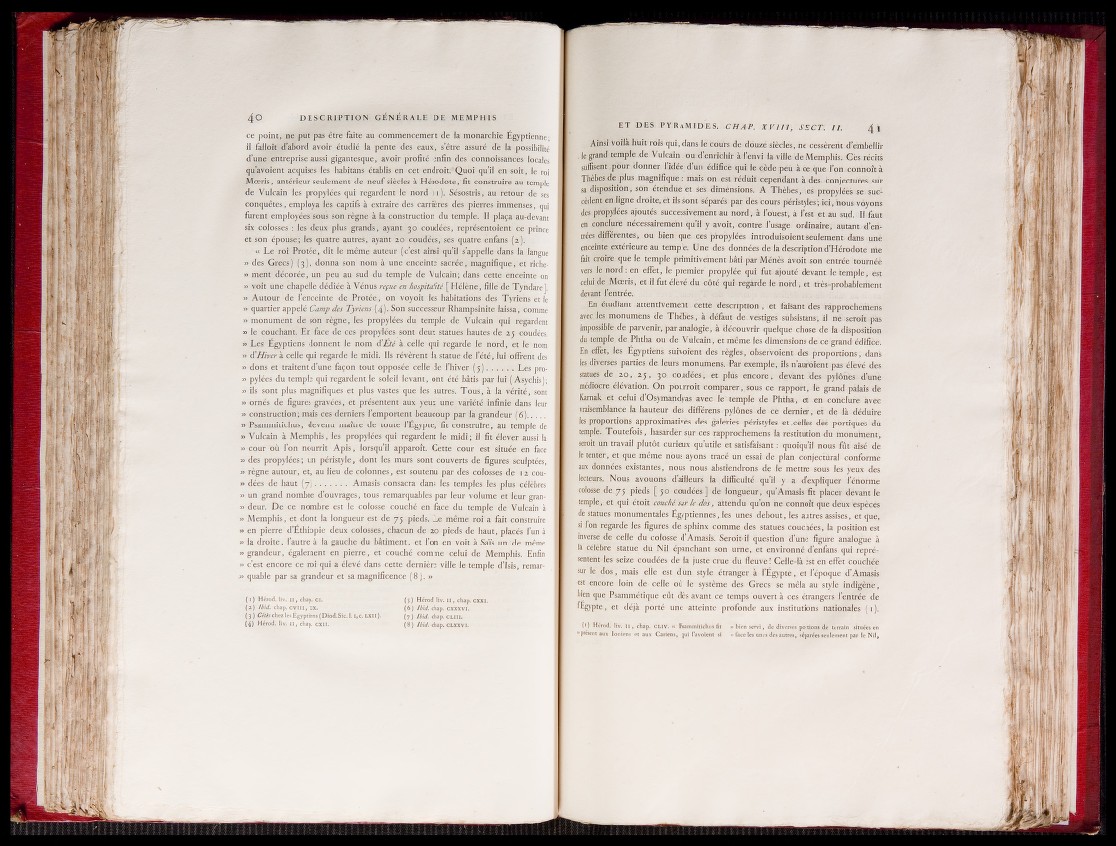
4 0 D E S C R I P T I O N G E N É R A L E D E M E M P H I S
ce point, ne put pas être faite au commencement de ia monarchie Égyptienne-
il fâlloit d’abord avoir étudié la pente des eaux, s’être assuré de la possibilité
d’une entreprise aussi gigantesque, avoir profité enfin des connoissances locales
qu’avoient acquises les habitans établis en cet endroit.'Quoi qu’il en soit, le roi
Moeris, antérieur seulement de neuf siècles à Hérodote, fit construire au temple
de Vulcain les propylées qui regardent le nord (i). Sésostris, au retour de ses
conquêtes, employa les captifs à extraire des carrières des pierres immenses, qui
furent employées sous son règne à la construction du temple. Il plaça au-devant
six colosses : les deux plus grands, ayant 30 coudées, représentoient ce prince
et son épouse; les quatre autres, ayant 20 coudées, ses quatre enfans (2).
« L e roi Protée, dit le même auteur (c’est ainsi qu’il s’appelle dans la langue
» des Grecs) (3), donna son nom à une enceinte sacrée, magnifique, et riche-
» ment décorée, un peu au sud du temple de Vulcain; dans cette enceinte on
» voit une chapelle dédiée à Vénus reçue en hospitalité [Hélène, fille de Tyndare],
» Autour de l’enceinte de Protée, on voyoit les habitations des Tyriens et le
» quartier appelé Camp des Tyriens (4 )- Son successeur Rhampsinite laissa, comme
» monument de son règne, les propylées du temple de Vulcain qui regardent
» le couchant. En face de ces propylées sont deux statues hautes de 2 y coudées.
» Les Égyptiens donnent le nom à'Eté à celle qui regarde le nord, et le nom
» d’Hiver à celle qui regarde le midi. Ils révèrent ia statue de l’été, lui offrent des
» dons et traitent d’une façon tout opposée celle de l’hiver ( y ) Les pro-
» pylées du temple qui regardent le soleil levant, ont été bâtis par lui ( Asychis);
» ils sont plus magnifiques et plus vastes que les autres. Tous, à la vérité, sont
» ornés de figures gravées, et présentent aux yeux une variété infinie dans leur
» construction; mais ces derniers l’emportent beaucoup par la grandeur (6)........
» Psammitichus, devenu maître de toute l’Egypte, fit construire, au temple de
» Vulcain à Memphis, les propylées qui regardent le midi; il fit élever aussi la
» cour où l’on nourrit A pis , lorsqu’il apparoît. Cette cour est située en face
» des propylées ; un péristyle, dont les murs sont couverts de figures sculptées,
» règne autour, et, au lieu de colonnes, est soutenu par des colosses de 12 couaï
dées de haut ( 7 ) ..................Amasis consacra dans les temples les plus célèbres
» un grand nombre d’ouvrages, tous remarquables par leur volume et leur gran-
aa deur. De ce nombre est le colosse couché en face du temple de Vulcain à
» Memphis, et dont la longueur est de 7 y pieds. Le même roi a fait construire
» en pierre d’Ethiopie deux colosses, chacun de 20 pieds de haut, placés l’un à
» la droite, l’autre à la gauche du bâtiment, et l’on en voit à Sais un de même
aa grandeur, également en pierre, et couché comme celui de Memphis. Enfin
» c’est encore ce roi qui a élevé dans cette dernière ville le temple d’Isis, remar-
aa quable par sa grandeur et sa magnificence (8 ). »
(1) Herod, liv. n , chap. ci.
( 2 ) Ibid. chap. C V I I I , CX.
(3 ) Cetis chezlesEgyptiens (Diod.Sic. I. I ,c . LX I l).
( 4 ) Herod. liv. 11, chap. c x i l.
(5) Hérod. liv. n , chap. CXXI.
( 6 ) Ibid. chap. c x x x v i .
( 7 ) Ibid. chap. C L i i l .
( 8 ) Ibid. chap. CLXXVI.
Ainsi Voila huit rois qui, dans le cours de douzé siècles, ne cessèrent d’embellir
. le grand temple de Vulcain, ou d enrichir a 1 envi la ville de Memphis. Gès récité
suffisent pour donner l’idée d’un édificè qui le cède peu à ce que l’on connoît à
Thèbes de plus magnifique : mais on est réduit cependant à des conjectures sur
sa disposition, son etehdue et Ses diménsions, A Thebes, les propylées se succèdent
en ligne droite, et ils sont séparés par des cours péristyles'; ici, nous voyons
des propylées ajoutés successivement au nord, à l’ouest, à l’est et au sud. Il faut
en conclure nécessairement qu’il y avoit, contre l’usage ordinaire, autant d’em-
trées différentes j ou bien que ces propylées introduisoient seulement dans une
enceinte extérieure au temple. Une des données de la description d’Hérodote me
fait croire que le temple primitivement bâti par Ménès avoit son entrée tournéè
vers le nord : en effet, le premier propylée qui fut ajouté devant le temple, est
celui de Moeris, et il fut élevé du côté qui regarde le nord, et très-probablement
devant l’entrée.
En étudiant attentivement cette description , et faisant des rapprochemens
avec les monumens de Thèbès, à défaut de. vestiges subsistàns, il né seroit pas
impossible de parvenir, par analogie, à découvrir quelque chose de la disposition
du temple de Phtha ou de Vulcain, et même les dimensions de ce grand édifice.
En effet, les Égyptiens suivoient des règles, observoient des proportions, dans
les diverses parties de leurs monumens. Par exemple, ils n’aurôient pas élevé des
statues de 20, 25, 30 coudéest et plüs encore, devant des pylônes d’une
médiocre élévation. On pourroit comparer, sous ce rapport, le grand palais de
Kamak et celui dOsymandyas avec le ’ temple de Phtha, et en conclure avec
vraisemblance la hauteur des différens pylônes de ce dernier, et de là déduire
les proportions approximatives des galeries péristyles et .celles des portiques du
temple. Toutefois, hasarder sur ces rapprochemens la restitution du monument,
seroit un travail plutôt curieux qu utile et satisfaisant : quoiqu’il nous fut aisé de
le tenter, et que meme nous ayons tracé un essai de plan conjectural conforme
aux données existantes, nous nous abstiendrons de le mettre sous les yeux des
lecteurs. Nous avouons d’ailleurs la difficulté qu’il y a d’expliquer l’énorme
colosse de 75 pieds [50 coudées] de longueur, qu’Amasis fit placer devant le
temple, et qui étoit couché sur le dos, attendu qu’on ne connoît que deux espèces
de statues monumentales Égyptiennes, les unes debout, les autres assises, et que,
si Ion regarde les figures de sphinx comme des statues couchées, la position est
inverse de celle du colosse d’Amasis. Seroit-il question d’une figure analogue à
la célèbre statue du Nil épanchant son urne, et environné d’enfans qui représentent
les seize coudées de la juste crue du fleuve ! Celle-là est en effet couchée
sur le dos, mais elle est d un style étranger à l’Egypte, et l’époque d’Amasis
est encore loin de celle où le système des Grecs se mêla au style indigène,
tien que Psammétique eût dès avant ce temps ouvert à ces étrangers l’entrée de
l’Egypte, et déjà porté une atteinte profonde aux institutions nationales ( i ).
(1) Herod. liv. I l , chap. C L IV . « Psammitichus fit »bien servi, de diverses portions de terrain situées en
«présent aux Ioniens et aux Cariens, qui l’avoient si » face les unes des autres, séparées seulement par le Nil,