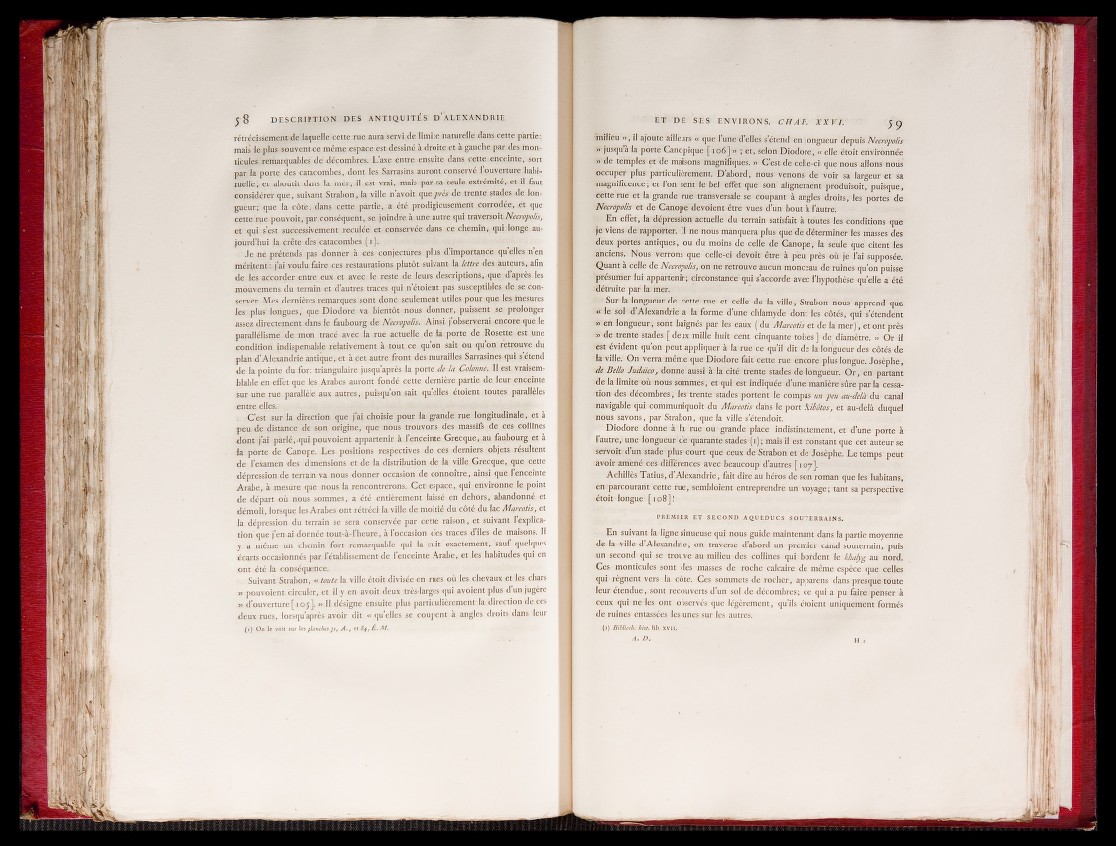
rétrécissement de laquelle cette rue aura servi de limite naturelle dans cette partie:
mais le plus souvent ce même espace est dessiné à droite et a gauche par cles monticules
remarquables de décombres. L’axe entre ensuite dans cette enceinte, sort
par la porte des catacombes, dont les Sarrasins auront conservé l'ouverture habituelle,,
et aboutit dans la mer, il est vrai, mais par sa seule extrémité, et il faut
considérer que, suivant Strabon, la ville n avoit que près de trente stades de longueur;
que la côte, dans cette partie, a été prodigieusement corrodée, .et que
cette rue pouvoit, par conséquent, se joindre à une autre qui traversoit Nccropolis,
et qui s’est successivement reculée et conservée dans ce chemin, qui longe aujourd’hui
la crête des catacombes ( i ).
Je ne prétends pas donner à ces conjectures plus dimportance quelles nen
méritent: j’ai voulu faire ces restaurations plutôt suivant la lettre des auteurs, afin
de les accorder entre eux et avec le reste de leurs descriptions, que d après les
mouvemens du terrain et d’autres traces qui n’étoient pas susceptibles de se conserver.
Mes dernières remarques sont donc seulement utiles pour que les mesures
les plus longues, que Diodore va bientôt nous donner, puissent se prolonger
assez directement dans le faubourg de Necropolis. Ainsi j observerai encore que le
parallélisme de mon tracé avec la rue actuelle de la porte de Rosette est une
condition indispensable relativement à tout ce qu’on sait ou quon retrouve du
plan d’Alexandrie antique, et à cet autre front des murailles Sarrasines qui s étend
de la pointe du fort triangulaire jusqu’après la porte de la Colonne. Il est vraisemblable
en effet que les Arabes auront fondé cette dernière partie de leur enceinte
sur une rue parallèle aux autres, puisqu’on sait qu’elles étoient toutes parallèles
entre elles.
C ’est sur la direction que ja i choisie pour la grande rue longitudinale, et a
peu de distance de son origine, que nous trouvons des massifs de ces collines
dont j’ai parlé,,qui pouvoient appartenir à l’enceinte Grecque, au faubourg et a
la porte de Canope. Les positions respectives de ces derniers objets résultent
de l’examen des dimensions et de la distribution de la ville Grecque, que cette
dépression de terrain va nous donner occasion de connoitre, ainsi que 1 enceinte
Arabe, à mesure que nous la rencontrerons. Cet espace, qui environne le point
de départ où nous sommes, a été entièrement laissé en dehors, abandonne et
démoli, lorsque les Arabes ont rétréci la ville de moitié du côté du lac Mareotis, et
la dépression du terrain se sera conservée par cette raison, et suivant 1 explication
que j’en ai donnée tout-à-l’heure, à l’occasion des traces diles de maisons. Il
y a même un chemin fort remarquable qui la suit exactement, sauf quelques
écarts occasionnés par l’établissement de 1 enceinte Arabe, et les habitudes qui en
ont été la conséquence.
Suivant Strabon, «toute la ville étoit divisée en rues où les chevaux et les chars
■a pouvoient circuler, et il y en avoit deux très-larges qui avoient plus dun jugère
v d’ouverture [ 105 ]. » Il désigne ensuite plus particulièrement la direction de ces
deux rues, lorsqu’après avoir dit « qu elles se coupent a angles droits dans leur
(1) On le voit sur les planches j i , A . , et 84, E. AI.
t i îi s h î-ti v î n ? ? n &>i 1 î ffis -t ?! 1 m n m fi ? $ 1011 j t ¡km y oj<h ? r ? ; ? 11 * * « f j
■milieu », il ajoute ailleurs « que 1 une d elles s’étend en longueur depuis Necropolis
» jusqu’à la porte Canopique [ 106]» ; et, selon Diodore, « elle étoit environnée
» cle temples et de maisons magnifiques, p C ’est de celle-ci que nous allons nous
occuper plus particulièrement. D abord, nous venons de voir sa largeur et sa
magnificence ; et Ion sent le bel effet que son alignement produisoit, puisque,
cette rue et la grande rue transversale se coupant à angles droits, les portes de
Necropolis et de Cariope devoient être vues d’un bout à fautre.
En effet, la dépréssion actuelle du terrain satisfait a toutes les conditions que
je viens de rapporter. Il ne nous manquera plus que de déterminer les masses des
deux portes antiques, ou du moins de celle de Canope, la seule que citent les
anciens. Nous verrons que celle-ci devoit être à peu près où je 1 ai supposée.
Quant a celle de Necropolis, on ne retrouve aucun monceau de ruines qu on puisse
présumer lui appartenir; circonstance qui s’accorde avec l’hypothèse qu’elle a été
détruite par la mer.
Sur la longueur de cette rue et celle de la ville, Strabon nous apprend que
« le sol d Alexandrie a la forme dune chlamyde dont les côtés, qui s’étendent
*> en longueur, sont baignes par les eaüx ( du Mareotis et de la mer), et ont près
y> de trente stades [ deux mille huit cent cinquante toises ] de diamètre. » Or il
est évident qu’on peut appliquer à la rue ce qu’il dit de la longueur des côtés de
la ville. On verra même que Diodore fait cette rue encore plus longue. Josèphe,
de Bello Judaico, donne aussi à la cité trente stades de longueur. O r , en partant
de la limite ou nous sommes, et qui est indiquée d’une manière sûre par la cessation
des décombres, les trente stades portent le compas un peu au-delà du canal
navigable qui communiquoit du Mareotis dans le port Kibôtos, et au-delà duquel
nous savons, par Strabon, que la ville s’étendoit.
Diodore donne à la rue ou grande place indistinctement, et d’une porte à
l’autre, une longueur de quarante stades (i); mais il est constant que cet auteur se
servoit d’un stade plus court que ceux de Strabon et de Josèphe. Le temps peut
avoir amené ces différences avec beaucoup d’autres [107].
Achilles Tatius, d Alexandrie, fait dire au héros de son roman que les habitans,
en parcourant cette rue, sembloient entreprendre un voyage; tant sa perspective
étoit - longue [108] 1
P R E M I E R E T S E C O N D A Q U E D U C S S O U T E R R A I N S .
En suivant la ligne sinueuse qui nous guide maintenant dans la partie moyenne
de la ville d Alexandrie, on traverse d’abord un premier canal souterrain, puis
un second qui se trouve au milieu des collines qui bordent le khalyg au nord.
Ces monticules sont des masses de roche calcaire de même espèce que celles
qui régnent vers la côte. Ces sommets de rocher, apparens dans presque toute
leur étendue, sont recouverts d’un sol de décombres; ce qui a pu faire penser à
ceux qui ne les ont observés que légèrement, qu’ils étoient uniquement formés
de ruines entassées les unes sur les autres.
(1) Biblioth. hist. lib. XVII.
A. D . H 2