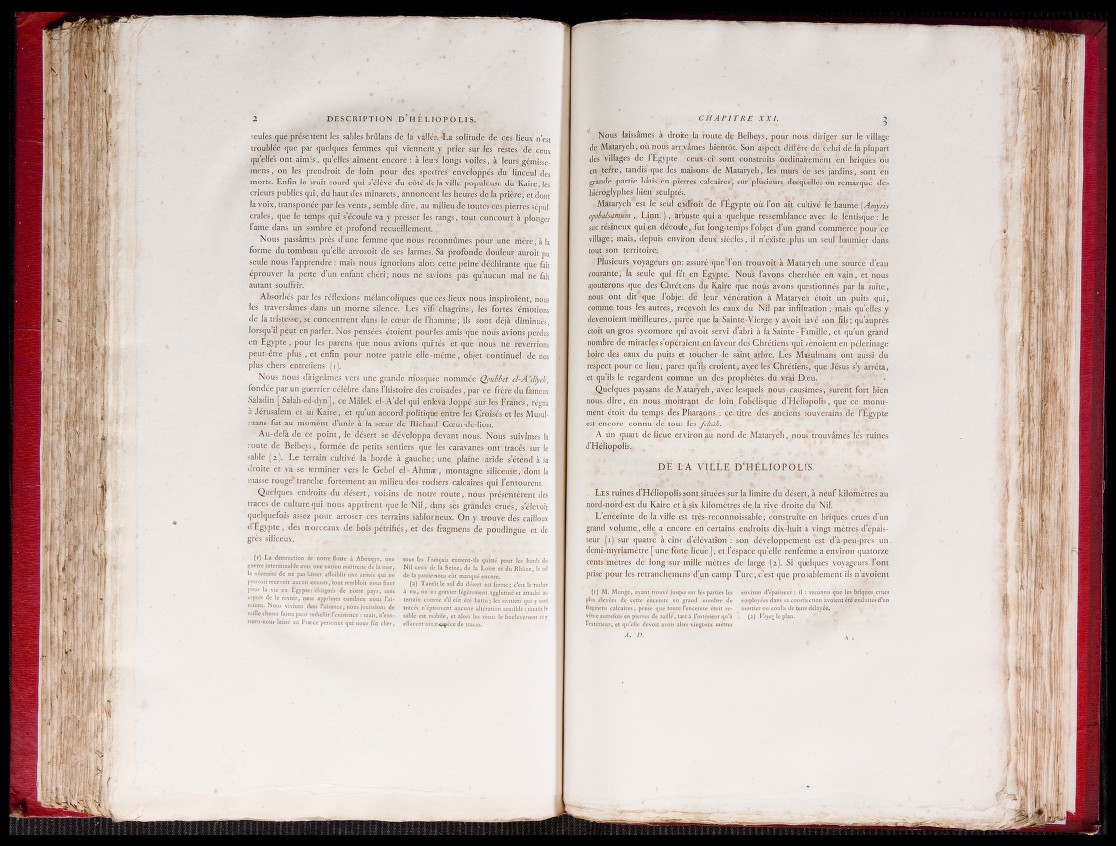
seules que présentent les sables brûlans de la vallée. La solitude de ces lieux n’est
troublée que par quelques femmes qui viennent y prier sur les restes de ceux
qu’elles ont aimés, qu’elles aiment encore : à leurs longs voiles, à leurs gémisse-
mens, on les prendroit de loin pour des spectres' enveloppés du linceul des
morts. Enfin le bruit sourd qui s’élève du côté de la ville populeuse du‘Kaire, les
crieurs publics qui, du haut des minarets, annoncent les heures de la prière, et dont
la voix, transportée par les vents, semble dire, au milieu de toutes ces pierres sépulcrales,
que le temps qui s’écoule va y presser les rangs, tout concourt à plonger
l’ame dans un sombre et profond recueillement.
Nous passâmes près d’iine femme que nous reconnûmes pour une mère, à la
forme du tombeau qu’elle arrosoit de ses larmes." Sa profonde douleur auroit pu
seule nous l’apprendre : mais nous ignorions alors cette peine déchirante que fait
éprouver la perte d’un enfant chéri; nous ne savions pas qu’aucun mal ne fait
autant souffrir.
Absorbés par les réflexions mélancoliques que ces lieux nous inspiroient, nous
les traversâmes dans un morne silence. Les vifs chagrins , les fortes émotions
de la tristesse, se concentrent dans le coeur de l’homme; ils sont déjà diminués,
lorsqu il peut en parler. Nos pensées étoient pour les amis que nous avions perdus
en Egypte, pour les parens que nous avions quittés et que nous ne reverrions
peut-etre plus , et enfin pour notre patrie elle-même, objet continuel de nos
plus chers entretiens (i).
Nous nous dirigeâmes vers une grande mosquée nommée Qoubbet el-A ’dlyeli,
fondée par un guerrier célèbre dans l’histoire des croisades, par ce frère du fameux
Saladin [Salah-ed-dyn], ce Mâlek el-A’del qui enleva Joppé sur les Francs, régna
à Jérusalem et au Kaire, et qu’un accord politique entre les Croisés et les Musulmans
fût au moment d’unir à la soeur de Richard Coeur-de-lion.
Au-dela de ce point, le désert se développa devant nous. Nous suivîmes la
route de Belbeys, formée de petits sentiers que les caravanes ont tracés sur le
sable (2). Le terrain cultivé la borde à gauche; une plaine aride s’étend à sa
droite et va se terminer vers le Gebel el-Ahmar, montagne siliceuse, dont la
masse rouge* tranche fortement au milieu des rochers calcaires qui l’entourent.
Quelques endroits du désert, voisins de notre route, nous présentèrent des
traces de culture qui nous apprirent que le N il, dans ses grandes crues, s’élevoit
quelquefois assez pour arroser ces terrains sablonneux. On y trouve des cailloux
<l Fgypte, des morceaux de bois pétrifiés, et des fragmens de poudingue et de
grès siliceux.
tons les Français eussent-ils quitté pour ¡es bords du
Nil ceux de la Seine, de la Loire et du Rhône, le sol
de la patrie nous eût manqué encore.
(2) Tantôt le sol du désert est ferme; c’est le rocher
a nu, ou un gravier légèrement agglutiné et attaché au
terrain, comme s’il eût été battu ; les sentiers qui y sont
traces n’eprouvent aucune altération sensible : tantôt le
sable est mobile, et alors les vents le bouleversent et y
effacent toute-çipèce de traces.
(1) La destruction de notre floue à Abouqyr, une
guerre interminable avec une nation maîtresse de la mer,
la nécessité de ne pas laisser affoiblir une armée qui ne
pou voit recevoir aucun secours, tout sembloit nous fixer
pour la vie en Egypte : éloignés de notre pays, sans
espoir de le revoir, nous apprîmes combien nous l’aimions.
Nous vivions dans l’aisance, nous jouissions de
mille choses faites pour embellir l’existence : mais, n’eussions
nous laissé en France personne qui nous lut cher,
Nous laissâmes a droite la route de Belbeys, pour nous diriger sur le village
de Mataryeh, ou nous arrivâmes bientôt. Son aspect diffère de celui de la plupart
des villages de l’Egypte : ceux-ci sont construits ordinairement en briques ou
en terre, tandis que les maisons de Mataryeh, les murs de ses jardins, sont en
grande partie bâtis en pierres calcaires, sur plusieurs desquelles on remarque des
hiéroglyphes bien sculptés.
Mataryeh est le seul endroit de l’Egypte où l’on ait cultivé le baume (Amyris
opobalsamum , Linn. ) , arbuste qui a quelque ressemblance avec le lentisque : le
suc résineux qui en découle, fut long-temps l’objet d’un grand commerce pour ce
village; mais, depuis environ deux' siècles, il n’existe plus un seul baumier dans
tout son territoire:
Plusieurs voyageurs ont assuré que l’on trouvoit à Mataryeh une source d’eau
courante, la seule qui fût en Egypte. Nous l’avons cherchée en vain, et nous
ajouterons que des Chrétiens du Kaire que nous avons questionnés par la suite,
nous ont dit que l’objet dè leur“ vénération à Mataryeh étoit un puits qui,
comme tous les autres, recevoit les eaux du Nil par infiltration ; mais qu’elles y
devenoient meilleures, parce que la Sainte-Vierge y avoit lavé son fils ; qu’auprès
étoit un gros sycomore qui avoit servi d’abri à la Sainte-Famille, et qu’un grand
nombre de miracles s’opéraient en faveur des Chrétiens qui venoient en pèlerinage
bqire des eaux du puits et toucher le saint arbre. Les Musulmans ont aussi du
respect pour ce lieu; parce qu’ils croient, avec les Chrétiens, que Jésus s’y arrêta,
et qu’ils le regardent comme un des prophètes du vrai Dieu.
Quelques paysans de Mataryeh, avec lesquels nous causâmes, surent fort bien
nous, dire, en nous montrant de loin l’obélisque d’Héliopolis, que ce monument
étoit du temps des Pharaons : ce titre des anciens souverains de l’Egypte
est encore connu de tous les fdiâli.
A un quart de lieue environ au nord de Mataryeh, nous trouvâmes les ruines
d’Héliopolis.
D E L A V I L L E D ’H É L IO P O L I S ,
L es ruines d’Héliopolis sont situées sur la limite du désert, à neuf kilomètres au
nord-nord-est du Kaire et à six kilomètres de la rive droite du Nil.
L ’enceinte de la ville est très-reconnoissable; construite en briques crues d’un
grand volume, elle a encore en certains endroits dix-huit à vingt mètres d’épaisseur
(1) sur quatre à cinq d’élévation : son développement est d’à-peu-près un.
demi-myriamètre [une forte lieue], et l’espace qu’elle renferme a environ quatorze
cents mètres de long sur mille mètres de large (2). Si quelques voyageurs,’ l’ont
prise pour les retranchemens d’un camp Turc, c’est que probablement ils n’avoient
(i) M. Monge, ayant trouvé jusque sur les parties les environ d'épaisseur ; il a reconnu que les briques crues
plus élevées de cette enceinte un grand nombre de employées dans sa construction avoient été enduites d’un
fragmens calcaires, pense que toute l’enceinte étoit re- mortier ou coulis de terre délayée#
vetue autrefois en pierres de taillé, tant à l’intérieur qu’à , (2) Voye^ le plan,
l'extérieur, et qu’elle devoit avoir alors vingt-six mètres