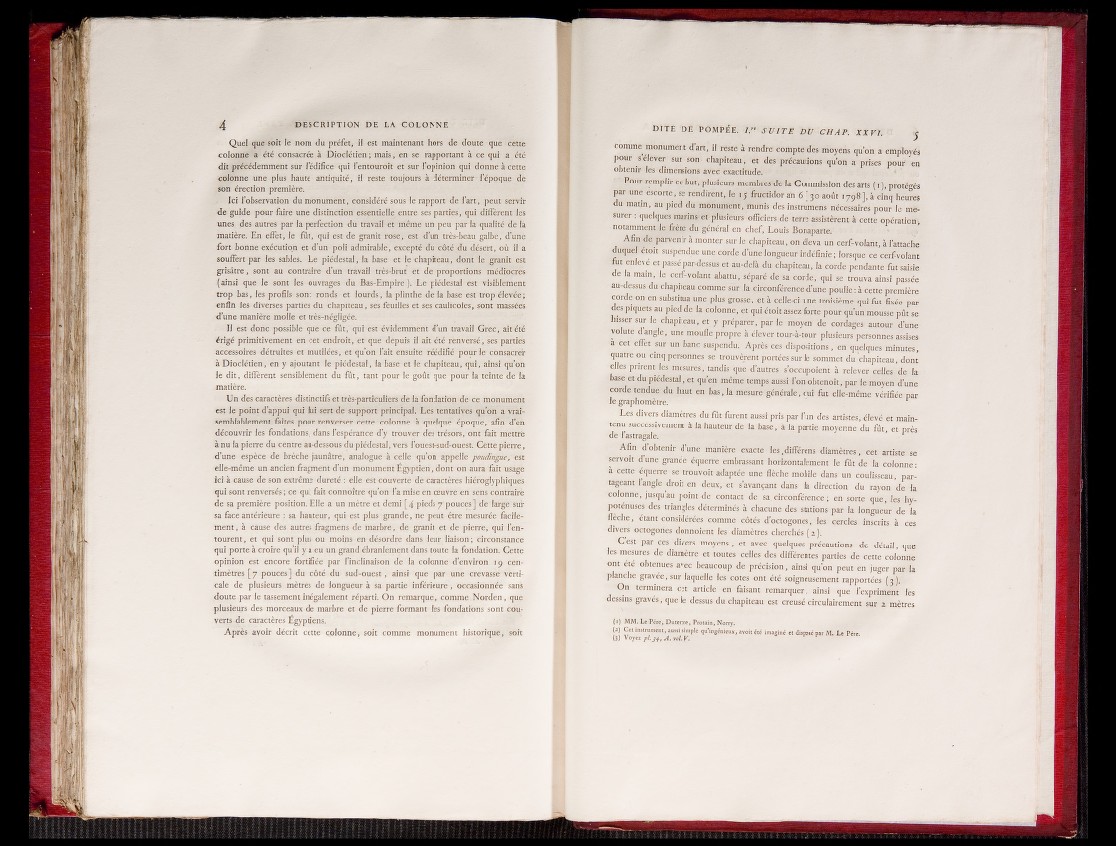
Quel que soit le nom du préfet, il est maintenant hors de doute que cette
colonne a été consacrée à Dioclétien ; mais, en se rapportant à ce qui a été
dit précédemment sur l’édifice qui l’entouroit et sur l’opinion qui donne à cette
colonne une plus haute antiquité, il reste toujours à déterminer l’époque de
son érection première.
Ici l’observation du monument, considéré sous le rapport de l’art, peut servir
de guide pour faire une distinction essentielle entre ses parties, qui diffèrent les
unes des autres par la perfection du travail et même un peu par la qualité de la
matière. En effet, le fût, qui est de granit rose, est d’un très-beau galbe, d’uné
fort bonne exécution et d’un poli admirable, excepté du côté du désert, où il a
souffert par les sables. Le piédestal, la base et le chapiteau, dont le granit est
grisâtre, sont au contraire d’un travail très-brut et de proportions médiocres
(ainsi que le sont les ouvrages du Bas-Empire ). Le piédestal est visiblement
trop bas, les profils sont ronds et lourds, la plinthe de la base est trop élevée ;
enfin les diverses parties du chapiteau, ses feuilles et ses caulicoles, sont massées
d’une manière molle et très-négligée.
Il est donc possible que ce fût, qui est évidemment d’un travail Grec, ait été
érigé primitivement en cet endroit, et que depuis il ait été renversé, ses parties
accessoires détruites et mutilées, et qu’on l’ait ensuite réédifié pour le consacrer
à Dioclétien, en y ajoutant le piédestal, la base et le chapiteau, qui, ainsi qu’on
le dit, diffèrent sensiblement du fût, tant pour le goût que pour la teinte de là
matière.
Un des caractères distinctifs et très-particuliers de la fondation de ce monument
est le point d’appui qui lui sert de support principal. Les tentatives qu’on a vraisemblablement
faites pour renverser cette colonne à quelque époque, afin d’en
découvrir les fondations, dans l’espérance d’y trouver des trésors, ont fait mettre
à nu la pierre du centre au-dessous du piédestal, vers l’ouest-sud-ouest. Cette pierre,
d’une espèce de brèche jaunâtre, analogue à celle qu’on appelle poudingue, est
elle-même un ancien fragment d’un monument Égyptien, dont on aura fait usage
ici à cause de son extrême dureté : elle est couverte de caractères hiéroglyphiques
qui sont renversés ; ce qui fait connoître qu’on l’a mise en oeuvre en sens contraire
de sa première position. Elle a un mètre et demi [4 pieds 7 'pouces] de large sur
sa face antérieure : sa hauteur, qui est plus grande, ne peut être mesurée facilement
, à cause des autres fragmens de marbre, de granit et de pierre, qui l’entourent,
et qui sont plus ou moins en désordre dans leur liaison; circonstance
qui porte à croire qu’il y a eu un grand ébranlement dans toute la fondation. Cette
opinion est encore fortifiée par l’inclinaison de la colonne d’environ 19 centimètres
[ 7 pouces] du côté du sud-ouest, ainsi que par une crevasse verticale
de plusieurs mètres de longueur à sa partie inférieure, occasionnée sans
doute par le tassement inégalement réparti. On remarque, comme Norden, que
plusieurs des morceaux de marbre et de pierre formant les fondations sont couverts
de caractères Egyptiens.
Après avoir décrit cette colonne, soit comme monument historique, soit
comme monument d art, il reste à rendre compte des moyens qu’on a employés
pour s élever sur son chapiteau, et des précautions qu’on a prises pour en
obtenir les dimensions avec exactitude.
Pour remplir ce but, plusieurs membres de la Commission des arts ( 1 ), protégés
par une escorte, se rendirent, le 1 y fructidor ah 6 [ 30 août 1798 ], à cinq heures
du matin, au pied du monument, munis des instruirons nécessaires pour le mesurer
: quelques marins et plusieurs officiers.de terre assistèrent à cette opération;
notamment le frère du général en chef, Louis Bonaparte.
Afin de parvenir à monter sur le chapiteau, on éleva un cerf-volant, à l’attache
duquel étoit suspendue une corde d’une longueur indéfinie ; lorsque ce cerf-volant
ut enlevé et passé par-dessus et au-delà du chapiteau, la corde pendante fut saisie
de la main, le cerf-volant abattu, séparé de sa corde, qui se trouva ainsi passée
au-dessus du chapiteau comme sur la circonférence d’une poulie : à cette première
corde on en substitua une plus grosse, et à celle-ci une troisième qui fut fixée par
des piquets au pied de la colonne, et qui étoit assez forte pour qu’un mousse pût se
hisser sur le chapiteau, et y préparer, par le moyen de cordages autour d’une
volute d angle, une moufle propre à élever tour-à-tour plusieurs personnes assises
a cet effet sur un banc suspendu. Après ces dispositions, en quelques minutes,
quatre ou cinq personnes se trouvèrent portées sur le sommet du chapiteau, dont
elles prirent les mesures, tandis que d’autres s’occupoient à relever celles de la
base et du piédestal, et qu’en même temps aussi l’on obtenoit, par le moyen d’une
corde tendue du haut en bas, la mesure générale, qui fut elle-même vérifiée par
le graphomètre.
Les divers diamètres du fût furent aussi pris par l’un des artistes, çlevé et maintenu
successivement à la hauteur de la base, à la partie moyenne du fût, et près
de l’astragale. ’
Afin d’obtenir d’une manière exacte les.différens diamètres, cet artiste se
servoit d une grande équerre embrassant horizontalement le fût de la colonne :
à cette équerre se trouvoit adaptée une flèche mobile dans un coulisseau, partageant
1 angle droit en deux, et s’avançant dans la direction du rayon de la
colonne, jusquau point de contact de sa circonférence ; en sorte que, les hypoténuses
des triangles déterminés à chacune des stations par la longueur de la
flèche, étant considérées comme côtés d’octogones, les cercles inscrits à ces
divers octogones donnoient les diamètres cherchés ( 2. ).
C ’est par ces divers moyens , et avec quelques précautions de détail, que
les mesures de diamètre et toutes celles des différentes parties de cette colonne
ont ete obtenues avec beaucoup de précision, ainsi qu’on peut en juger par la
planche gravée, sur laquelle les cotes ont été soigneusement rapportées ( 3 ).
On terminera cet article en faisant remarquer, ainsi que l’expriment les
dessins gravés, que le dessus du chapiteau est creusé circulairement sur 2 mètres
(1) MM. Le Père, Dutertre, Protain, Norry.
(2) Cet instrument, aussi simple qu’ingénieux, avoit été imaginé et disposé par M. Le Père
(3) Voyez p l.je f, A . vol. V.