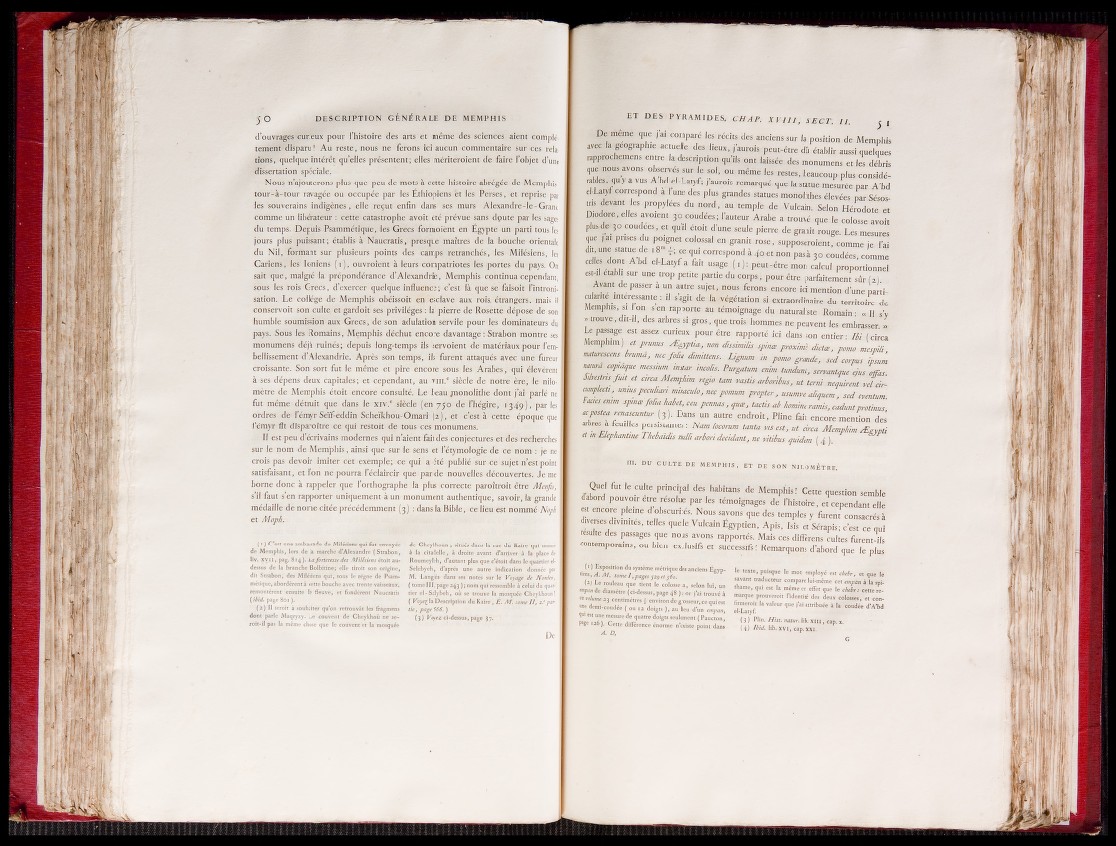
d’ouvrages curieux pour l’histoire des arts et même des sciences aient complètement
disparu! Au reste, nous ne ferons ici aucun commentaire sur ces relations,
quelque intérêt qu’elles présentent; elles mériteroient de faire l’objet d’une
dissertation spéciale.
Nous n’ajouterons plus que peu de mots à cette histoire abrégée de Memphis:
tour-à-tour ravagée ou occupée par les Ethiopiens et les Perses, et reprise par
les souverains indigènes, elle reçut enfin dans ses murs Alexandre-le-Grand
comme un libérateur : cette catastrophe avoit été prévue sans dçmte par les sages
du temps. Depuis Psammétique, les Grecs formoiènt en Egypte un parti tous les
jours plus puissant; établis à Naucratis, presque maîtres de la bouche orientale
du Nil, formant sur plusieurs points des camps retranchés, les Milésiens, les
Cariens, les Ioniens ( i ) , ouvroient à leurs compatriotes les portes du pays. On
sait que, malgré la prépondérance d’Alexandrie, Memphis continua cependant,
sous les rois Grecs, d’exercer quelque influence ; c’est là que se faisoit l’intronisation.
Le collège de Memphis obéissoit en esclave aux rois, étrangers, mais il
conservoit son culte et gardoit ses privilèges : la pierre de Rosette dépose de son
humble soumission aux Grecs, de son adulation servile pour les dominateurs du
pays. Sous les Romains, Memphis déchut encore davantage : Strabon montre ses
monumens déjà ruinés; depuis long-temps ils servoient de matériaux pour l’embellissement
d’Alexandrie. Après son temps, ils furent attaqués avec une fureur
croissante. Son sort fut le même et pire encore sous les Arabes, qui élevèrent
à ses dépens deux capitales; et cependant, au vm.c siècle de notre ère, le nilo-
mètre de Memphis étoit encore consulté. Le beau ynonolithe dont j’ai parlé ne
fut même détruit que dans le x iv .e siècle (en y yo de l’hégire, 1349), par les
ordres de l’émyr Séif-eddm Scheïkhou-Omari (2), et c’est à cette époque que
l’émyr fit disparoître ce qui restoit de tous ces monumens.
Il est peu d’écrivains modernes qui n’aient fait des conjectures et des recherches
sur le nom de Memphis, ainsi que sur le sens et l’étymologie de ce nom : je ne
crois pas devoir imiter cet exemple; ce qui a été publié sur-ce sujet n’est point
satisfaisant, et l’on ne pourra l’éclaircir que par de nouvelles découvertes. Je me
borne donc à rappeler que l’orthographe la plus correcte paroîtroit être Menfis,
s’il faut s’en rapporter uniquement à un monument authentique, savoir, la grande
médaille de nome citée précédemment (3) : dans la Bible, ce lieu est nommé Nopk
et Moph.
( i ) C est une ambassade de Milesiens qui fut envoyée de Cheykhoun , situés dans la rue du Kaire qui monte
de Memphis, lors de la marche d’Alexandre (Strabon, à la citadelle, à droite avant d’arriver à la place de
liv. XVII, pag. 814). La forteresse des Milésiens étoit au- Roumeyleh, d’autant plus que c’étoit dans le quartier eldessus
de la branche Bolbitine; elle tiroit son origine, Selebyeh, d’après une autre indication donnée par
dit Strabon, des Milésiens qui, sous le règne de Psam- M. Langlès dans ses notes sur le Voyage de Norden,
metique, abordèrent a cette bouche avec trente vaisseaux, ( tome III, page 243 )î nom qui ressemble à celui du quarremontèrent
ensuite le fleuve, et fondèrent Naucratis tier el-Salybeh, où se trouve la mosquée Cheykhoun!
( ibid. page 801 ). ( Voye^ la Description du Kaire , Ê. M . tome I I , 2/ par-
(2) 11 seroit à souhaiter qu’on retrouvât les fragmens tie, page 666. )
dont parle Maqryzy. Le couvent de Cheykhoû ne se- (3) Voyez ci-dessus, page 37.
roit-il pas la même chose que le couvent et la mosquée
De
De meme que j ai comparé les récits des anciens sur la position de Memphis
avec la géographie actuelle des lieux, j’aurois peut-être dû établir aussi quelques
rapprochemens entre la description qu’ils ont laissée des monumens et les débris
que nous avons observés K le sol, ou même les restes, beaucoup plus considérables,
quy a vus A bd el-Latyf; j’aurois remarqué que la statue mesurée par A ’bd
el-Latyf correspond a 1 une des plus grandes statues monolithes élevées par Sésos-
tns devant les propylées du nord, au temple de Vuicam. Selon Hérodote et
Diodore, elles ayoïent 30 coudées; l’auteur Arabe a trouvé que le colosse avoit
plus de- 30 coudees, et qu il étoit d’une seule pierre de granit rouge. Les mesures
que m prises du poignet colossal en granit rose, su p po sè ren t, comme je l’ai
dit une statue de 18“ -L; ce qui correspond à 4o et non pas à 30 coudées, comme
celles dont A bd el-Latyf a fait usage ( . ) : peut-être mon calcul proportionnel
est-il établi sur une trop petite partie du corps, pour être parfaitement sûr (2). '
Avant de passer a un autre sujet, nous ferons encore ici mention d’une particularité
intéressante ; il s agit de la végétation si extraordinaire du territoire de
Memphis, si 1 on s’en rapporte au témoignage du naturaliste Romain : « Il s’y
» trouve, dit-ii, des arbres si gros, que trois hommes ne peuvent les embrasser »
Le passage est assez curieux pour être rapporté ici dans son entier: Ibi (circa
Memphim ) et prunus Ægyptia, non dissimilis spinoe proximè dicta,, pomo mespili
maturescens brumâ, n u fol,a dimittens. Ugnum h, pomo grande, sed corpus ipsum
natura co p in e mess,um instar incolis. Purgatum enim tundunt, servantque eius ofFas.
Silvestns fu it et circa Memphm regto tam vastis arlortbus, ut terni nequirent vel cir-
cumplecti, un,us pecu/iari miracu/o, nec pomum propter , usumve aliquem, sed eventum.
Pactes emm spinoe folia lrnbet, ceu pennas, quoe, tactis a i homine ramis, cadunt protinus
acpostea. renascuntur (3). Dans un autre endroit, Pline fait encore mention des'
! reSw ; P ™ ntes : Nam locorum teinta vis est, ut circa Memphim Ægypti
et m Elephantme Thebaidis nulli arbori décidant, ne vitibus quidem ( 4 ).
m. D U C U L T E D E M E M P H I S , E T D E S O N
Quel fut le culte principal des habitans de Memphis! Cette question semble
dabord pouvoir etre résolue paries témoignages de l’histoire, et cependant elle
est encore pleine d obscurités. Nous savons que des temples y furent consacrés à
(verses divinités, telles que le Vulcain Egyptien, Apis, Isis et Sérapis; c’est ce qui
resuite des passages que nous avons rapportés. Mais ces différens cuites fiirent-ils
contemporains, ou bien exclusifs et successifs! Remarquons d’abord que le plus
\ § 1 <• -»« I I I « 1 1 « ¡g „
(»1 Le rouleau que rien/le cobsie a, selon lui, un Z e 1 ” T J e 7 T T f * P
empan de diamètre (ci-dessus naf»e AU \ - cr î’aî ♦ „ ' » * q est la meme en effet que le chebr : cette rec“
r , Î r " ' d0'êK MUl.ement ( PaUT ’ ( 3 > Plin- S ). Cette différence enorme n existe point dans (4) Ibid. ml ib .‘x- y"i°.t ucra-p «.* >x• x™i , cap. X.
A. D. r
G