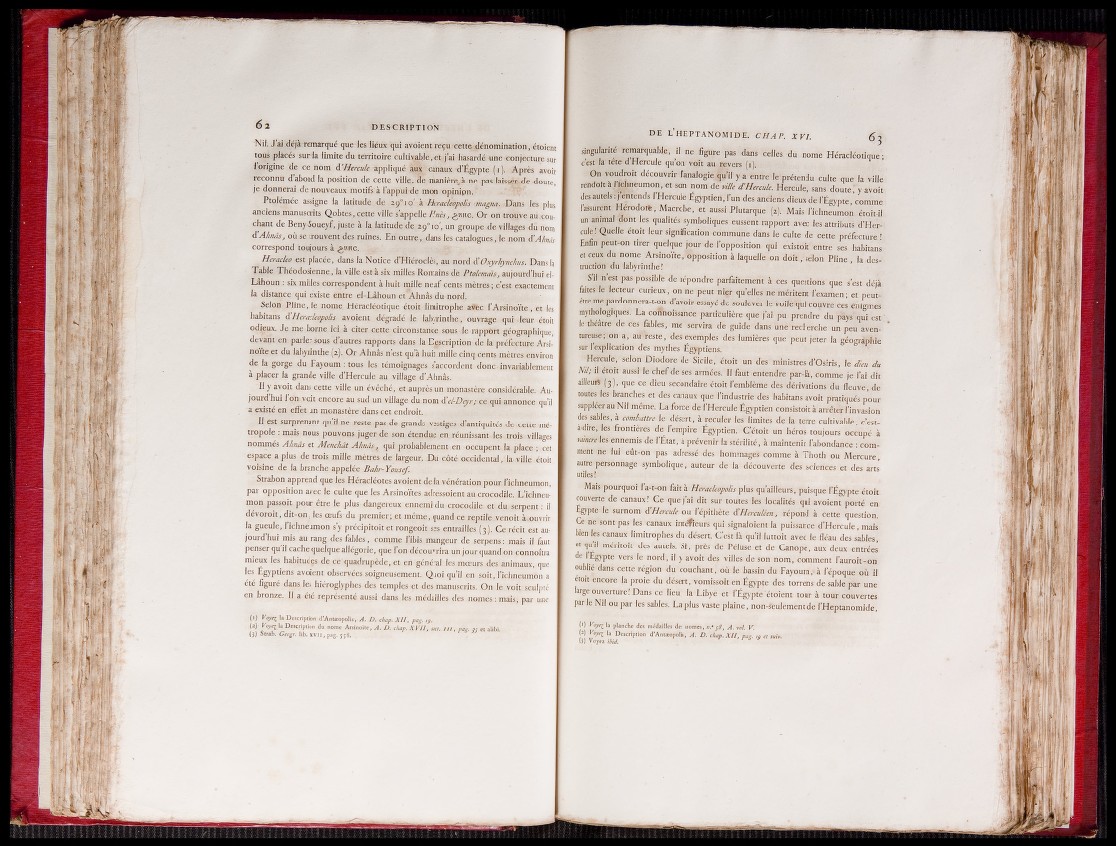
Nil. J ai déjà remarqué que les lieux qui avoient reçu cette dénomination, étoient
tous places sur-la limite du territoire cultivable, et j’ai hasardé une conjecture sur
1 origine de ce nom à ’Hercule appliqué aux canaux d’Égypte (i). Après avoir
reconnu d abord la position de cette ville, de manière^à ne pas laisser de doute,
je donnerai de nouveaux motifs à 1 appui de mon opinipn.
Ptolemee assigne la latitude dé 2p°io' à Heracleopolis -magna. Dans les plus
anciens manuscrits Qobtes, cette ville s appelle Hnès, ¿hhg. Or on trouve au cou-
chant de Beny-Soueyf, juste a la latitude de i o , un groupe de villages du nom
à’Ahnâs, où se trouvent des ruines. En outre, dans les catalogues, le nom A'Ahnâs
correspond toujours à ¿hkc.
Heracleo est placée, dans la Notice dHierodes, au nord ci’Oxyrïyuchus. Dans la
Table Théodosienne, la ville est a six milles Romains de P tolemeüs, aujourd’hui el-
Lahoun : six milles correspondent à huit mille neuf cents mètresi c’est exactement
la distance qui existe entre el-Lâhoun et Ahnâs du nord.
Selon Pline, le nome Héracléotique étoit limitrophe aVfec l’Arsinoïte , et les
habitans d’Heracleopolis avoient dégradé le labyrinthe, ouvrage qui-leur étoit
odieux. Je me borne ici à citer cette circonstance sous le rapport géographique,
devant en parler sous d’autres rapports dans la Description de la préfecture Arsi-
noite et du labyrinthe (2). Or Ahnâs n’est qu’à huit mille cinq cents mètres environ
de la gorge du Fayoum : tous les témoignages s’accordent donc invariablement
a placer la grande ville d’Hercule au village d’Ahnâs.
II y avoit dans cette ville un évêché, et auprès un monastère considérable. Au-
jourd hui 1 on voit encore au sud un village du nom à’el-Deyr; ce qui annonce qu’il
a existé en effet un monastère dans cet endroit.
Il est surprenant qu il ne reste pas de grands vestiges d’antiquités de cette métropole
.-mais nous pouvons juger de son étendue en réunissant les trois villages
nommés Ahnâs et Menchât Ahnâst qui probablement en occupent la place ; cet
espace a plus de trois mille mètres de largeur. Du côté occidental, la-ville étoit
voisine de la branche appelée Bahr-Yousef.
Strabon apprend que les Héracléotes avoient de la vénération pour l’ichneumon,
par opposition avec le culte que les Arsinoïtes adressoient au crocodile. L ’ichneumon
passoit pour être le plus dangereux ennemi du crocodile et du serpent : il
dévoroit, dit-on, les oeufs du premier; et même, quand ce reptile venoit à-.ouvrir
la gueule, l’ichneumon s’y précipitoit et rongeoit ses entrailles (3). Ce récit est au-
jourd hui mis au rang des fables, comme l’ibis, mangeur de serpens : mais il faut
penser qu il cache quelque allégorie, que l’on découvrira un jour quand on connoitra
mieux les habitudes de ce quadrupède, et en général les moeurs des animaux, que
les Egyptiens avoient observées soigneusement. Quoi qu’il en soit, l’ichneumon a
été figuré dans les hiéroglyphes des temples et des manuscrits. On le voit sculpté
en bronze. Il a été représenté aussi dans, les médailles des nomes : mais, par une
( 0 la Description d’Antatopoiis, A. D. chap. X I I , pag. tp.
(a)- Vcy^ h Description du nome Arsinolte, A. D. chap. X V I I , ceci. H t , pag. >; et alibi.
(3) Strab. Gcogr. lib. x v u , pag. 558.
singularité remarquable, il ne figure pas dans celles du nome Héracléotique ;
c’est la tete d Hercule quon voit au revers (i).
On voudrait découvrir l’analogie qu’il y a entre le prétendu culte que la ville
rendoit à I ichneumon, et son nom de ville d’Hercule. Hercule, sans doute,' y avoit
des autels : j entends 1 Hercule Égyptien, l’un des anciens dieux de l’Égypte comme
l’assurent Hérodotfe, Macrobe, et aussi Plutarque (2). Mais l’ichneumon étoit-il
un animal dont les qualités symboliques eussent rapport avec les attributs d’Hercule!
Quelle étoit leur signification commune dans le culte de cette préfecture !
Enfin peut-on tirer quelque jour de l’opposition qui existoit entre ses habitans
et ceux du nome Arsinoïte, Opposition à laquelle on doit I selon Pline , la destruction
du labyrinthe!
S’il n’est pas possible de répondre parfaitement à ces questions que s’est déjà
faites le lecteur curieux, on ne peut nier qu’elles ne méritent l’examen; et peut-
être me pardonnera-t-on d’avoir essayé de soulever le voile qui couvre ces énigmes
mythologiques. La connoissance particulière que j’ai pu prendre du pays qui est '
le théâtre de ces fiibles, me servira de guide dans une recherche un peu aventureuse;
011 a, au reste, des exemples des lumières que peut jeter la géographie
sur i explication des mythes Égyptiens.
Hercule, selon Diodore de Sicile, étoit un des ministres d’Osiris, le dieu du
Nil; il étoit aussi le chef de ses armées. Il faut entendre par-là, comme je l’ai dit
ailleurs (3), que ce dieu secondaire étoit l’emblème des dérivations du fleuve, de
toutes les branches et des canaux que l’industrie des habitans avoit pratiqués pour
suppléer au Nil même. La force de l’Hercule Égyptien consistoit à arrêter l’invasion
des sables, à combattre le désert, à reculer les limites de la terre cultivable, c’est-
a-dire, les frontières de l’empire Égyptien. C’étoit un héros toujours occupé à
vaincre les ennemis de 1 État, à prévenir la stérilité, à maintenir l’abondance : comment
ne lui eût-on pas adressé des hommages comme à Thoth ou Mercure,
autre personnage symbolique, auteur de la découverte des sciences et des arts
utiles !
Mais pourquoi 1 a-t-on fait à Heracleopolis plus qu’ailleurs, puisque l’Égypte étoit
couverte de canaux! Ce que j’ai dit sur toutes les localités qui avoient porté en
Egypte le surnom d Hercule ou I épithète d’Herculéen, répond à cette question.
Ce ne sont pas les canaux intéfieurs qui signaloient la puissance d’H ercule, mais
bien les canaux limitrophes du désert. C ’est là qu’il luttoit avec le fléau des sables,
et qu'il méritoit des autels. Si, près de Péluse et de Canope, aux deux entrées
de 1 Egypte veis le nord, il y avoit des villes de son nom, comment l’auroit-on
oublié dans cette région du couchant, où le bassin du Fayoum,-à l’époque où il
etoit encore Ja proie du désert, vomissoit en Égypte des torrens de sable par une
large ouverture! Dans ce lieu, la Libye et l’Égypte étoient tour à tour couvertes
par le Nil ou par les sables. La plus vaste plaine, non-s’eulement de l’Heptanomide,
(1) Vopeç la planche des médailles des nomes, p.* j S , A . vol. V.
W P°yei la Description d'Antteopolis, A. D. chap. X I I , pag. to a suiv
(3) Voyez ibid.