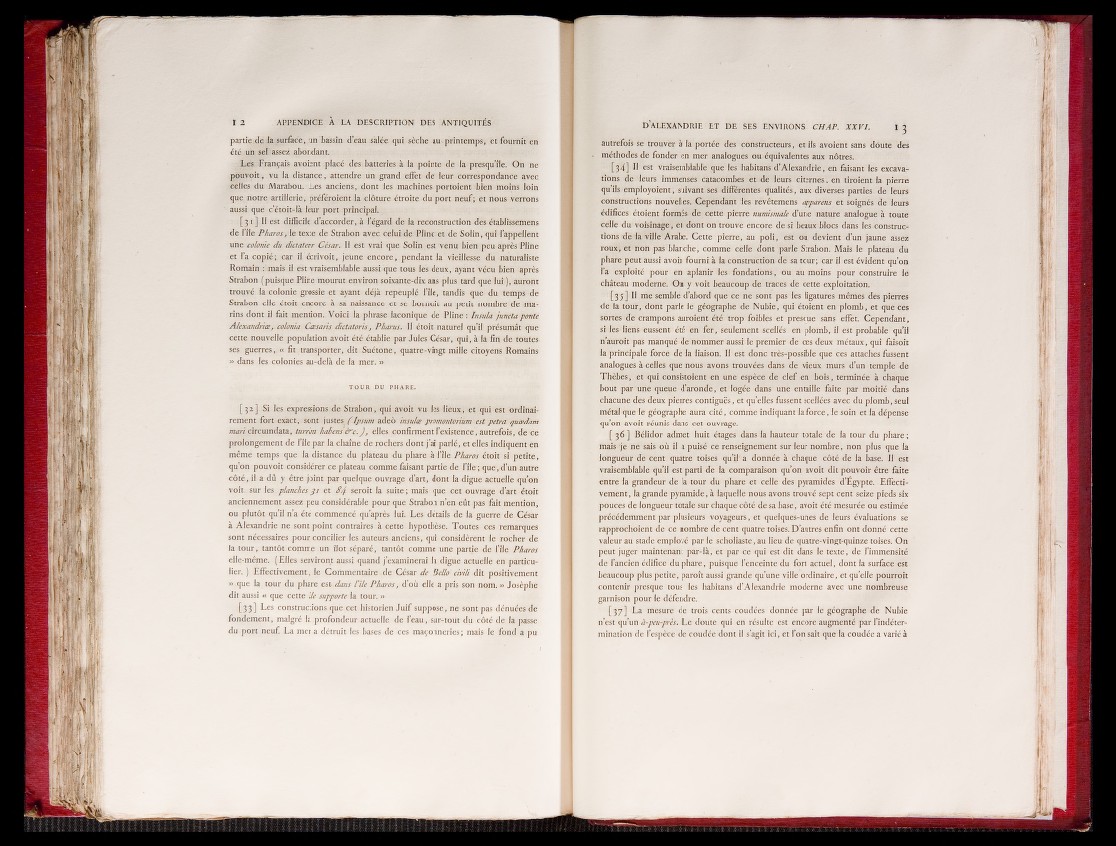
partie de fa surface, un bassin d’eau salée qui sèche au-printemps, et fournit en
été un sel assez abondant.
Les Français avoient placé des batteries à la pointe de la presqu’île. On ne
pouvoit, vu la distance, attendre un grand effet de leur correspondance avec
celles du Marabou. Les anciens, dont les machines portoient bien moins loin
que notre artillerie, préféroient la clôture étroite du port neuf; et nous verrons
aussi que c’étoit-là leur port principal.
[3 1 ] Il est difficile d’accorder, à l’égard de la reconstruction des établissemens
de l’île Pharos, le texte de Strabon avec celui de Pline et de Solin, qui l’appellent
une colonie du dictateur César. Il est vrai que Solin est venu bien peu après Pline
et l’a copié; car il écrivoit, jeûne encore, pendant la vieillesse du naturaliste
Romain : mais il est vraisemblable aussi que tous les deux, ayant vécu bien après
Strabon (puisque Pline mourut environ soixante-dix ans plus tard que lui ), auront
trouvé la colonie grossie et ayant déjà repeuplé l’île, tandis que du temps de
Strabon elle étoit encore à sa naissance et se bornoit au petit nombre de marins
dont il fait mention. Voici la phrase laconique de Pline : Insula juncta ponte
Alexandrioe, colonia Coesaris dictatoris, Pharus. Il étoit naturel qu’il présumât que
cette nouvelle population avoit été établie par Jules César, qui, à lâ fin de toutes
ses guerres, « fit transporter, dit Suétone, quatre-vingt mille citoyens Romains
» dans les colonies au-delà de la mer. »
T O U R D U P H A R E .
[32.] Si les expressions de Strabon, qui avoit vu les lieux, et qui est ordinairement
fort exact, sont justes^ f Ipsum adeô insuloe promo/itorium est petra quoedam
mari circumdata, turrim habens fr c .) , elles confirment l’existence, autrefois, de ce
prolongement de l’île par la chaîne de rochers dont j ’ai parié, et elles indiquent en
même temps que la distance du plateau du phare à l’île Pharos étoit si petite,
qu’on pouvoit considérer ce plateau comme faisant partie de l’île; que,d’un autre
côté, il a dû y être joint par quelque ouvrage d’art, dont la digue actuelle qu’on
voit, sur les planches 3 1 et 8//. seroit la suite; mais que cet ouvrage d’art étoit
anciennement assez peu considérable pour que Strabon n’en eût pas fait mention,
ou plutôt qu’il n’a été commencé qu’après lui. Les détails de la guerre de César
à Alexandrie ne sont point contraires à cette hypothèse. Toutes ces remarques
sont nécessaires pour concilier les auteurs anciens, qui considèrent le rocher de
la tour, tantôt comme un îlot séparé, tantôt comme une partie de l’île Pharos
elle-même. ( Elles serviront aussi quand j’examinerai la digue actuelle en particulier.
) Effectivement, le Commentaire de César de Bcllo civili dit positivement
» que la tour du phare est dans l'île Pharos, d’où elle a pris son nom. » Josèphe
dit aussi « que cette île supporte la tour. »
[33] Les constructions que cet historien Juif suppose, ne sont pas dénuées de
fondement, malgré la profondeur actuelle de l’eau, sur-tout du côté de la passe
du port neuf. La mer a détruit les bases de ces maçonneries; mais le fond a pu
autrefois se trouver à la portée des constructeurs, et ils avoient sans doute des
méthodes de fonder en mer analogues ou équivalentes aux nôtres.
[3 4 ] H est vraisemblable que les habitans d’Alexandrie, en faisant les excavations
de leurs immenses catacombes et de leurs citernes, en tiroient la pierre
quils employoient, suivant ses différentes qualités, aux diverses parties de leurs
constructions nouvelles. Cependant les revêtemens appareils et soignés de leurs
édifices étoient formés de cette pierre numismale d’une nature analogue à toute
celle du voisinage, et dont on trouve encore de si beaux blocs dans les constructions
de la ville Arabe. Cette pierre, au poli, est ou devient d’un jaune assez
roux, et non pas blanche, comme celle dont parle Strabon. Mais le plateau du
phare peut aussi avoir fourni à la construction de sa tour; car il est évident qu’on
l’a exploité pour en aplanir les fondations, ou au moins pour construire le
château moderne. On y voit beaucoup de traces de cette exploitation.
[35] Il me semble d’abord que ce ne sont pas les ligatures mêmes des pierres
de la tour, dont parle le géographe de Nubie, qui étoient en plomb, et que ces
sortes de crampons auroient été trop foibles et presque sans effet. Cependant,
si les liens eussent été en fer, seulement scellés en plomb, il est probable qu’il
n’auroit pas manqué de nommer aussi le premier de ces deux métaux, qui faisoit
la principale force de la liaison. II est donc très-possible que ces attaches fussent
analogues à celles que nous avons trouvées dans de vieux murs d’un temple de
Thèbes, et qui consistoient en une espèce de clef en bois, terminée à chaque
bout par une queue d’aronde, et logée dans une entaille faite par moitié dans
chacune des deux pierres contiguës, et qu’elles fussent scellées avec du plomb, seul
métal que le géographe aura cité, comme indiquant la force, le soin et la dépense
qu’on avoit réunis dans cet ouvrage.
[ 3 6 1 Bélidor admet huit étages dans la hauteur totale de la tour du phare ;
mais je ne sais où il a puisé ce renseignement sur leur nombre, non plus que la
longueur de cent quatre toises qu’il a donnée à chaque côté de la base. Il est
vraisemblable qu’il est parti de la comparaison qu’on avoit dit pouvoir être faite
entre la grandeur de la tour du phare et celle des pyramides d’Egypte. Effectivement,
la grande pyramide, à laquelle nous avons trouvé sept cent seize pieds six
pouces de longueur totale sur chaque côté de sa base, avoit été mesurée ou estimée
précédemment par plusieurs voyageurs, et quelques-unes de leurs évaluations se
rapprochoient de ce nombre de cent quatre toises. D ’autres enfin ont donné cette
valeur au stade employé par le scholiaste, au lieu de quatre-vingt-quinze toises. On
peut juger maintenant par-là, et par ce qui est dit dans le texte, de l’immensité
de l’ancien édifice du phare, puisque l’enceinte du fort actuel, dont la surface est
beaucoup plus petite, paroît aussi grande qu’une ville ordinaire, et qu’elle pourroit
contenir presque tous les habitans d’Alexandrie moderne avec une nombreuse
garnison pour le défendre.
[3 7 ] La mesure de trois cents coudées donnée par le géographe de Nubie
n’est qu’un à-peu-près. Le doute qui en résulte est encore augmenté par l’indétermination
de l’espèce de coudée dont il s’agit ici, et l’on sait que la coudée a varié à