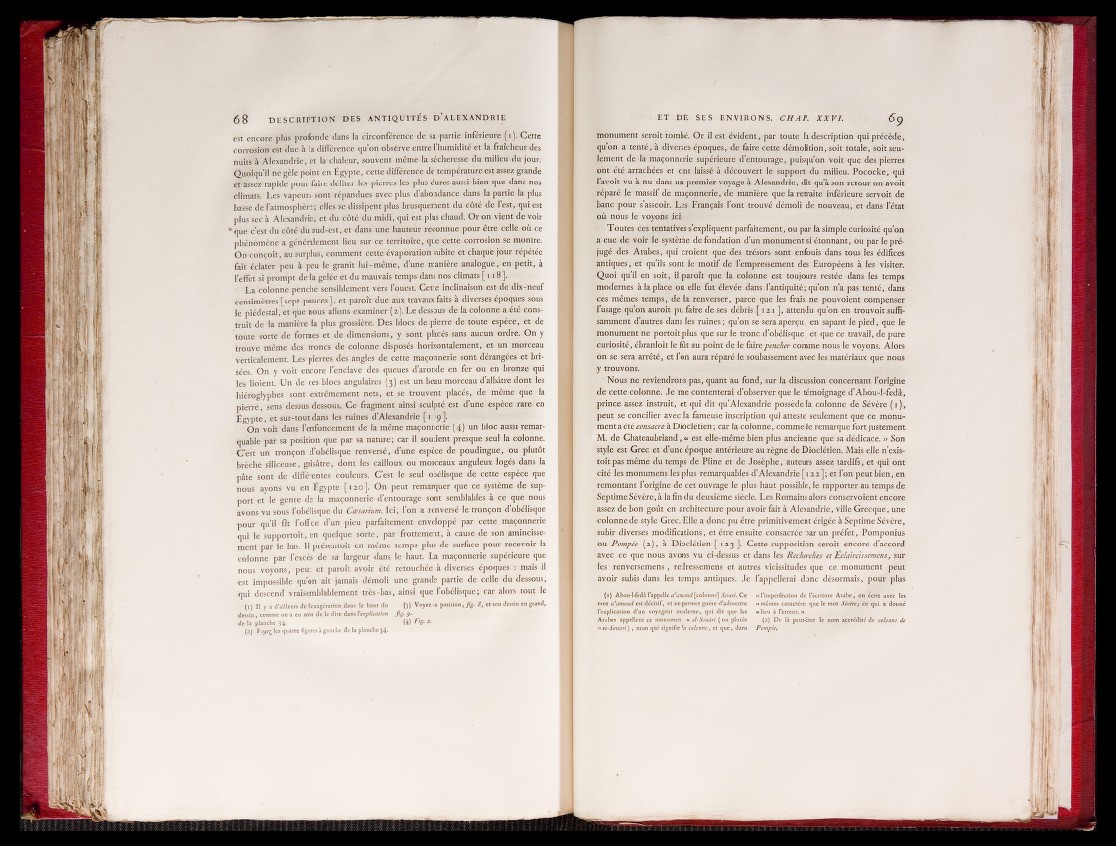
est encore plus profonde dans Ici cu*confcrence de s cl partie inférieure J i j. Cette
corrosion est due-à la différence qu’on obsèrve entre l’humidité et la fraîcheur des
nuits à Alexandrie, et la chaleur, souvent même la sécheresse du milieu du jour.
Quoiqu’il ne gèle point en Egypte, cette différence de température est assez grande
et assez rapide pour faire déliter les pierres les plus dures aussi-bien que dans nos
Climats. Les vapeurs sont répandues avec plus d abondance dans la partie la plus
basse de l’atmosphère; elles se dissipent plus brusquement du côté de l’est, qui est
plus sec à Alexandrie, et du côté du midi, qui est plus chaud. Or on vient de voir
que c’est du côté du sud-est, et dans une hauteur reconnue pour être celle où ce
phénomène a généralement lieu sur ce territoire, que cette corrosion se montre.
On conçoit, au surplus, comment cette évaporation subite et chaque jour répétée
fait éclater peu à peu le granit lui-même, d’une manière analogue, en petit, à
l’effet si prompt de la gelée et du mauvais temps dans nos climats [ 1 1 8].
La colonne penche sensiblement vers l’ouest. Cette inclinaison est de dix-neuf
centimètres i sept pouces J, et paroît due aux travaux faits a diverses époques sous
le piédestal, et que nous allons examiner (2). Le dessous de la colonne a été construit
de la manière la plus grossière. Des blocs de pierre de toute espèce, et de
toute sorte de formes et de dimensions, y sont placés sans aucun ordre. On y
trouve même des troncs de colonne disposés horizontalement, et un morceau
verticalement. Les pierres des angles de cette maçonnerie sont dérangées et brisées.
On y voit encore l’enclave des queues d’aronde en fer ou en bronze qui
les lioient. Un de ces blocs angulaires (3) est un beau morceau d’albâtre dont les
hiéroglyphes sont extrêmement nets, et se trouvent placés, de même que la
pierre, sens dessus dessous. Ce fragment ainsi sculpté est d’une espèce rare en
Egypte, et sur-tout dans les ruines d’Alexandrie [ 1 19 ] .
On voit dans l’enfoncement de la même maçonnerie (4 ) un f l ° c aussi remarquable
par sa position que par sa nature ; car il soutient presque seul la colonne.
C ’est un tronçon d’obélisque renversé, d’une espèce de poudingue, ou plutôt
brèche siliceuse, grisâtre, dont les cailloux ou morceaux anguleux logés dans la
pâte sont de différentes couleurs. C ’est le seul obélisque de cette espèce que
nous ayons vu en Égypte [ 120]. On peut remarquer que ce système de support
et le genre de la maçonnerie d’entourage sont semblables à ce que nous
avons vu sous l’obélisque du Coesarium. Ici, l’on a renversé le tronçon d obélisque
pour qu’il fit l’office d’un pieu parfaitement enveloppé par cette maçonnerie
qui le supportoit, en quelque sorte, par frottement, à cause de son amincissement
par le bas. Il présentoit en même temps plus de surface pour recevoir la
colonne par l’excès de sa largeur dans le haut. La maçonnerie supérieure que
nous voyons, peut et paroît avoir été retouchée à diverses époques : mais il
est impossible qu’on ait jamais démoli une grande partie de celle du dessous,
qui descend vraisemblablement très-bas, ainsi que l’obélisque; car alors tout le
■ (1) II y a d’ailleurs de l’exagération dans le haut du (3) Voyez sa position,/g. 8, et son dessin en grand,
dessin, comme on a eu soin de le dire dans Yexplication fig. p.
de la planche 34* i||| 2’
(2) Voyez les quatre figures à gauche de la planche 34.
monument seroit tombé. Or il est évident, par toute la description qui précède,
quon a tenté, à diverses époques, de faire cette démolition, soit totale, soit seulement
de la maçonnerie supérieure d’entourage, puisqu’on voit que des pierres
ont été arrachées et ont laissé à découvert le support du milieu. Poçocke, qui
favoit vu à nu dans un premier voyage à Alexandrie, dit qu’à son retour on avoit
réparé le massif de maçonnerie, de manière que la retraite inférieure servoit de
banc pour s’asseoir. Les Français l’ont trouvé démoli de nouveau, et dans l’état
où nous le voyons ici.
Toutes ces tentatives s’expliquent parfaitement, ou par la simple curiosité qu’on
a eue de voir le système de fondation d’un monument si étonnant, ou par le préjugé
des Arabes, qui croient que des trésors sont enfouis dans tous les édifices
antiques, et qu’ils sont le motif de l’empressement des Européens à les visiter.
Quoi qu’il en soit, il paroît que la colonne est toujours restée dans les temps
modernes à la place où elle fut élevée dans l’antiquité; qu’on n’a pas tenté, dans
ces mêmes temps, de la renverser, parce que les frais ne pouvoient compenser
l’usage qu’on auroit pu faire de ses débris [ 1 2 1 ] , attendu qu’on en trouvoit suffisamment
d’autres dans les ruines ; qu’on se sera aperçu, en sapant le pied, que le
monument ne portoit plus que sur le tronc d’obélisque, et que ce travail, de pure
curiosité, ébranioit le fût au point de le faire pencher comme nous le voyons. Alors
on se sera arrêté, et l’on aura réparé le soubassement avec les matériaux que nous
,y trouvons.
Nous ne reviendrons pas, quant au fond, sur la discussion concernant l’origine
de cette colonne. Je me contenterai d’observer que le témoignage d’Abou-l-fedâ,
prince assez instruit, et qui dit qu’Alexandrie possède la colonne de Sévère ( 1 ),
peut se concilier avec la fameuse inscription qui atteste seulement que ce monument
a été consacré à Dioclétien ; car la colonne, comme le remarque fort justement
M. de Chateaubriand, « est elle-même bien plus ancienne que sa dédicace. » Son
style est Grec et d’une époque antérieure au règne de Dioclétien. Mais elle n’exis-
toitpas même du temps de Pline et de Josèphe, auteurs assez tardifs, et qui ont
cité les monumens les plus remarquables d’Alexandrie [ 122]; et l’on peut bien, en
remontant l’origine de cet ouvrage le plus haut possible, le rapporter au temps de
Septime Sévère, à la fin du deuxième siècle. Les Romains alors conservoient encore
assez de bon goût en architecture pour avoir fait à Alexandrie, ville Grecque, une
colonne de style Grec. Elle a donc pu être primitivement érigée à Septime Sévère,
subir diverses modifications, et être ensuite consacrée par un préfet, Pomponius
ou Pompée (2), à Dioclétien [ 123 ]. Cette supposition seroit encore d’accord
avec ce que nous avons vu ci-dessus et dans les Recherches et Eclaircissemens, sur
les renversemens , redressemens et autres vicissitudes que ce monument peut
avoir subis dans les temps antiques. Je l’appellerai donc désormais, pour plus
(1) Abou-l-fedâ l’appelle a’amoud [colonne] Severi. Ce » l'imperfection de l’écriture Arabe, on écrit avec les
mot a’amoud est décisif, et ne permet guère d’admettre » mêmes caractères que le mot Sévlre; ce qui a donné
l’explication d’un voyageur moderne, qui dit que les »lieu à l’erreur.»
Arabes appellent ce monument « el-Souari (ou plutôt (2) De là .peut-ctre le nom accrédité de colonne de
» es-Souari ) , nom qui signifie la colonne, et que, dans Pompée.