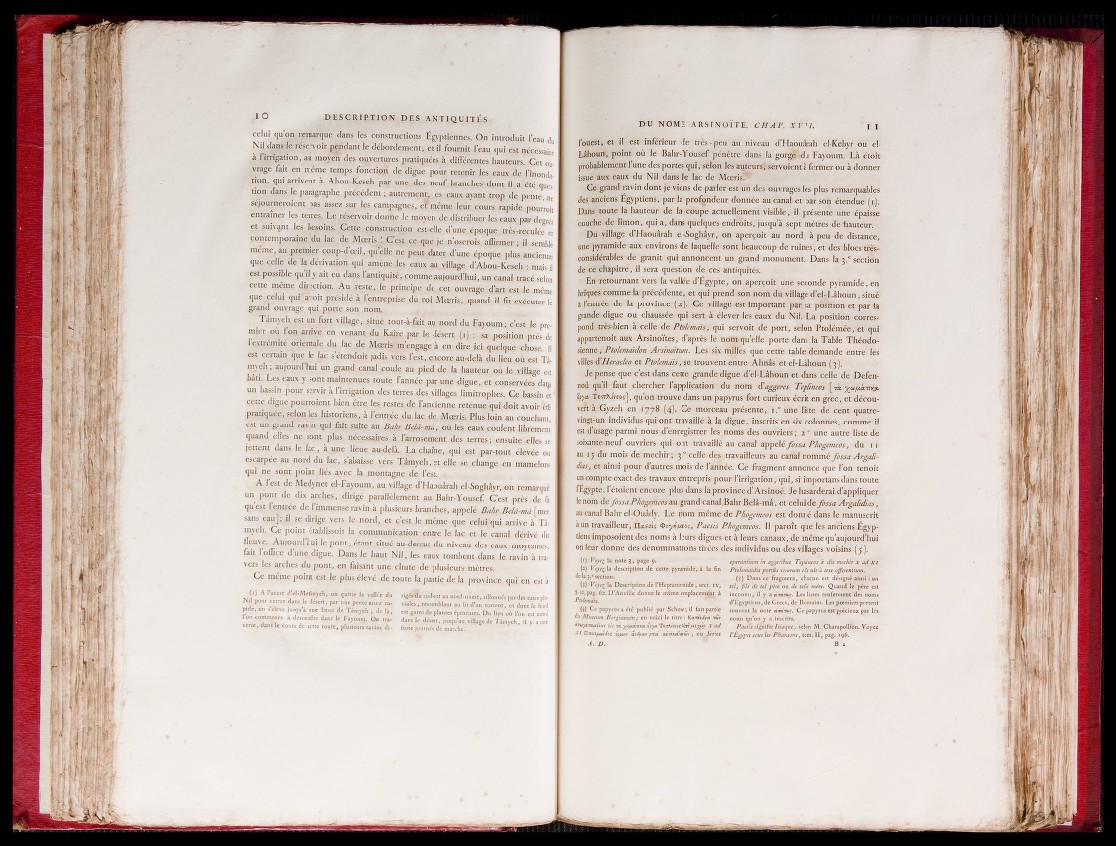
celui quon remarque dans les constructions Égyptiennes. On introduit l'eau J
Ntl dans le réservoir pendant le débordement, et il fournit l’eau qui est nécessaire
à 1 irrigation, au moyen des ouvertures pratiquées à différentes hauteurs. Cet ou-
vrage fait en même temps fonction de digue pour retenir les eaux de l’inonda-
tion, qui arrivent à Abou-Keseh par une des neuf branches dont il a été qUes.
tion dans le paragraphe précédent ; autrement, les eaux ayant trop de pente, ne
séjourneraient pas assez sur les campagnes, et même leur cours rapide pourroit
entraîner les terres. Le réservoir donne le moyen de distribuer les eaux par degré
et suivant les besoins. Cette construction est-elle d’une époque très-reculée et
contemporaine du lac de Moeris 1 C’est ce que je n’oserois affirmer ; il semble
même, au premier coup-d’oeil, qu’elle ne peut dater d’une époque plus ancienne
que celle de la dérivation qui amène les eaux au village d’Abou-Keseh : mais il
est possible qu’il y ait eu dans l’antiquité, comme aujourd’hui, un canal tracé selon
cette même direction. A u reste, le principe de cet ouvrage d’art est le même
que celui qui avoit présidé à l’entreprise du roi Moeris, quand il fit exécuter le
grand ouvrage qui porte son nom.
Tâmyeh est un fort village, situé tout-à-fait au nord du Fayoum; c’est le premier
où l’on arrive en venant du Kaire par le désert (i) : sa position près de
1 extrémité orientale du lac de Moeris m’engage à en dire ici quelque chose. Il
est certain que le lac sétendoit jadis vers l’est, encore au-delà du lieu où est Tâmyeh
; aujourd’hui un grand canal coule au pied de la hauteur où le village est
bâti. Les eaux y sont maintenues toute l’année par une digue, et conservées dans
un bassin pour servir à 1 irrigation des terres des villages limitrophes. Ce bassin et
cette digue pourraient bien être les restes de l’ancienne retenue qui doit avoir crê
pratiquée, selon les historiens, à l’entrée du lac de Moeris, Plus loin au couchant,
est un grand ravin qui fait suite au Bahr Belâ-mâ, où les eaux coulent librement
quand elles ne sont plus nécessaires à l’arrosement des terres; ensuite elles se
jettent dans le la c, à une lieue au-delà. La chaîne, qui est par-tout élevée ou
escarpée au nord du lac, s’abaisse vers Tâmyeh, et elle se change en mamelons
qui ne sont point liés avec la montagne de l’est. .
A lest de Medynet el-Fayoum, au village d’Haouârah el-Soghâyr, on remarque
un pont de dix arches, dirigé parallèlement au Bahr-Yousef C ’est près de là
qu’est l’entrée de l’immense ravin à plusieurs branches, appelé Bahr Belâ-mâ [mer
sans eau]; il se dirige vers le nord, et c’est le même que celui qui arrive à Tâmyeh.
Ce point établissoit la communication entrele lac et le canal dérivé du
fleuve. Aujourdhui le pont, étant situé au-dessus du niveau des eaux moyennes,
fait 1 office d une digue. Dans le haut N il, les eaux tombent dans le ravin à travers
les arches du pont, en faisant une chute de plusieurs mètres.
Ce même point est le plus élevé de toute la partie de la province qui en est à
(i) A l’ouest d’el-Metânyeh, on qnrae la yallôc du rigàrd» sud-est au nord-ouest, sillonnés par des eaux pl-
N.I pour entrer dans 1 desert; par une pente assez ra- viales, ressemblant au lit d'un torrent, et dont le fond
ptde, on Seleve ,usqua une lieue de Tâmyeh ; de là, est garni de plantes épineuses. Du lieu où l’on est entré
11 on commence a descendre dans le Fayoum. On tra- dans le désert, jusqu’au village de Tâmyeh, il y a une
verse, dans le cours de cette route, plusieurs ravins di- forte journée de marche.
l’ouest, et il est inférieur de très-peu au niveau d’Haouârah el-Kebyr ou el-
Lâhoun, point ou le Bahr-Yousef pénètre dans la gorge du Fayoum. Là étoit
probablement l’une des portes qui, selon les auteurs; servoient à fermer ou à donner
issue aux eaux du Nil dans le lac de Moerisf1'
Ce grand îavin dont je viens de parler est un des ouvrages les plus remarquables
des anciens Égyptiens, parla profondeur donnée au canal et par son étendue (i).
Dans toute la hauteur de la coupe actuellement visible, il présente une épaisse
couche de limon, qui a, dans quelques endroits, jusqu’à sept mètres de hauteur.
Du village d’Haouârah el-Soghâyr, on aperçoit au nord, à peu de distance,
une pyramide aux environs de laquelle sont beaucoup de ruines, et des blocs très-
considérables de granit qui annoncent un grand monument. Dans la 3.“ section
de ce chapitre, il sera question de ces antiquités.
En retournant vers la vallée d’Égypte, on aperçoit une seconde pyramide, en
briques comme la précédente, et qui prend son nom dû village d’el-Lâhoun, situé
à l’entrée de la province ( 2 ). Ce village est important par sa position et par la
grande digue .ou chaussée qui sert à élever les eaux du Nil. La position correspond
très-bien à celle de Ptolemàis, qui servoit de port, selon Ptoléméë, et qui
appartenoit aux Arsinoïtes, d’après le nom qu’elle porte dans la Table Théodo-
sienne, Ptolemàidon Arsinoitum. Les six milles que cette table demande entre les
villes SHeracleo et Ptolemdis, se trouvent entre Ahnâs et el-Lâhoun (3).
Je pense que c’est dans cette grande digue d’el-Lâhoun et dans celle de Defen-
noû qu’il faut chercher l’application du nom d'aggeres Teplineos [ râ ya/xi«*#.
ifya. TsvzXfvEo«], qu’on trouve dans un papyrus fort curieux écrit en grec, et découvert
à Gyzeh en 1778 (4). Ce morceau présente, i.° une liste de cent quatre-
vingt-un individus qui ont travaillé à la digue, inscrits en six colonnes, comme il
est d’usage parmi nous d’enregistrer les noms des ouvriers ; 2.0 une autre liste de
soixante-neuf ouvriers qui ont travaillé au canal a.ppe\é fossa Phogemeos, du 1 1
au 1 y du mois de mechir; 3.° celle des travailleurs au canal nommé fossa Argali-
dias'j et ainsi pour d autres.mois de l’année. Ce fragment annonce que l’on tenoit
un compte exact des travaux entrepris pour l’irrigation, qui, si importans dans toute
I Egypte, 1 étoient encore plus dans la province d’Arsinoé. Je hasarderai d’appliquer
le nom de fossa Phogemeos au grand canal,Bahr Belâ-mâ, et celui de fossa Argalidias,
au canal Bahr el-Ouâdy. Le nom même de Phogemeos est donné dans le manuscrit
a un travailleur, ILteuis 4>oyi/Moç, Paesis Phogemeos. Il paraît que les anciens Égyptiens
imposoient des noms à leurs digues et à leurs canaux, de même qu’aujourd’hui
on leur donne des dénominations tirées des individus ou des villages voisins (y ).
(1) Voyeç la note 3, page 9.
(2) Voye^ la description de cette pyramide, à la fin
de la 3.c section.
(3) Voye^ la Description de FHeptanomide, sect. iv ,
S- il, pag. 62. D ’Anviile donne le même emplacement à
Ptolemàis.
(4) Ce papyrus a été publié par Schow; il fait partie
du Muséum Borgianum ; en voici le titre : K.amrtya twv
tf’npytmfiiïuv tiç m %0/jutHKa, ipyt TtîïAmof S&rè pi%y> X ad
XI HitM/jutiJbç op/xov arfour pirtt aùmutlavm, ou Sériés
A. D .
opérantium iit aggeribus Teplineos à die mechir X ad X I
Ptolemaidis portûs virorum 181 ultro sese offerentium.
(5) Dans ce fragment, chacun est désigné ainsi : un
tel, f i s de tel père ou de telle mère. Quand le père est
inconnu, il y a Les listes renferment des noms
d’E gvptiens, de Grecs, de Romains. Les premiers portent
souvent la note àzumj>. Ce papyrus est précieux par les
noms qu’on y a inscrits.
Paesis signifie Isiaque, selon M. Champollion. Voyez
V'Egypte sous les Pharaons} tom. I I , pag. 196.
B |