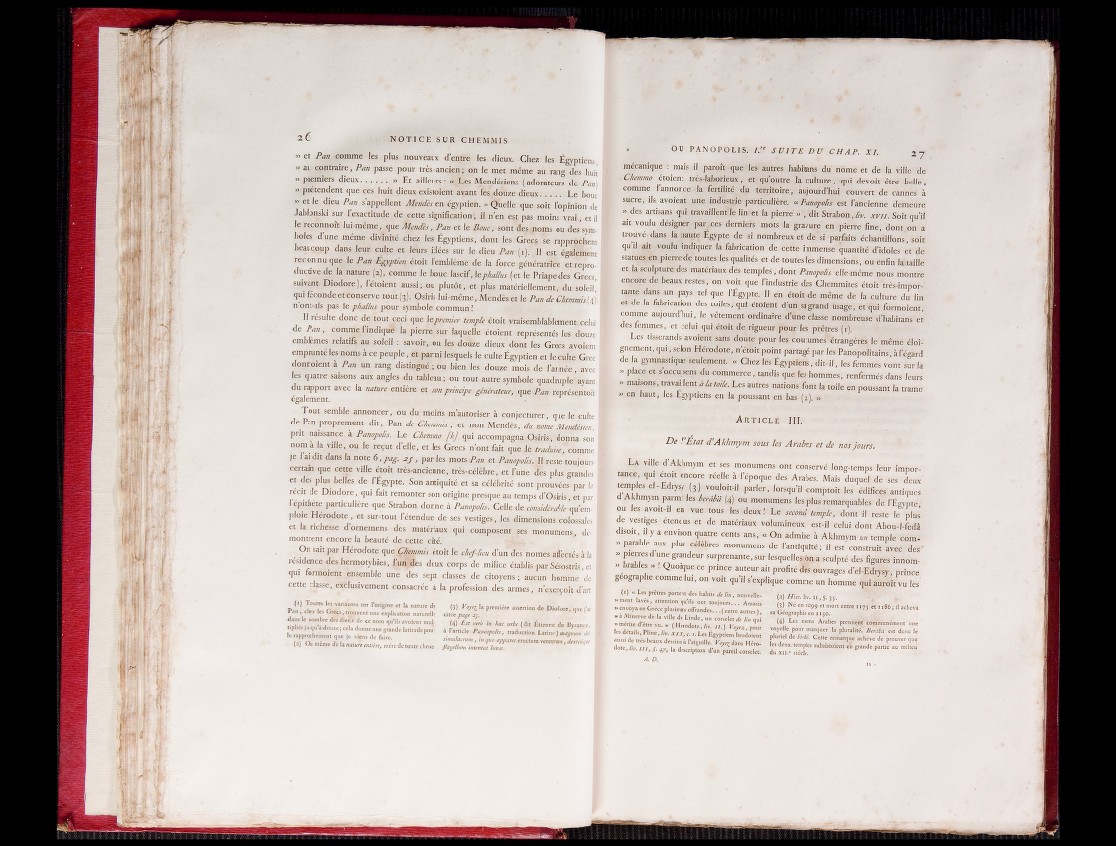
« e t Pan comme les plus nouveaux d’entre les dieux. Chez les Égyptiens,
» au contraire, Pan passe pour très-ancien; on Je met même au rang des huit
I PrÇnuers dieux » Et ailleurs; « Les Mendésiens (adorateurs de Pan]
» prétendent que ces huit dieux existoient avant les douze dieux Le houe
» et le dieu Pan s’appellent Mendès en égyptien. » Quelle que soit l’opinion de
Jahlonski sur l’exactitude de cette signification| il n’en est pas moins vrai, et il
le reconnoît lui-même| que Mendès, Pan et le Bouc, sont des noms ou des’ sym-
holes d une même divinité chez les Égyptiens, dont les Grecs se rapprochent
beaucoup dans leur culte et leurs idées sur le dieu Pan-{i). 11 est également
reconnu que le Pan Égyptien étoit l’emblème de la force génératrice et reproductive
de la nature (2), comme le bouc lascif, le phallus (et le Priape des Grecs,
suivant Diodore), l’étoient aussi; ou plutôt, et plus matériellement, du soleil’
qui féconde et conserve tout (3). Osiris lui-même, Mendès et le Pan de ChemmisÙ]
II ont-ils pas le phallus pour symbole commun !
Il résulte donc de tout ceci que le premier temple étoit vraisemblablement celui
de P a n , comme 1 indique la pierre sur laquelle étoient représentés les douze
emblèmes relatifs au soleil : savoir, ou les douze dieux dont les Grecs avoient
emprunté les noms à ce peuple, et parmi lesquels le culte Égyptien et le culte Grec
donnoient l Pan un rang distingué ; ou bien les douze mois de l’année , avec
les quatre saisons aux angles du tableau ; ou tout autre symbole quadruple ayant
du rapport avec la nature entière et son principe générateur, que Pan représentoit
également.
Tout semble annoncer, ou du moins m’autoriser à conjecturer, que le culte
de Pan proprement dit, Pan de Clemmis, et non Mendès, du nome Mendésien,
prit naissance à Panopolis. Le Chemmo [h ] qui accompagna Osiris, donna son
nom à la ville, ou le reçut d’elle, et les Grecs n’ont fait que le traduire,*comme
je la i dit dans la note 6 ,pag. s>y, par les mots Pan et Panopolis. Il reste toujours
certain que cette ville étoit très-ancienne, très-célèbre, et l’une des plus grandes
et des plus belles de 1 Égypte. Son antiquité et sa célébrité sont prouvées par le
récit de Diodore, qui fait remonter son origine presque au temps d’Ôsiris, et par
1 epithète particulière que Strabon donne à Panopolis. Celle de considérable réemploie
Herodote, et sur-tout l’étendue de ses vestiges, les dimensions colossales I
et la richesse dornemens des matériaux qui composent ses monumens, dé- I
montrent encore la beauté de cette cité.
| P n san Par Hérodote que Çjtfmis étoit le chef-lieu d’un des nomes affectés à la I
résidence des hermotybies, l’un des deux corps de milice établis par Sésostris, et I
qui formoient ensemble une des sept classes de citoyens ; aucun homme de I
cette classe, exclusivement consacrée à la profession des armes, n’exerçoit d’art I
« J f T°Ut“ Iîf ïar!a"KS « la na ture d e (3) ÆÊ la première assertion d e D io d o r e , que j'ai I
’ ch e z les G r e c s , trou v en t u n e e xp lica tio n n a turelle c ité e p a g e 2 j .
d am te nombre dès d ie u * d e c e nom qu’ils a v o ien t mut- (4) E s t verb m h ac urbe ( d i t ¿ t ie n n e d e Byzance, I
f:pr:;;roX:lT;r;\t::rfrndebti,”depour t t /wm" ,raduc,ion **»3 * I
(a) Ou même de la nature entière^ mère de toute chose. l ‘¿ Z Z T ' ^ \
mécanique : mais il paroît que les autres habitans du nome et de la ville de
Chemmo étoient très-laborieux, et qu’outre la culture, qui devoit être belle,
comme 1 annonce la fertilité du territoire, aujourd’hui couvert de cannes à
sucre, ils avoient une industrie particulière. « Panopolis est l’ancienne demeure
« des artisans qui travaillent le lin et la pierre' » , dit Strabon, liv. xvii . Soit qu’il
ait voulu désigner par.ces derniers mots la gravure en pierre fine, dont on a
trouvé^ dans la haute Égypte de si nombreux et de si parfaits échantillons , soit
qu il ait voulu indiquer la fabrication de cette immense quantité d’idoles et de
statues en pierre de toutes les qualités et de toutes les dimensions, ou enfin la taille
et la sculpture des matériaux des temples, dont Panopolis elle-même nous montre
encore de beaux restes, on voit que l’industrie des Chemmites étoit très-importante
dans un pays tel que l’Égypte. Il en étoit de même de la culture du lin
et de la fabrication des toiles,qui étoient d’un si grand usage, et qui formoient,
comme aujourd’hui, le vêtement ordinaire d’une classe nombreuse d’habitans et
des femmes, et celui qui étoit de rigueur pour les prêtres (i).
Les tisserands avoient sans doute pour les coutumes'’étrangères le même éloignement,
qui, selon Hérodote, n’étoit point partagé par les Panopolitains à l’égard
de la gymnastique seulement. « Chez les Égyptiens, dit-il, les femmes vont sur la
« place et s occupent du commerce, tandis que les hommes, renfermés dans leurs
« maisons, travaillent à la toile. Les autres nations font la toile en poussant la trame
« en haut, les Egyptiens en la poussant en bas (2). «
A r t i c l e III.
D e l ’E ta t d’Akhmym sous les Arabes et de nos jours.
L a ville d Akhmym et ses monumens ont conservé long-temps leur importance
qui ctoit encore réelle à l’époque des Arabes. Mais duquel de ses deux
temples el-Edrysy (3) vouloit-il parler, lorsqu’il comptoit les édifices antiques
d Akhmym parmi les berâba (4) ou monumens les plus remarquables de l’Ésypte
ou les avoit-il en vue tous les deux! Le second temple, dont il reste le plus
de vestiges étendus et de matériaux volumineux, est-il celui dont Abou-i-fedâ
dison, d y a environ quatre cents ans, « On admire à Akhmym un temple corn-
» parable aux plus célébrés monumens de l’antiquité; il est construit avec des’
« pierres d une grandeur surprenante, sur lesquelles, on a sculpté des figures innomb
ra b le s » . Quoique ce prince auteur ait profité des ouvrages d’el-Edrysy, prince
géographe comme lui, on voit qu’il s’explique comme un homme qui auroit vu les'
( 1 ) « L e s prêtres po rten t des habits A lin, no u v e lle - ( , ) H i s t l iv n s qc
»m e n t la v é s , attention qu’ils o n t touiours Am a s ié ! , ! m - ' ’
»envoya en Grèce plusieurs oiTrandes. .'(en.re'autres), sa ^ r l p h i e T , “ M " ^ ‘
K qUi K LeS " °mS S I P™ "™ ' communément une
les détails, Pline liv x i x c , rW lfé ■ ? i ^ V° } P° Ur marcIuei Ia pluralité. Berâba est donc le
aussi de très-beaux, dessins à l’aiguille. V oy vd™ Héro' k s d e ' ^t S i« K «"»"I” achève de prouver que
dote, liv. t I I , S. 47, la description d’un pareil corselet, du x u Î S é “ e" ^ ndt P1* “ railic“
A . D.
D a