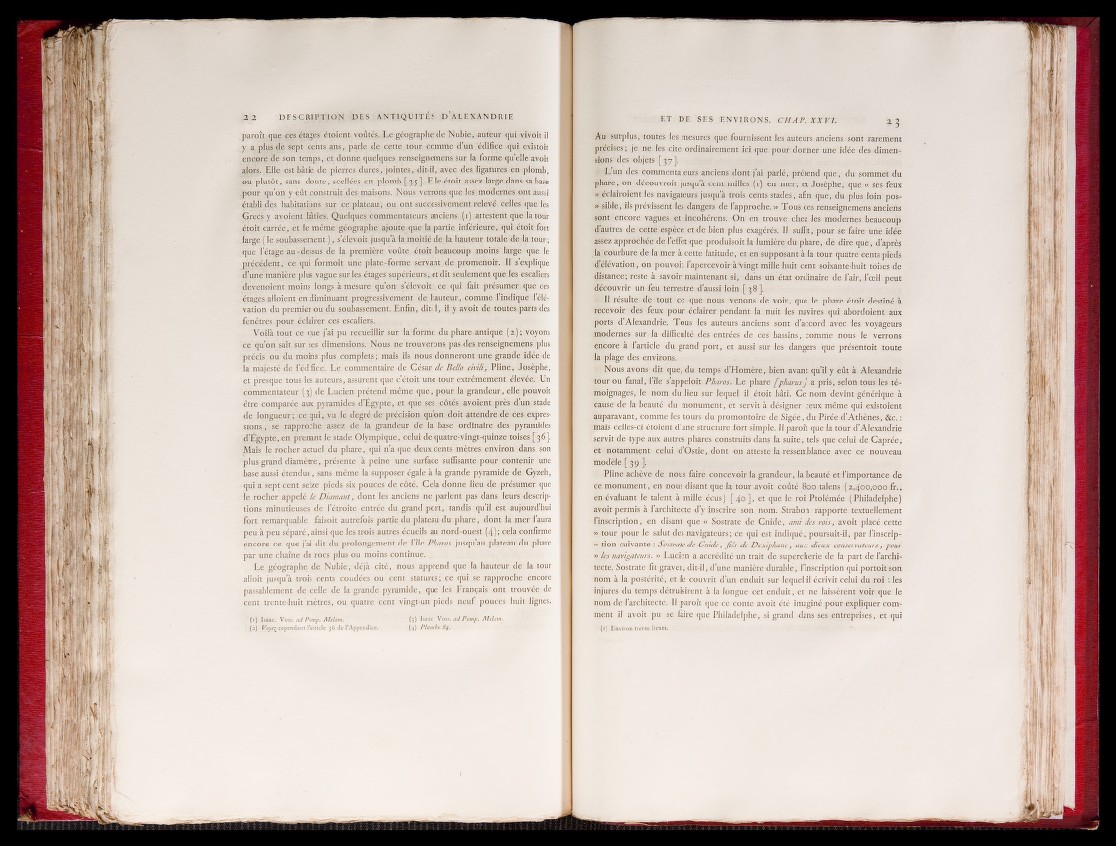
I I I
Fi I I I I
m A h i
| | j
H I
IÈÉ
| :| S
I
i l l
i m l i '
II!
i
l i i f i f | III
U
i l H P » iK W i iMi.S
paroît que ces étages étoient voûtés. Le géographe de Nubie, auteur qui vivoit i!
y a plus de sept cents ans, parle de cette tour comme d’un édifice qui existoit
encore de son temps, et donne quelques renseignemens sur la forme qu’elle avoit
alors. Elle est bâtie de pierres dures, jointes, dit-il, avec des ligatures en plomb,
ou plutôt, sans doute, scellées en plomb [35], Elle étoit assez large dans sa base
pour qu’on y eût construit des maisons. Nous verrons que les modernes ont aussi
établi des habitations sur ce plateau, ou ont successivement relevé celles que les
Grecs y avoient bâties. Quelques commentateurs anciens (1) attestent que la tour
étoit carrée, et le même géographe ajoute que la partie inférieure, qui étoit fort
large ( le soubassement ), s’élevoit jusqu’à la moitié de la hauteur totale de la tour ;
que l’étage au-dessus de la première voûte étoit beaucoup moins large que le
précédent, ce qui formoit une plate-forme servant de promenoir. Il s’explique
d’une manière plus vague sur les étages supérieurs, et dit seulement que les escaliers
devenoient moins longs à mesure qu’on s’élevoit ; ce qui fait présumer que ces
étages alloient en diminuant progressivement de hauteur, comme l’indique l’élévation
du premier ou du soubassement. Enfin, dit-il, il y avoit de toutes parts des
fenêtres pour éclairer ces escaliers.
Voilà tout ce que j’ai pu recueillir sur la forme du phare antique (2); voyons
ce qu’on sait sur ses dimensions. Nous ne trouverons pas des renseignemens plus
précis ou du moins plus complets ; mais ils nous donneront une grande idée de
la majesté de l’édifice. Le commentaire de César de Bello civili, Pline, Josèphe,
et presque tous les auteurs, assurent que c’étoit une tour extrêmement élevée. Un
commentateur (3) de Lucien prétend même que, pour la grandeur, elle pouvoit
être comparée aux pyramides d’Égypte, et que ses côtés avoient près d’un stade
de longueur; ce qui, vu le degré de précision qu’on doit attendre de ces expressions
, se rapproche assez de la grandeur de la base ordinaire des pyramides
.d’Égypte, en prenant le stade Olympique, celui de quatre-vingt-quinze toises [36].
Mais le rocher actuel du phare, qui n’a que deux cents mètres environ dans son
plus grand diamètre, présente à peine une surface suffisante pour contenir une
base aussi étendue, sans même la supposer égale à la grande pyramide de Gyzeh,
qui a sept cent seize pieds six pouces de côté. Cela donne lieu de présumer que
le rocher appelé le Diamant, dont les anciens ne parlent pas dans leurs descriptions
minutieuses de l’étroite entrée du grand port, tandis qu’il est aujourd’hui
fort remarquable, faisoit autrefois partie du plateau du phare, dont la mer l’aura
peu à peu séparé, ainsi que les trois autres écucils au nord-ouest (4); cela confirme
encore ce que j’ai dit du prolongement de l’île Pharos jusqu’au plateau du phare
par une chaîne de rocs plus ou moins continue.
Le géographe de Nubie, déjà cité, nous apprend que la hauteur de la tour
alloit jusqu’à trois cents coudées ou cent statures ; ce qui se rapproche encore
passablement de celle de la grande pyramide, que les Français ont trouvée de
cent trente-huit mètres, ou quatre cent vingt-un pieds neuf pouces huit lignes.
(1) Isaac. Voss, ad Pomp. Melam.
(2) Voye^ cependant l’article 36 de l’Appendice.
(3) Isaac. Voss, ad Pomp. Melam.
(4) Planche 84.
Au surplus, toutes les mesures que fournissent les auteurs anciens sont rarement
précisés; je ne les cite ordinairement ici que pour donner une idée des dimensions
des objets [37].
L ’un des commentateurs anciens dont j’ai parlé, prétend que, du sommet du
phare, on découvrait jusqu’à cent milles (1) en mer; et Josèphe, que « ses feux
| éclairaient les navigateurs jusqu’à trois cents stades, afin que, du plus loin pos-
» sible, ils prévissent les dangers de l’approche. » Tous ces renseignemens anciens
sont encore vagues et incohérens. On en trouve chez les modernes beaucoup
d’autres de cette espèce et de bien plus exagérés. Il suffit, pour se faire une idée
assez approchée de l’effet que produisoit la lumière du phare, de dire que, d’après
la courbure de la mer à cette latitude, et en supposant à la tour quatre cents pieds
d’élévation, on pouvoit l’apercevoir à Vingt mille huit cent soixante-huit toises de
distance; reste à savoir maintenant si, dans un état ordinaire de J’air, l’oeil peut
découvrir un feu terrestre d’aussi loin [38].
Il résulte de tout ce que nous venons de voir, que le phare étoit destiné à
recevoir des feux pour éclairer pendant la nuit les navires qui abordoient aux
ports d Alexandrie. Tous les auteurs anciens sont d’accord avec les voyageurs
modernes sur la difficulté des entrées de ces bassins, comme nous le verrons
encore à 1 article du grand port, et aussi sur les dangers que présentoit toute
la plage des environs.
Nous avons dit que, du temps d’FIomère, bien avant qu’il y eût à Alexandrie
tour ou fanal, l’île s’appeloit Pharos. Le phare [pliarus] a pris, selon tous les témoignages,
le nom du lieu sur lequel il étoit bâti. Ce nom devint générique à
cause de la beauté du monument, et servit à désigner ceux même qui existoient
auparavant, comme les tours du promontoire de Sigée, du Pirée d’Athènes, &c. :
mais celles-ci étoient d’une structure fort simple. Il paroît que la tour d’Alexandrie
servit de type aux autres phares construits dans la suite, tels que celui de Caprée,
et notamment celui d’Ostie, dont on atteste la ressemblance avec ce nouveau
modèle [ 39 ].
Pline achève de nous faire concevoir la grandeur, la beauté et l’importance de
ce monument, en nous disant que la tour avoit coûté 800 talens ( 2,400,000 fr .,
en évaluant le talent à mille écus) [ 4o ] , et que le roi Ptolémée ( Philadelphe )
avoit permis à l’architecte d’y inscrire son nom. Strabon rapporte textuellement
l’inscription, en disant que « Sostrate de Cnide, ami des rois, avoit placé cette
» tour pour le salut des navigateurs; ce qui est indiqué, poursuit-il, par l’inscrip-
)> tion suivante : Sostrate de Cnide, fils de Dexiphane, aux dieux conservateurs, pour
» les navigateurs. » Lucien a accrédité un trait de supercherie de la part de l’architecte.
Sostrate fit graver, dit-il, d’une manière durable, l’inscription qui portoitson
nom à la postérité, et le couvrit d’un enduit sur lequel il écrivit celui du roi : les
injures du temps détruisirent à la longue cet enduit, et ne laissèrent voir que le
nom de l’architecte. Il paroît que ce conte avoit été imaginé pour expliquer comment
il avoit pu se faire que Philadelphe, si grand dans ses entreprises, et qui
(1) Environ trente lieues.