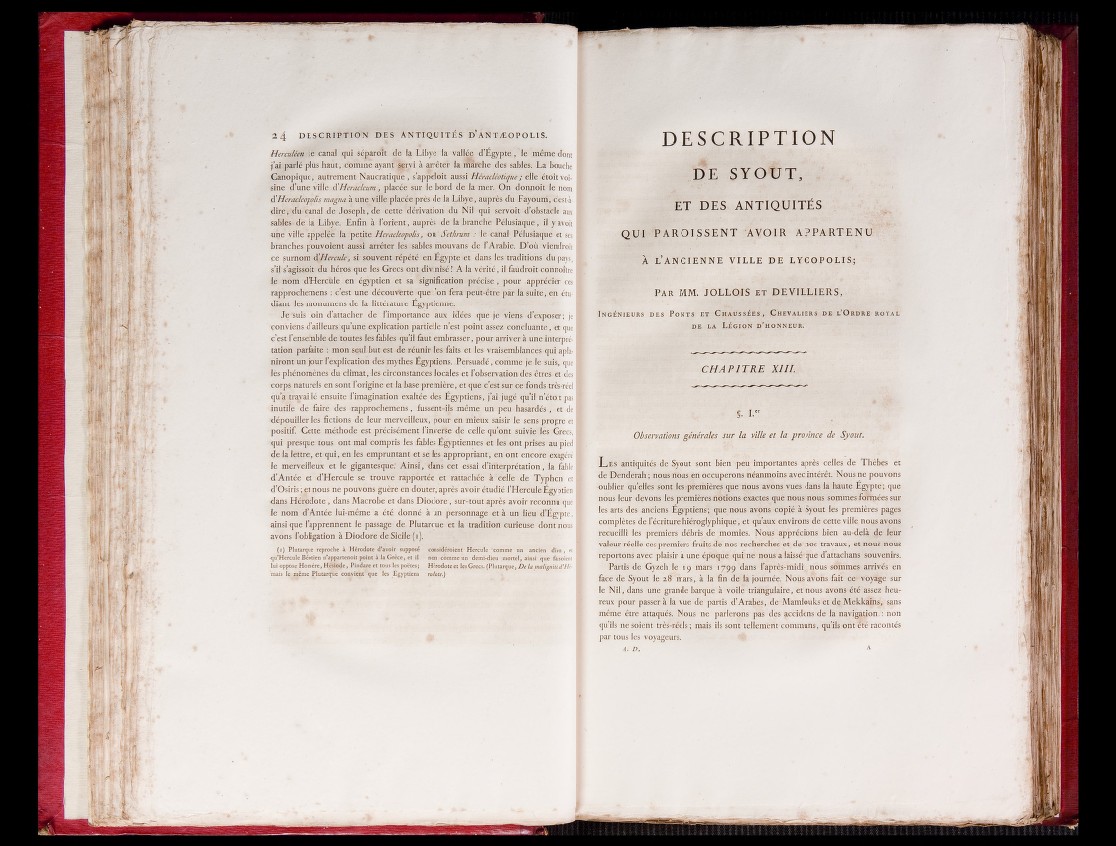
Herculéen le canal cjui séparent de la Libye la vallée d’Egypte, le même dont
j’ai parlé plus haut, comme ayant servi à arrêter la marche des sables. La bouche
Canopique, autrement Naucratique , s’appeloit aussi Héracléotique ; elle étoit voisine
d’une ville d Heracleum, placée sur le bord de la mer. On donnoit le nom
<ÏHeradeopolis magna à une ville placée près de la Libye, auprès du Fayoum, c’est-à-
dire, du canal de Joseph, de cette dérivation du Nil qui servoit d’obstacle aux
sables de la Libye. Enfin à l’orient, auprès de la branche Pélusiaque, il y avoit
une ville appelée la petite Heracleopo/is, ou Sethrum : le canal Pélusiaque et ses
branches p'ouvoient aussi arrêter les sables mouvans de l’Arabie. D ’où viendroit
ce surnom d’Hercule, si souvent répété en Egypte et dans les traditions du pays,
s’il s’agissoit du héros que les Grecs ont divinisé ! A la vérité, il faùdroit connoître
le nom d’Hercule en égyptien et sa signification précise , pour apprécier ces
rapprochemens : c’est une découverte que l’on fera peut-être par la suite, en étudiant
les monumens de la littérature Egyptienne.
Je suis loin d’attacher de l’importance aux idées que je viens d’exposer; je
conviens d’ailleurs qu’une explication partielle n’est point assez concluante, et que
c’est l’ensemble de toutes les fables qu’il faut embrasser, pour arriver à une interprétation
parfaite : mon seul but est de réunir les faits et les vraisemblances qui aplaniront
un jour l’explication des mythes Egyptiens. Persuadé, comme je le suis, que
les phénomènes du climat, les circonstances locales et l’observation des êtres et des
corps naturels en sont l’origine et la base première, et que c’est sur ce fonds très-réel
qu’a travaillé ensuite l’imagination exaltée des Egyptiens, j’ai jugé qu’il n’étoit pas
inutile de faire des rapprochemens, fussent-ils .même un peu hasardés, et de
dépouiller les fictions de leur merveilleux, pour en mieux saisir le sens propre et
positif. Cette méthode est précisément l’inverSe de celle qu’ont suivie les Grecs,
qui presque tous ont mal compris les fables Egyptiennes et les ont prises au pied
de la lettre, et qui, en les empruntant et se les appropriant, en ont encore exagéré
le merveilleux et le gigantesque.' Ainsi, dans cet essai d’interprétation, la fable
d’Antée et d’Hercule se trouve rapportée et rattachée à celle de Typhon et
d’Osiris ; et nous ne pouvons guère en douter, après avoir étudié l’Hercule Égyptien
dans Hérodote, dans Macrobe et dans Diodore, sur-tout après avoir reconnu que
le nom d’Antée lui-même a été donné à un personnage et à un lieu d’Egypte,
ainsi que l’apprennent le passage de Plutarque et la tradition curieuse dont nous
avons l’obligation à Diodore de Sicile (i).
(i) Plutarque reproche à Hérodote d’avoir supposé considéroient Hercule ‘comme un ancien dieu, et
qu’HercuIe Béotien n’appartenoit point à la Grèce, et il • non-comme un demi-dieu mortel, ainsi que faisoient
lui oppose Homère, Hésiode, Pindare et tous les poëtes; Hérodote et les Grecs. (Plutarque, De la malignitéd’Hé-
mais le même Plutarque convient' que les Égyptiens rodote.)
DE S Y O U T ,
ET DES ANTIQUITÉS
QUI P A R O I S S E N T AVOIR A P P A R T E N U
À L ’ A N C I E N N E V I L L E D E L Y C O P O L I S ;
P a r MM. J O L L O I S e t D E V I L L I E R S ,
I n g é n i e u r s d e s P o n t s e t C h a u s s é e s , C h e v a l i e r s d e l ’ O r d r e r o ï a l
d e l a L é g i o n d ’ h o n n e u r .
C H A P I T R E X I I I .
§. I "
Observations générales sur la ville et la province de Syout.
L e s antiquités de Syout sont bien peu importantes après celles de Thèbes et
de Denderah ; nous nous en occuperons néanmoins avec intérêt. Nous ne pouvons
oublier qu’elles sont les premières que nous avons vues dans la haute Egypte; que
nous leur devons les premières notions exactes que nous nous sommes formées sur
les arts des anciens Égyptiens; que nous avons copié à Syout les premières pages
complètes de l’écriture hiéroglyphique, et qu’aux environs de cette ville nous avons
recueilli les premiers débris de momies. Nous apprécions bien au-delà de leur
valeur réelle ces premiers fruits de nos recherches et de nos travaux, et nous nous
reportons avec plaisir à une époque qui ne nous a laissé- que d’attachans souvenirs.
Partis de Gyzeh le 19 mars 1799 dans l’après-midi, nous sommes arrivés en
face de Syout le 28 mars, à la fin de la journée. Nous avons fait ce- voyage sur
le N il, dans une grande barque à voile triangulaire, et nous avons été assez heureux
pour passer à la vue de partis d’Arabes, de Mamlouks et de Mekkains, sans
même être attaqués. Nous ne parlerons pas des accidens de la navigation.: non
qu’ils ne soient très-réels ; mais ils sont tellement communs, qu’ils ont été racontés
par tous les voyageurs.
a . d . 1