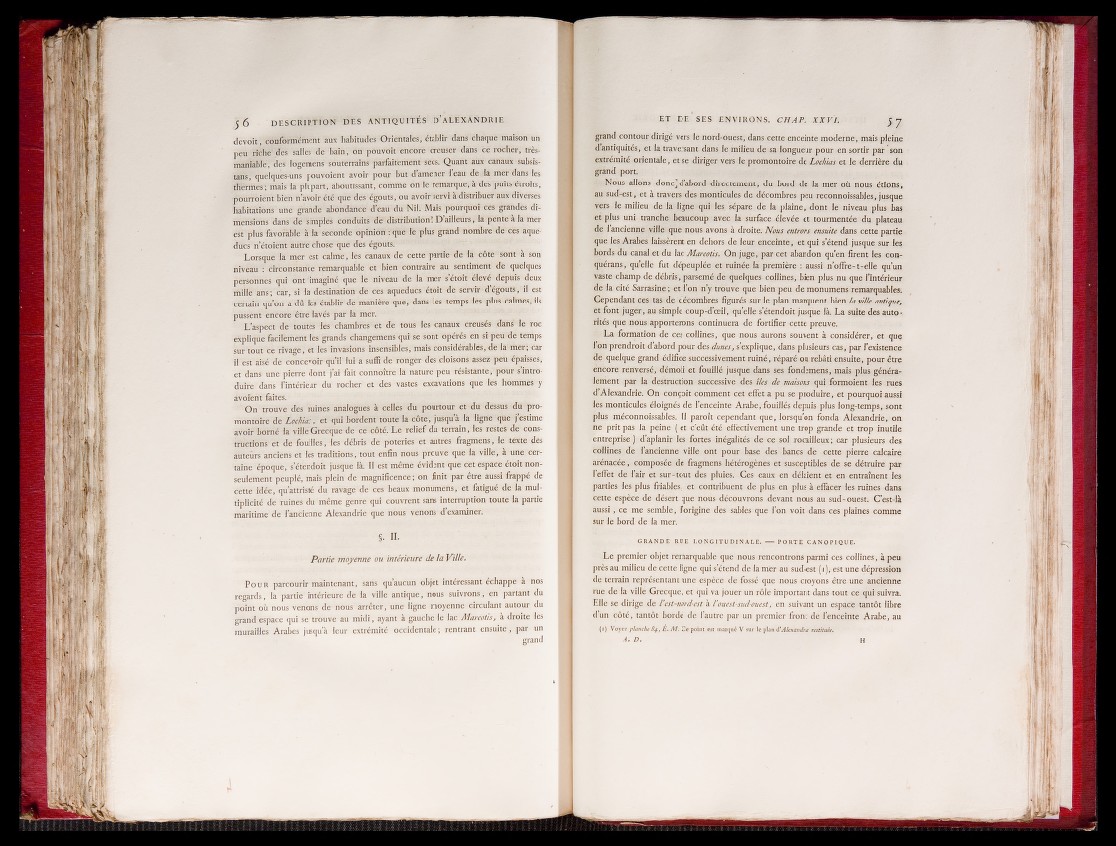
devoit, conformément aux habitudes Orientales, établir dans chaque maison un
peu riche des salles de bain, on pouvoit encore creuser dans ce rocher, très-
maniable, des logemens souterrains parfaitement secs. Quant aux canaux subsis-
tans, quelques-uns pouvoient avoir pour but d’amener leau de la mer dans les
thermes; mais la plupart, aboutissant, comme on le remarque, à des puits étroits,
pourraient bien n’avoir été que des égouts, ou avoir servi à distribuer aux diverses
habitations une grande abondance deau du Nil. Mais pourquoi ces grandes dimensions
dans de simples conduits de distribution! D ailleurs, la pente a la mer
est plus favorable à la seconde opinion : que le plus grand nombre de ces aqueducs
n’étoient autre chose que des égouts.
Lorsque la mer est calme, les canaux de cette partie de la côte sont à son
niveau : circonstance remarquable et bien contraire au sentiment de quelques
personnes qui ont imaginé que le niveau de la mer setoit eleve depuis deux
mille ans; car, si la destination de ces aqueducs étoit de servir d’égouts, il est
certain qu’on a dû les établir de manière que, dans les temps les plus calmes, ils
pussent encore être lavés par la mer.
L ’aspect de toutes les chambres et de tous les canaux creusés dans le roc
explique facilement les grands changemens qui se sont opérés en si peu de temps
sur tout ce rivage, et les invasions insensibles, mais considérables, de la mer; car
il est aisé de concevoir qu’il lui a suffi de ronger des cloisons assez peu épaisses,
et dans une pierre dont j’ai fait connoître la nature peu résistante, pour s introduire
dans l’intérieur du rocher et des vastes excavations que les hommes y
avoient faites.
On trouve des ruines analogues à celles du pourtour et du dessus du promontoire
de Lochias, et qui bordent toute la cote, jusqua la ligne que j estime
avoir borné la ville Grecque de ce côté. L e relief du terrain, les restes de constructions
et de fouilles, les débris de poteries et autres fragmens, le texte des
auteurs anciens et les traditions, tout enfin nous prouve que la ville, a une certaine
époque, s’étendoit jusque la. II est meme évident que cet espace etoit non-
seulement peuplé, mais plein de magnificence ; on finit par être aussi frappé de
cette idée, qu’attristé du ravage de ces beaux monumens, et fatigue de la multiplicité
de ruines du même genre qui couvrent sans interruption toute la partie
maritime de l’ancienne Alexandrie que nous venons d examiner.
§. II.
Partie moyenne ou intérieure de la Ville.
P o u r parcourir maintenant, sans quaucun objet intéressant échappé a nos
regards, la partie intérieure de la ville antique, nous suivrons, en partant du
point où nous venons de nous arrêter, une ligne moyenne circulant autour du
grand espace qui se trouve au midi, ayant à gauche le lac Mareotis, a droite les
murailles Arabes jusqu’à leur extrémité occidentale ; rentrant ensuite, par un
grand contour dirigé vers le nord-ouest, dans cette enceinte moderne, mais pleine
d antiquités, et la traversant dans le milieu de sa longueur pour en sortir par son
extrémité orientale, et se diriger vers le promontoire de Lochias et le derrière du
grand port.
Nous allons donc]d’abord directement, du bord de la mer où nous étions,
au sud-est, et à travers des monticules de décombres peu reconnoissabjes, jusque
vers le milieu de la ligne qui les sépare de la plaine, dont le niveau plus bas
et plus uni tranche beaucoup avec la surface élevée et tourmentée du plateau
de 1 ancienne ville que nous avons a droite. Nous entrons ensuite dans cette partie
que les Arabes laissèrent en dehors de leur enceinte, et qui s’étend jusque sur les
bords du canal et du lac Mareotis. On juge, par cet abandon qu’en firent les con-
quérans, qu’elle fut dépeuplée et ruinée la première : aussi n’offre-t-elle qu’un
vaste champ de débris, parsemé de quelques collines, bien plus nu que l’intérieur
de la cité Sarrasine ; et l’on n’y trouve que bien peu de monumens remarquables.
Cependant ces tas de décombres figurés sur le plan marquent bien la ville antique,
et font juger, au simple coup-d’oeil, qu’elle s’étendoit jusque là. La suite des autorités
que nous apporterons continuera de fortifier cette preuve.
La formation de ces collines, que nous aurons souvent à considérer, et que
1 on prendroit d’abord pour des dunes, s’explique, dans plusieurs cas, par l’existence
de quelque grand édifice successivement ruiné, réparé ou rebâti ensuite, pour être
encore renversé, démoli et fouillé jusque dans ses fondemens, mais plus généralement
par la destruction successive des îles de niaisons qui formoient les rues
d Alexandrie. On conçoit comment cet effet a pu se produire, et pourquoi aussi
les monticules éloignés de l’enceinte Arabe, fouillés depuis plus long-temps, sont
plus méconnoissables. Il paraît cependant que, lorsqu’on fonda Alexandrie, on
ne prit pas la peine ( et c’eût été effectivement une trop grande et trop inutile
entreprise ) d’aplanir les fortes inégalités de ce sol rocailleux; car plusieurs des
collines de l’ancienne ville ont pour base des bancs de cette pierre calcaire
arénacée, composée de fragmens hétérogènes et susceptibles de se détruire par
l’effet de l’air et sur-tout des pluies. Ces eaux en délaient et en entraînent les
parties les plus friables, et contribuent de plus en plus à effacer les ruines dans
cette espèce de désert que nous découvrons devant nous au sud-ouest. C ’est-là
aussi, ce me semble, l’origine des sables que l’on voit dans ces plaines comme
sur le bord de la mer.
G R A N D E R U E L O N G I T U D I N A L E . ----- P O R T E C A N O P 1Q U E .
Le premier objet remarquable que nous rencontrons parmi ces collines, à peu
près au milieu de cette ligne qui s’étend de la mer au sud-est (i), est une dépression
de terrain représentant une espèce de fossé que nous croyons être une ancienne
rue de la ville Grecque, et qui va jouer un rôle important dans tout ce qui suivra.
Elle se dirige de l'est-nord-est à l ’ouesl-sud-ouest, en suivant un espace tantôt libre
d un côté, tantôt bordé de l’autre par un premier front de l’enceinte Arabe, au
(i) Voyez planche S+, E. M . Ce point est marqué V sur le plan d’Alexandrie restituée.
A . D . H