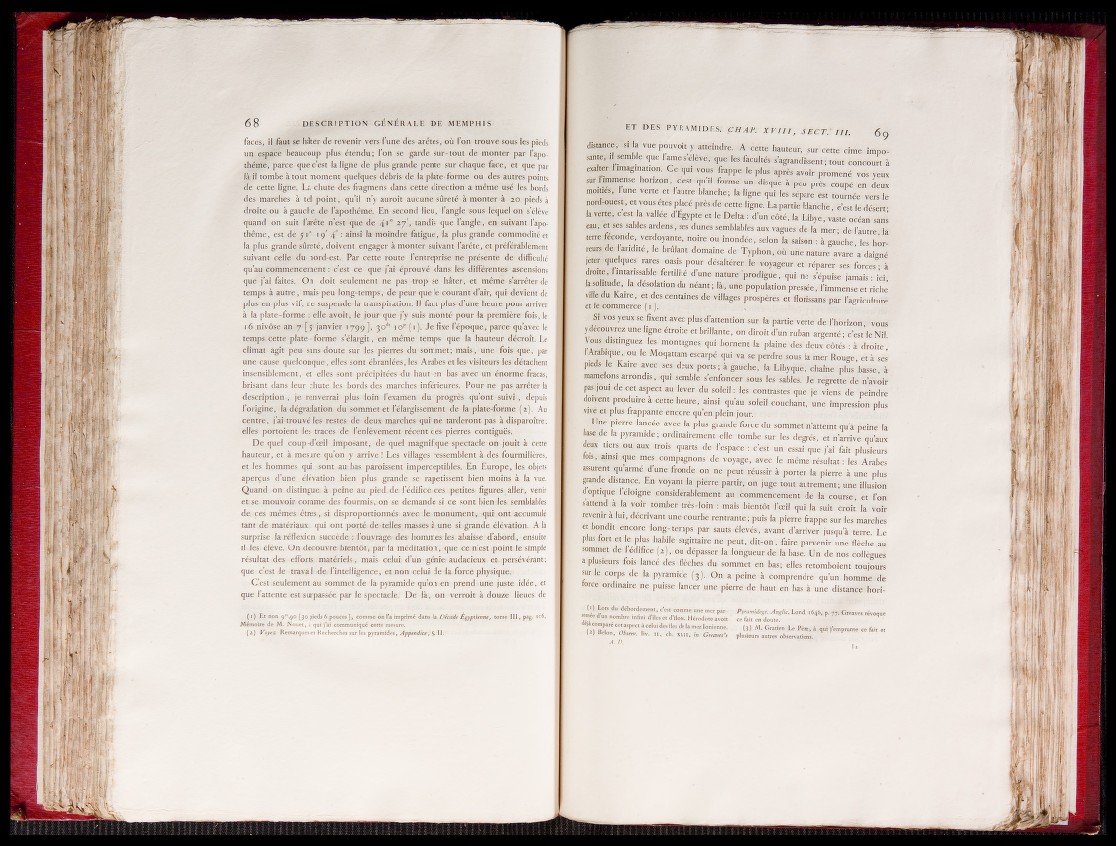
6 8 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE MEMPHIS
faces, il faut se hâter de revenir vers l’une des arêtes, où l’on trouve sous les pieds
un espace beaucoup plus étendu; l’on se garde sur-tout de monter par l’apo-
thême, parce que c’est la ligne de plus grande pente sur chaque face, et que par
là il tombe à tout moment quelques débris de la plate- forme ou des autres points
de cette ligne. La chute des fragmens dans cette direction a même usé les bords
des marches à tel- point, qu’il n’y auroit aucune sûreté à monter à 20 pieds à
droite ou à gauche de l’apothême. En second lieu, l’angle sous lequel on s’élève
quand on suit l’arête n’est que de 4 ! ° 'fô k tanùis que l’angle, en suivant l’apo-
thême, est de J 19’ 4 " : ainsi la moindre fatigue, la plus grande commodité et
la plus grande sûreté, doivent engager à monter suivant l'arête, et préférâblement
suivant celle du nord-est. Par cette route l’entreprise ne présente de difficulté
qu’au commencement; c’est ce que j’ai éprouvé dans les différentes ascensions
que j’ai faites. On doit seulement ne pas trop se hâter, et même s’arrêter de
temps à autre, mais-peu long-temps, de peur que le courant d’air, qui devient de
plus en plus vif, ne suspende la transpiration. Il faut plus d’une heure pour arriver
à la plate-forme : elle avoir, le jour que j’y suis monté pour la première fois, le
16 nivôse an 7 [5 janvier 1799], 3.0* io p ( 1 ). Je fixe l’époque, parce qu’avec le
temps cette plate - forme s’élargit, en même temps que la hauteur décroît. Le
climat agit peu sans doute sur les pierres du sommet; mais, une fois que, par
une cause quelconque, elles sont ébranlées, les Arabes et les visiteurs les détachent
insensiblement, et elles sont précipitées du haut en bas avec un énorme fracas,
brisant dans leur chute les bords des marches inférieures. Pour ne pas arrêter la
description , je renverrai plus loin l’examen du progrès qu’ont suivi, depuis
l’origine, la dégradation du sommet et l’élargissement de la plate-forme (2). Au
centre, j’ai trouvé les restes de deux marches qui ne tarderont pas à disparoître;
elles portoient les traces de l’enlèvement récent des- pierres contiguës.
De quel coup-d’oeil imposant, de quel magnifique spectacle on jouit à cette
hauteur, et à mesure qu’on y arrive ! Les villages ressemblent à des fourmilières,
et les hommes qui. sont au bas paroissent imperceptibles, En Europe, les objets
aperçus d’une élévation bien plus grande se rapetissent bien moins à la vue.
Quand on distingue, à peine au pied de. l’édifice, ces petites- figures aller, venir
et se mouvoir comme des fourmis, on se demande si ce sont bien les semblables
de ces mêmes êtres , si disproportionnés avec le monument,, qui ont accumulé
tant de matériaux, qui ont porté de telles masses à une si grande élévation. A la
surprise la réflexion succède : l’ouvrage-des hommes les abaisse d’abord, ensuite
il les élève. On découvre bientôt, par la méditation, que ce n’est point le simple
résultat des efforts matériels, mais celui d’un géniej audacieux et persévérant;
que c’est Je travail de l’intelligence, et non celui de la force physique.
Cest seulement au sommet de la pyramide qu’on- en prend une juste idée, et
que I attente est surpassée par le spectacle. De là, on verroit à douze lieues de
(1 ) Et non 9ra,90 [30 pieds 6.pouces ] , comme on l’a imprimé dans la Décade Egyptienne, tome III, pag. ic6,
Mémoire de M. Nouet, à qui j’ai communiqué cette mesure.
(2) Voyez Remarques et Recherches sur les pyramides, Appendice, Ç. II.
distance, si la vue pouvoit y atteindre. A cette hauteur, sur cette cime imposante,
il semble que lame s’élève, que les facultés s’agrandissent; tout concourt à
exalter 1 imagination. Ce qui vous frappe le plus après avoir promené vos yeux
sur Iimmense horizon, cest qu’il forme un disque à peu près coupé en deux
moitiés, 1 une verte et Iautre blanche; la ligne qui les sépare est tournée vers le
nord-ouest, et vous êtes placé près de cette ligne. La partie blanche, e’est le désert-
la verte, c est la vallée d’Égypte et le Delta : d’un côté, la Libye, vaste océan sans
eau, et ses sables ardens, ses dunes semblables aux vagues de la mer; de l’autre la
terre féconde, verdoyante, noire ou inondée, selon la saison : à gauche les hor
reurs de l’aridité, le brûlant domaine de typ h on , où une nature avare’ a daigné
jeter quelques rares oasis pour désaltérer le voyageur et réparer ses forces ; à
droite, 1 intarissable fertilité d’une nature prodigue, qui ne s’épuise jamais : ici,
la solitude, la désolation du néant; là, une population pressée, l’immense et riche
ville du Kaire, et des centaines de villages prospères et florissans par l’agriculture
et le commerce ( i ).
Si v o s yeux se fixent avec plus d’attention sur la partie verte de l’horizon, vous
y découvrez une ligne étroite et brillante, on diroit d’un ruban argenté; c’est le Nil.
Vous distinguez les montagnes qui bornent la plaine des deux côtés : à droite,
1 Arabique, ou le Moqattam escarpé qui va se perdre sous la mer Rouge, et à ses
pieds le Kaire avec ses deux ports; à gauche, la Libyque, chaîne plus basse, à
mamelons arrondis, qui semble s’enfoncer sous les sables. Je regrette de n’avoir
pas joui de cet aspect au lever du soleil : les contrastes que je viens de peindre
doivent produire à cette heure, ainsi qu’au soleil couchant, une impression plus
vive et plus frappante encore qu’en plein jour.
Une pierre lancée avec la plus grande force du sommet n’atteint qu’à peine la
base de la pyramide; ordinairement elle tombe sur les degrés, et n’arrive qu’aux
deux tiers ou aux trois quarts de l’espace : c’est un essai que j’ai fait plusieurs
fois, ainsi que mes compagnons de voyage, avec le même résultat: les Arabes
assurent quarmé d’une fronde on ne peut réussir à porter la pierre à une plus
grande distance. En voyant la pierre partir, on juge tout autrement; une illusion
doptique 1 éloigne considérablement au commencement de la course, et l’on
s attend à la voir tomber très-loin ; mais bientôt l’oeil qui la suit croit la voir
revenir a lui, décrivant une courbe rentrante ; puis la pierre frappe sur les marches
et bondit encore long-temps par sauts élevés, avant d’arriver jusqu’à terre. Le
plus fort et le plus habile sagittaire ne peut, dit-on, faire parvenir une flèche .au
sommet de l’édifice (2), ou dépasser la longueur de la base. Un de nos collègues
a plusieurs fois lancé des flèches du sommet en bas; elles retomboient toujours
sur le corps de la pyramide (3). On a peine à comprendre qu’un homme de
force ordinaire ne puisse lancer une pierre de haut en bas à une distance horip0rs
du débordement, c’est comme une mer par- Pyramidogr. Anglk. Lond. 1646, p. 77. Greaves révoque
«née d un nombre infini d'îles et d'îlots. Hérodote avoi, ce fait en doute ’
D l T r Co/aSI>e“ r Ceh,i dM!'es tle lar r l ° nie" " e- (3) M. Gratien Le Père, à qui ¡’emprunte ce fait et
n, serv. Iiv. I I , ch. x l i i , in Greaves’s plusieurs autres observations.
A. D.
l a
_