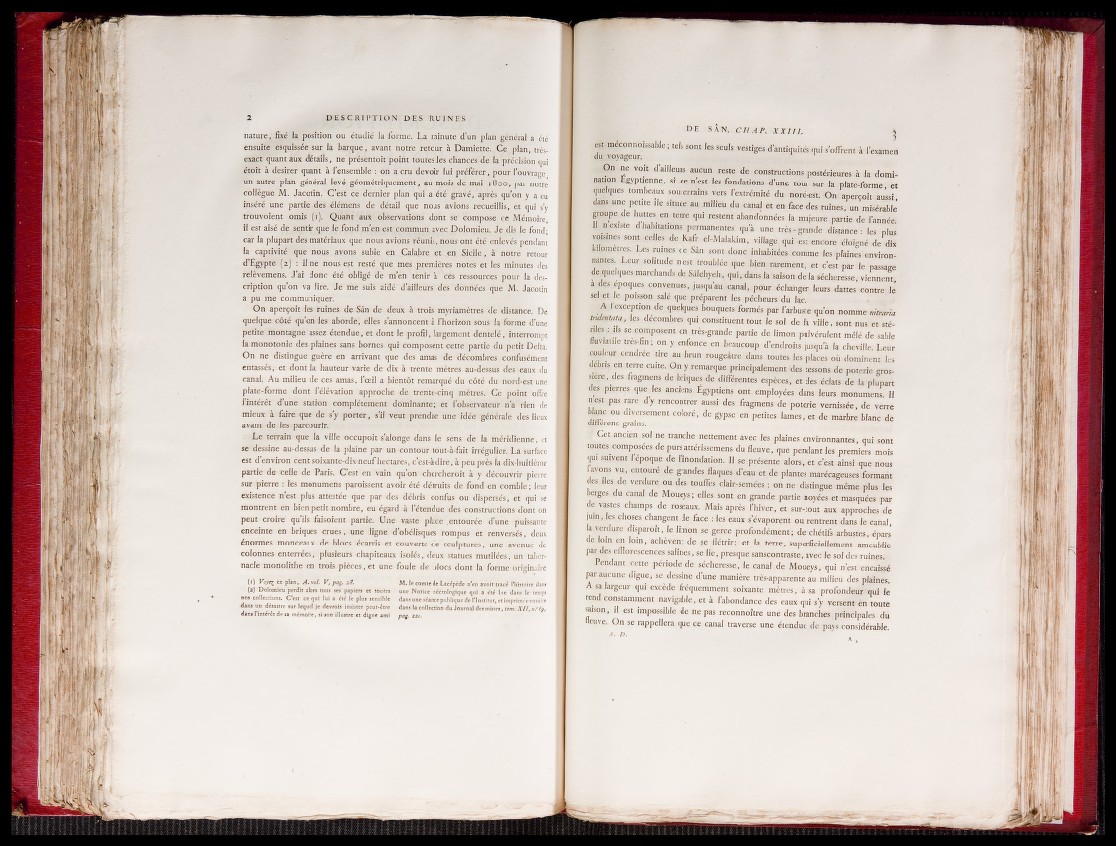
nature, fixé la position ou étudié la forme. La minute d’un plan général a étc
ensuite esquissée sur la barque, avant notre retour à Damiette. Ce plan, très-
exact quant aux détails, ne présentoit point toutes les chances de la précision qui
étoit à desirer quant à l’ensemble : on a cru devoir lui préférer, pour l’ouvrage
un autre plan général levé géométriquement, au mois de mai 1800, par notre
collègue M. Jacotin. C ’est ce dernier plan qui a été gravé, après qu’on y a eu
inséré une partie des élémens de détail que nous avions recueillis, et qui s’y
trouvoient omis (1). Quant aux observations dont se compose ce Mémoire
il est aisé de sentir que le fond m’en est commun avec Dolomieu. Je dis le fond;
car la plupart des matériaux que nous avions réunis, nous ont été enlevés pendant
la captivité que nous avons subie en Calabre et en Sicile, à notre retour
d % p t e (2) : il ne nous est resté que mes premières notes et les minutes des
relèvemens. J’ai donc été obligé de m'en tenir à ces ressources pour la description
qu on va lire. Je me suis aidé d’ailleurs des données que M. Jacotin
a pu me communiquer.
On aperçoit les ruines de San de deux à trois myriamètres de distance. De
quelque côté qu’on les aborde, elles s’annoncent à l’horizon sous la forme d’une
petite montagne assez étendue, et dont le profil, largement dentelé, interromnt
la monotonie des plaines sans bornes qui composent cette partie du petit Delta.
On ne distingue guère en arrivant que des amas de décombres confusément
entasses, et dont la hauteur varie de dix à trente mètres au-dessus des eaux du
canal. Au milieu de ces amas, l’oeil a bientôt remarqué du côté du nord-est une
plate-forme dont 1 élévation approche de trente-cinq mètres. Ce point offre
1 intérêt d’une station complètement dominante; et l’observateur n’a rien de
mieux à faire que de sy porter, s’il veut prendre une idée générale des lieux
avant de les parcourir.
Le terrain que la ville occupoit s alonge dans le sens de la méridienne, et
se dessine au-dessus de la plaine par un contour tout-à-fait irrégulier. La surface
est d environ cent soixante-dix-neuf hectares, c’est-à-dire, à peu près la dix-huitième
partie de celle de Paris. C est en vain qu on chercheroit à y découvrir pierre
sur pierre : les monumens paroissent avoir été détruits de fond en comble ; leur
existence nest plus attestée que par des débris confus ou dispersés, et qui se
montrent en bien petit nombre, eu égard a 1 étendue des constructions dont on
peut croire quils faisoient partie. Une vaste place .entourée d’une puissante
enceinte en briques crues, une ligne d’obélisques rompus et renversés, deux
énormes monceaux de blocs écarris et couverts de sculptures, une avenue de
colonnes enterrées, plusieurs chapiteaux isolés, deux statues mutilées, un tabernacle
monolithe en trois pièces, et une foule de blocs dont la forme originaire
( 0 ce plan, A . vol. V, pag. zS. M. le comte de Lacépéde n’en avoit tracé l’histoire dans
(2) Dolomieu perdit alors tous ses papiers et toutes une Notice nécrologique qui a été lue dans le temps
nos collections. C ’est ce qui lui a été le plus sensible d an s u n e séance p u b liq u e d e l’In stitu t, et im p rim ée ensuite
dans un désastre sur lequel je devrais insister peut-être dans la collection du Journal des mines, lom. X I I , 6),
dani l'intérêt de sa mémoire, si son illustre et digne ami pag. zzi.
est méconnoissable ; tels sont les seuls vestiges d’antiquités qui s’offrent à l’examen
du voyageur.
On ne voit d’ailleurs aucun reste de constructions postérieures à la domination
Egyptienne, si ce n’est les fondations d’une tour sur la plate-forme et
quelques tombeaux souterrains vers l’extrémité du nord-est. On aperçoit aussi
dans une petite île située au milieu du canal et en face des ruines, un misérable
groupe de huttes en terre qui restent abandonnées la majeure partie de l’année.
Il nexirte d habitations permanentes qu’à une très-grande distance: les plus
voisines sont celles de Kafr el-Malakim, village qui est encore éloigné de dix
kilométrés. Les ruines de Sân sont donc inhabitées comme les plaines environnantes
Leur solitude n’est troublée que bien rarement, et c’est par le passage
de quelques marchands de Sâlehyeh, qui, dans la saison de la sécheresse, viennent
a des époques convenues, jusqu’au canal, pour échanger leurs dattes contre le’
sel et le poisson salé que préparent les pêcheurs du lac.
A l’exception de quelques bouquets formés par l’arbuste qu’on nomme nkmna
tndentata., les décombres qui constituent tout le sol de la ville, sont nus et stériles
: ils se composent en très-grande partie de limon pulvérulent mêlé de sable
nuviatile tres-fin; on. y enfonce en beaucoup d’endroits jusqu’à la cheville. Leur
couleur cendrée tire au brun rougeâtre dans toutes les places où dominent les
debns en terre cuite. On y remarque principalement des tessons de poterie grossière,
des fragmens de briques de différentes espèces, et des éclats de la plupart
des pierres que les anciens Egyptiens ont employées dans leurs monumens II
nest pas rare d’y rencontrer aussi des fragmens de poterie vernissée, de verre
blanc ou diversement coloré, de gypse en petites lames, et de marbre blanç de
cirrrerens grains.
f Cet ancien sol ne tranche nettement avec les plaines environnantes, qui sont
toutes composées de purs attérissemens du fleuve, que pendant les premiers mois
qu, suivent I epoque de l’inondation. Il se présente alors, et c’est ainsi que nous
lavons vu, entouré de grandes flaques d’eau et de plantes marécageuses formant
des îles de verdure ou des touffes clair-seméès : on ne distingue même plus les
berges du canal de Moueys; elles sont en grande partie noyées et masquées par
de vastes champs de roseaux. Mais après l’hiver, et sur-tout aux approches de
juin, les choses changent de face : les eaux s’évaporent ou rentrent dans le canal,
a verdure disparoît, le limon se gerce profondément; de chétifs arbustes, épars
de loin en loin, achèvent de se flétrir; et la terre, superficiellement ameublie
par des efflorescences salines, se lie, presque sanscontraste, avec le sol des ruines.
Pendant cette période de sécheresse, le canal de Moueys, qui n’est encaissé
par aucune digue, se dessine d’une manière très-apparente au milieu des plaines.
A sa largeur qui excède fréquemment soixante mètres, à sa profondeur qui le
rend constamment navigable, et à l’abondance des eaux qui s’y versent en toute
saison, il est impossible de ne pas reconnoître une des branches principales du
fleuve. On se rappellera que ce canal traverse une étendue de pays considérable.
A . D .