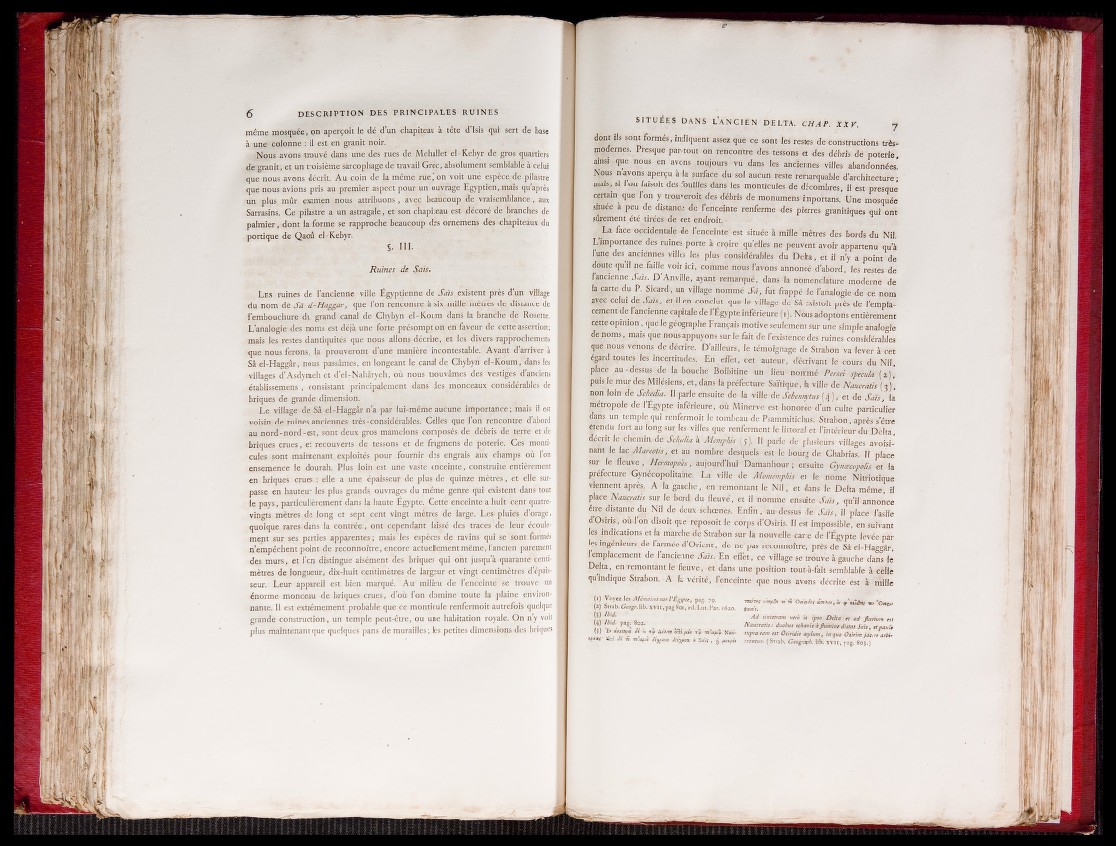
même mosquée, on aperçoit ie dé d’un chapiteau à tête d’Isis qui sert de base
à une colonne : il est en granit noir.
Nous avons trouvé dans une des rues de Mehallet el-Kebyr de gros quartiers
de granit, et un troisième sarcophage de travail Grec, absolument semblable à celui
que nous avons décrit. Au coin de la même ruej on voit une espèce de pilastre
que nous avions pris au premier aspect pour un ouvrage Egyptien, mais qu’après
un plus mûr examen nous attribuons, avec beaucoup de vraisemblance, aux
Sarrasins. Ce pilastre a un astragale, et son chapiteau est décoré de branches de
palmier, dont la forme se rapproche beaucoup des ornemens des chapiteaux du
portique de Qaoû el-Kebyr.
§. III.
Ruines de Sais,
L e s ruines de l’ancienne ville Égyptienne de Sais existent près d’un village
du nom de Sâ el-Haggâr, que l’on rencontre à six mille mètres de distance de
l’embouchure du grand canal de Chybyn ei-Koum dans la branche de Rosette.
L ’analogie des noms est déjà une forte présomption en faveur de cette assertion;
mais les restes d’antiquités que nous allons décrire, et les divers rapprochemens
•que nous ferons, la prouveront d’une manière incontestable. Avant d’arriver à
Sâ el-Haggâr, nous passâmes, en longeant le canal de Chybyn el-Koum, dans les
villages d’Asdymeh et d’el-Nahâryeh, où nous trouvâmes des vestiges d’anciens
établissemens , consistant principalement dans des monceaux considérables de
briques de grande dimension.
Le village de Sâ el-Haggâr n’a par lui-même aucune importance; mais il est
voisin de ruines anciennes très-considérables. Celles que l’on rencontre d’abord
au nord-nord-est, sont deux gros mamelons composés de débris de terre et de
briques crues, et recouverts de tessons et de fragmens de poterie. Ces monticules
sont maintenant exploités pour fournir des engrais aux champs où l’on
ensemence le dourah. Plus loin est une vaste enceinte, construite entièrement
en briques crues : elle a une épaisseur de plus de quinze mètres, et elle surpasse
en hauteur les plus grands ouvrages du même genre qui existent dans tout
le pays, particulièrement dans la haute Egypte. Cette enceinte a huit cent quatre-
vingts mètres dé long et sept cent vingt mètres de large. Les pluies d’orage,
quoique rares dans la contrée, ont cependant laissé des traces de leur écoulement
sur ses parties apparentes; mais les espèces de ravins qui se sont formés
n’empêchent point de reconnoître, encore actuellement même, l’ancien parement
des murs, et l’on distingue aisément des briques qui ont jusqu’à quarante centimètres
de longueur, dix-huit centimètres de largeur et vingt centimètres d’épaisseur.
Leur appareil est bien marqué. A u milieu de l’enceinte se trouve un
énorme monceau de briques crues, d’où l’on domine toute la plaine environnante.
Il est extrêmement probable que ce monticule renfermoit autrefois quelque
grande construction, un temple peut-être, ou une habitation royale. On ny voit
plus maintenant que quelques pans de murailles ; les petites dimensions des briques
S I T U É E S t ) A N S L A N C I E N D E L T A . C H A P . XXV" . y
dont ils sont formés, indiquent assez que ce sont les restes de constructions très-
modernes. Presque par-tout on rencontre des tessons et des débris de poterie,
ainsi que nous en avons toujours vu dans les anciennes villes abandonnées!
Nous n avons aperçu à la surface du sol aucun reste remarquable d’architecture ;
mais, si Ion faisoit des fouilles dans les monticules de décombres, il est presque
certain^ que 1 on y trouveroit des débris de monumens importans. Une mosquée
situee a peu de distance de 1 enceinte renferme des pierres granitiques qui ont
sûrement été tirées de cet endroit.
La face occidentale de l’enceinte est située à mille mètres des bords du Nil.
L’importance des ruines porte à croire qu’elles ne peuvent avoir appartenu qu’à
l’une des anciennes villes les plus considérables du Delta, et il n’y a point de
doute quil ne faille voir ici, comme nous l’avons annoncé d’abord, les restes de
l’ancienne Sais. D ’Anville, ayant remarqué, dans la nomenclature moderne de
la carte du P. Sicard, un village nommé S â , fût frappé de l’analogie de ce nom
avec celui de Sais, et il en conclut que le village de Sâ existoit près de l’emplacement
de l’ancienne capitale de l’Egypte inférieure ( i ). Nous adoptons entièrement
cette opinion, que le géographe Français motive seulement sur une simple analogie
de noms, mais que nous appuyons sur le fait de l’existence des ruines considérables
que nous venons de décrire. D ’ailleurs, le témoignage de Strabon va lever à cet
égard toutes les incertitudes. En effet, cet auteur, décrivant le cours du Nil,
place au-dessus de la bouche Bolbitine un lieu nommé Persei spécula (a ) ,
puis le mur des Milésiens, et, dans la préfecture Saïtique, la ville de Naucratis (q),
non loin de Schedia. Il parle ensuite de la ville de Sebennytus (4 ) , et de Sa is, la'
métropole de l’Egypte inférieure, où Minerve est honorée d’un culte particulier
dans un temple qui renfermoit le tombeau de Psammitichus. Strabon, après s’être
étendu fort au long sur les villes que renferment Je littoral et l’intérieur du Delta,
décrit 1e chemin de Schedia à Memphis (y). Il parle de plusieurs villages avoisi-
nant le lac Mareotis, et au nombre desquels est le bourg de Chabrias. Il place
sur le fleuve, Hermopolis, aujourd’hui Damanhour ; ensuite Gynoecopolls et la
piéfecture Gynecopolitaine. La ville de Momemphis et le nome Nitriotique
viennent après. A la gauche, en remontant le Nil, et dans le Delta même, il
place Naucratis sur le bord du fleuve, et il nomme ensuite Sa is, qu’il annonce
être distante du Nil de deux schoenes. Enfin, au-dessus de Sais, il place l’asile
d’Osiris, où l’on disoit que reposoit le corps d’Osiris. II est impossible, en suivant
les indications et la marche de Strabon sur la nouvelle carte de l’Egypte levée par
les ingénieurs de 1 armée d Orient, de ne-pas reconnoître, près de Sâ el-Haggâr,
Iemplacement de 1 ancienne Sais. En effet, ce village se trouve à gauche dans le
Delta, en remontant le fleuve, et dans une position tout-à-fait semblable à celle
quindique Strabon. A la vérité, l’enceinte que nous avons décrite est à mille
( ' ) V o y e z les Mémoires sur VÈgy pte, pag. 79. O c 'e sA t i , » ,
(2) otrab.Geogr. 11b, XVII,pag S oi, ed.Lut. Par. 1620, quoi,.
i i ' j o A d s i" istram v" ° 'Psb D e lta e t ad flu vium est
14) Ibid. pag. 802. » . i N a u c ra t is : duobus schoe nisà flumine distat S a is , e tp a u li
. / * ’ r à nlàft,à N«»- supra eam est Osiridis a sy lum, in q u o Osirim ja c .r e arbi-
«f»»f Xi j Ji m » V ' Stx mr J )iy sm à S<ÊTf , 5 / u e fi, rrantur. (St rab. Gtogm ph. l ib. XVI I , pag. 803. )