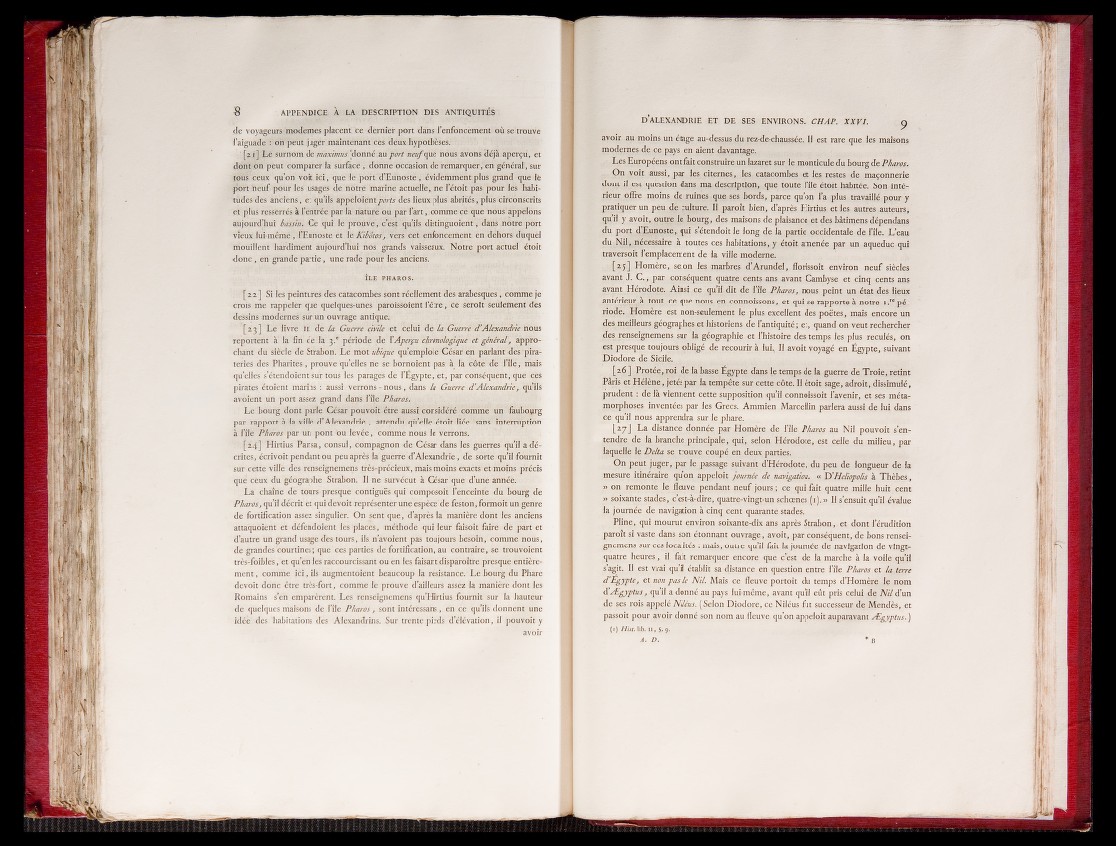
de voyageurs modernes placent ce dernier port dans J’enfoncement où se trouve
l’aiguade : on peut juger maintenant ces deux hypothèses.
[2 1] Le surnom de maximus [donné au port, neuf que nous avons déjà aperçu, et
dont on peut comparer la surface , donne occasion de remarquer, en général, sur
tous ceux qu’on voit ic i, que le port d’Eunoste , évidemment plus grand que lë
port neuf pour les usages de notre marine actuelle, ne l’étoit pas pour les habitudes
des anciens, et qu’ils appeloientports des lieux plus abrités, plus circonscrits
et plus resserrés à l’entrée par la nature ou par l’art, comme ce que nous appelons
aujourd’hui bassin. Ce qui le prouve, c’est qu’ils distinguoient, dans notre port
vieux lui-même , l’Eunoste et le Kibotos, vers cet enfoncement en dehors duquel
mouillent hardiment aujourd’hui nos grands vaisseaux. Notre port actuel étoit
d o n c , en grande partie, une rade pour les anciens.
Î L E P H A R O S .
[22] Si les peintures des catacombes sont réellement des arabesques, comme je
crois me rappeler que quelques-unes paroissoient l’ê tre, ce seroit seulement des
dessins modernes sur un ouvrage antique.
[23] Le livre 111 de la Guerre civile et celui de la Guerre d ’Alexandrie nous
reportent à la fin de la 3.' période de l’Aperçu chronologique et général, approchant
du siècle de Strahon. Le mot ubique qu’emploie César en parlant des pirateries
des Pharites, prouve qu’elles ne se bornoient pas à la côte de l’de, mais
qu’elles s’étendoient sur tous les parages de l’Egypte, et, par conséquent, que ces
pirates étoient marins : aussi verrons - nous, dans la Guerre d'Alexandrie, qu ils
avoient un port assez grand dans l’île Pharos.
Le bourg dont parle César pouvoit être aussi considéré comme un faubourg
par rapport à la ville d’Alexandrie , attendu qü’elle étoit liée sans interruption
à l’île Pharos par un pont ou levée, comme nous le verrons.
[24] Hirtius Pansa, consul, compagnon de César dans les guerres qu’il a décrites,
écrivoit pendant ou peu après la guerre d’Alexandrie, de sorte qu’il fournit
sur cette ville des renseignemens très-précieux, mais moins exacts et moins précis
que ceux du géographe Strabon. Il ne survécut à César que d’une année.
La chaîne de tours presque contiguës qui composoit l’enceinte du bourg de
Pharos, qu’il décrit et qui devoit représenter une espèce de feston, formoit un genre
de fortification assez singulier. On sent que, d’après la manière dont les anciens
attaquoient et défendoient les places, méthode qui leur faisoit faire de part et
d’autre un grand usage des tours, ils n’avoient pas toujours besoin, comme nous,
de grandes courtines; que ces parties de fortification, au contraire, se trouvoient
très-foibles, et qu’en les raccourcissant ou en les faisant disparoître presque entièrement
, comme ic i , ils augmentoient beaucoup la résistance. Le bourg du Phare
devoit donc être très-fort, comme le prouve d’ailleurs assez la manière dont les
Romains s’en emparèrent. Les renseignemens qu’Hirtius fournit sur la hauteur
de quelques maisons de l’île Pharos, sont intéressans, en ce qu’ils donnent une
idée des habitations des Alexandrins. Sur trente pieds d’élévation, il pouvoit y
avoir au moins un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Il est rare que les maisons
modernes de ce pays en aient davantage.
Les Européens ont fait construire un lazaret sur le monticule du bourg de Pharos.
On voit aussi, par les citernes, les catacombes et les restes de maçonnerie
dont il est question dans ma description, que toute l’île étoit habitée. Son intérieur
offre moins de ruines que ses bords, parce qu’on l’a plus travaillé pour y
pratiquer un peu de culture. Il paroît bien, d’après Hirtius et les autres auteurs,
quil y avoit, outre le bourg, des maisons de plaisance et des bâtimens dépendans
du port dEunoste, qui s’étendoitle long de la partie occidentale de l’île. L ’eau
du Nil, nécessaire à toutes ces habitations, y étoit amenée par un aqueduc qui
traversoit l’emplacement de la ville moderne.
[25] Homère, selon les marbres d’Arundel, florissoit environ neuf siècles
avant J. C . , par conséquent quatre cents ans avant Cambyse et cinq cents ans
avant Herodote. Ainsi ce qu’il dit de l’île Pharos, nous peint un état des lieux
antérieur a tout ce que nous en connoissons, et qui se rapporte à notre i.,e période.
Homere est non-seulement le plus excellent des poètes, mais encore un
des meilleurs géographes et historiens de l’antiquité ; et, quand on veut rechercher
des renseignemens sur la géographie et l’histoire des temps les plus reculés, on
est presque toujours obligé de recourir à lui, Il avoit voyagé en Égypte, suivant
Diodore de Sicile.
[26 ] Protée, roi de la basse Égypte dans le temps de la guerre de Troie, retint
Paris et Hélène, jetés par la tempête sur cette côte. Il étoit sage, adroit, dissimulé,
prudent : de là viennent cette supposition qu’il connoissoit l’avenir, et ses métamorphoses
inventées par les Grecs. Ammien Marcellin parlera aussi de lui dans
ce qu’il nous apprendra sur le phare.
[2 7 ] distance donnée par Homère de l’île Pharos au Nil pouvoit s’entendre
de la branche principale, qui, selon Hérodote, est celle du milieu, par
laquelle le Delta se trouve coupé en deux parties.
On peut juger, par le passage suivant d’Hérodote, du peu de longueur de la
mesure itinéraire qu’on appeloit journée de navigation. « D ’Heliopolis à Thèbes,
» on remonte le fleuve pendant neuf jours ; ce qui fait quatre mille huit cent
» soixante stades, c’est-à-dire, quatre-vingt-un schoenes (1).» Il s’ensuit qu’il évalue
la journée de navigation à cinq cent quarante stades.
Pline, qui mourut environ soixante-dix ans après Strabon, et dont l’érudition
paroît si vaste dans son étonnant ouvrage, avoit, par conséquent, de bons renseignemens
sur ces localités : mais, outre qu’il fait la journée de navigation de vingt-
quatre heures, il fait remarquer encore que c’est de la marche à la voile qu’il
s’agit. Il est vrai qu’il établit sa distance en question entre l’île Pharos et la terre
d ’Egypte, et non pas le N il. Mais ce fleuve portoit du temps d’Homère le nom
d’Ægyptus, qu’il a donné au pays lui-même, avant qu’il eût pris celui de M /d ’un
de ses rois appelé Niléus. (Selon Diodore, ce Niléus fut successeur de Mendès, et
passoit pour avoir donné son nom au fleuve qu’on appeloit auparavant Ægyptus. )
(1) Hist. lib. 11, S* 9-
A. D . * B