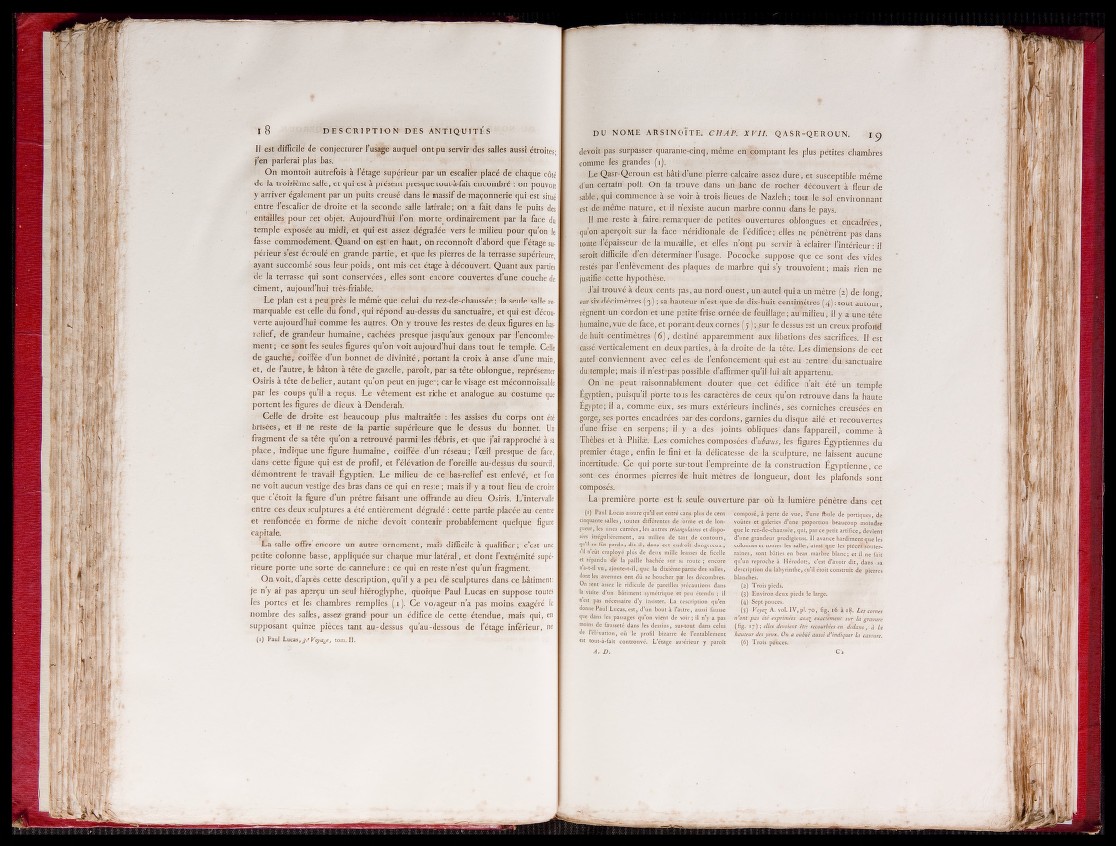
I! est difficile de conjecturer l’usage auquel ont pu servir des salles aussi étroites'
j’en parlerai plus bas.
On montoit autrefois à l’étage supérieur par un escalier placé de chaque côté
de la troisième salle, et qui est à présent presque tout-à-fait encombré : on pouvoit
y arriver également par un puits creusé dans le massif de maçonnerie qui est situé
entre l’escalier de droite et la seconde salle latérale; on a fait dans le puits des
entailles pour cet objet. Aujourd’hui l’on monte ordinairement par la face du
temple exposée au midi, et qui est assez dégradée vers le milieu pour qu’on le
fasse commodément. Quand on est en haut, on reconnoît d’abord que !etage supérieur
s’est écroulé en grande partie, et que les pierres de la terrasse supérieure,
ayant succombé sous leur poids, ont mis cet étage à découvert. Quant aux parties
de la terrasse qui sont conservées, elles sont encore couvertes d’une couche de
ciment, aujourd’hui très-friable.
Le plan est à peu près le même que celui du rez-de-chaussée ; la seule salle remarquable
est celle du fond, qui répond au-dessus du sanctuaire, et qui est découverte
aujourd’hui comme les autres. On y trouve les restes de deux figures en bas-
relief, de grandeur humaine, cachées presque jusqu’aux genoux par l’encombrement
; ce sont les seules figures qu’on voit aujourd’hui dans tout le temple. Celle
de gauche,! coiffée d’un bonnet de divinité, portant la croix à anse d’une main,
et, de l’autre, le bâton à tête de gazelle, paroît, par sa tête oblongue, représenter
Osiris à tête de belier, autant qu’on peut en juger; car le visage est méconnoissable
par les coups qu’il a reçus. Le vêtement est riche et analogue au costume que
portent les figures de dieux à Denderah.
Celle de droite est beaucoup plus maltraitée ; les assises du corps ont été
brisées, et il ne reste de la partie supérieure que le dessus du bonnet. Un
fragment de sa tête qu’on a retrouvé parmi les débris, et que j’ai rapproché à sa
place, indique une figure humaine, coiffée d’un réseau; l’oeil presque de face,
dans cette figure qui est de profil, et l’élévation de l’oreille au-dessus du sourcil,
démontrent le travail Egyptien. Le milieu de ce bas-relief est enlevé, et l’on
ne voit aucun vestige des bras dans ce qui en reste ; mais il y a tout lieu de croire
que c’étoit la figure d’un prêtre faisant une offrande au dieu Osiris. L ’intervalle
entre ces deux sculptures a été entièrement dégradé : cette partie placée au centre
et renfoncée en forme de niche devoit contenir probablement quelque figure
capitale.
La salle offre'encore un autre ornement, mais difficile à qualifier; c’est une
petite colonne basse, appliquée sur chaque mur latéral, et dont l’extrémité supérieure
porte une sorte de cannelure: ce qui en reste n’est- qu’un fragment.
On, voit, d’après cette description, qu’il y a peu de sculptures dans ce bâtiment:
je n’y ai pas aperçu un seul hiéroglyphe, quoique Paul Lucas en suppose toute!
les portes et les chambres remplies ( i). Ce voyageur n’a pas moins exagéré le
nombre des salles, assez grand pour un édifice de cette étendue, mais qui, en
supposant quinze pièces tant au-dessus qu’au-dessous de l’étage inférieur, ne
(i) Paul Lucas, j J Voyage, torn. II.
devoit pas surpasser quarante-cinq, même en comptant les plus petites chambres
comme lés grandes (1).
Le Qasr-Qeroun est bâti d’une pierre calcaire assez dure, et susceptible même
d’un certain poli. On la trouve dans un banc de rocher découvert à fleur de
sable, qui commence à se voir à trois lieues de Nazleh; tout le sol environnant
est de même nature, et il n’existe aucun marbre connu dans le pays.
Il me reste à faire remarquer de petites ouvertures oblongues et encadrées
qu’on aperçoit sur la face méridionale de l’édifice;: elles ne pénètrent pas dans
toute l’épaisseur de la muraille, et elles n’ont pu servir à éclairer l’intérieur : il
seroit difficile d;en déterminer l’usage. Pococke suppose que ce sont des vides
restés par l’enlèvement des plaques de marbre qui s’y trouvoient ; mais rien ne
justifie cette hypothèse.
J’ai trouvé à deux cents pas, au nord ouest, un autel qui a un mètre (2) de long,
sur six décimètres (3 ) ; sa hauteur n’est que de dix-huit centimètres (4) : tout autour
régnent un cordon et une petite frise ornée de feuillage ; au milieu, il y a une tête
humaine, vue de face, et portant deux cornes ( 5 ) ; sur le dessus est un creux profond
de huit centimètres (6), destiné apparemment aux libations des sacrifices. Il est
cassé verticalement en deux parties, à la droite de la tête. Les dimensions de cet
autel conviennent avec celles de l’enfoncement qui est au centre du sanctuaire
du temple; mais il n’esfpas possible d’affirmer qu’il lui ait appartenu.
On ne peut raisonnablement douter que cet édifice n’ait été un temple
Egyptien, puisqu’il porte tous les caractères de ceux qu’on retrouve dans la haute
Egypte; il a, comme eux, ses murs extérieurs inclinés, ses corniches creusées en
gorge^ ses portes encadrées par des cordons, garnies du disque ailé et recouvertes
d’une frise en serpens; il y a des joints obliques' dans l’appareil, comme à
Thebes et a Philæ. Les corniches composées d uboeus, les figures Égyptiennes du
premier étage, enfin le fini et la délicatesse de la sculpture, ne laissent aucune
incertitude. Ce qui porte sur-tout l’empreinte de la construction Égyptienne, ce
sont ces énormes pierres :de huit mètres de longueur, dont les plafonds sont
composés.
La première porte est la seule ouverture par où la lumière pénètre dans cet
(1) Paul Lucas assure qu’il est entré dans plus de cent
cinquante salles, toutes différentes de forme et de longueur,
les unes carrées, les autres triangulaires et disposées
irrégulièrement, au milieu de tant de contours,
qu’il se fut perdu, dit-il, dans cet endroit dangereux,
s il n’eut employé plus de deux mille brasses de ficelle
et répandu de la paille hachée sur sa route ; encore
na-t-il vu, ajoute-t-il, que la dixième partie des salles,
dont les avenues ont dû se boucher par les décombres.
On sent assez le ridicule de pareilles précautions dans
la visite d’un bâtiment symétrique et peu étendu ; il
nest pas nécessaire d’y insister. La description qu’en
donne Paul Lucas, est, d’un bout à l’autre, aussi fausse
que dans les passages qu’on vient de voir ; il n’y a pas
moins de fausseté dans les dessins, sur-tout dans celui
de 1 élévation, où le profil bizarre de l’entablement
est tout-à-fait controuvé. L’étage supérieur y paroit
A. D .
composé, à perte de vue, d’une fbule de portiques, de
voûtes et galeries d’une proportion beaucoup moindre
que le rez-de-chaussée, qui, par ce petit artifice, devient
d’une grandeur prodigieuse. Il avance hardiment que les
colonnes et toutes les salles, ainsi que les pièces souterraines,
sont bâties en beau marbre blanc; et il ne fait
qu’un reproche à Hérodote, c’est d’avoir dit, dans - sa
description du labyrinthe, qu’il étoit construit de pierres
blanches.
(2) Trois pieds.
(3) Environ deux pieds de large.
(4) Sept pouces.
(5) Voyei A. vol. IV, pl. 70, fig. 16 à 18. Le? cornes
n1 ont pas été exprimées asse£ exactement sur la gravure
( “ g* 17 ) » e^es dévoient être recourbées en dedans, à la
hauteur des yeux. On a oublié aussi d’ indiquer la cassure.
(6) Trois pouces.
C i