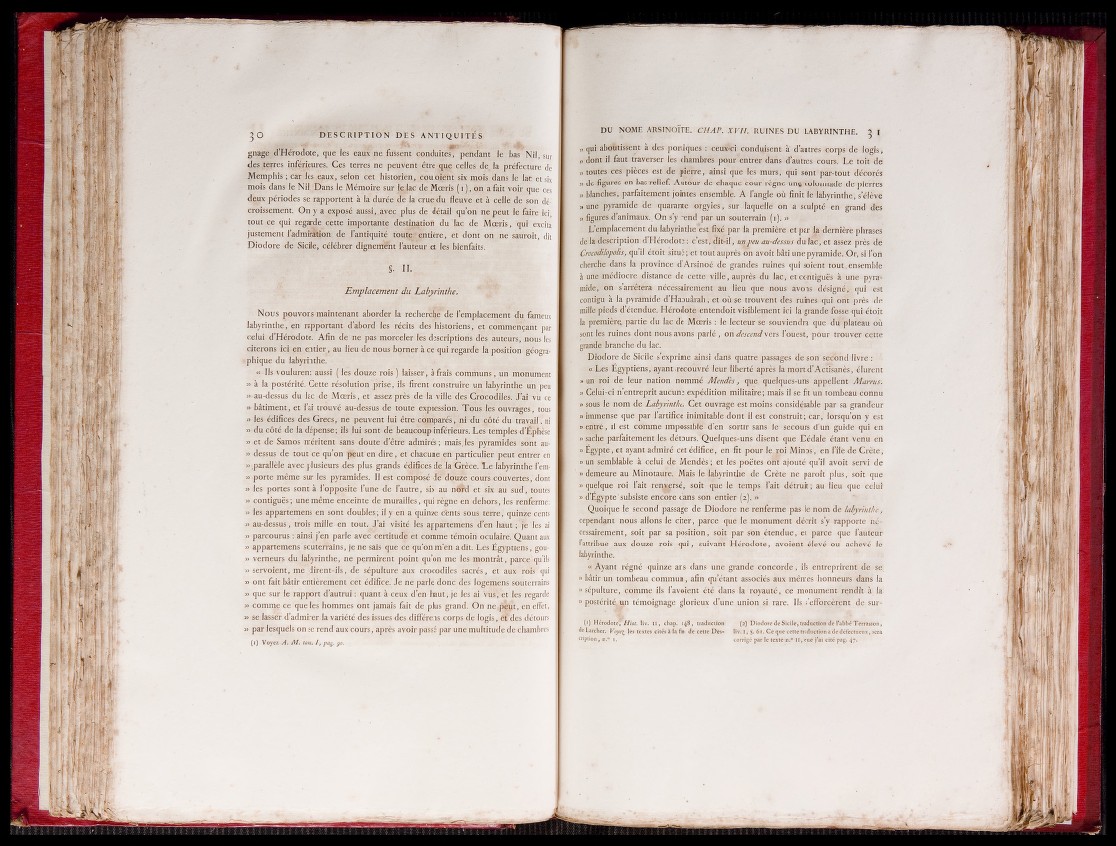
3 0 D E S C R I P T IO N D E S A N T IQ U IT É S
, , kl 4jn
gnage d Hérodote, que les eaux ne fussent conduites, pendant le bas Nil, sur
des terres inférieures. Ces terres ne peuvent être que celles de la préfecture de
Memphis ; car les eaux, selon cet historien, couloient six mois dans le lac et six
mois dans le Nil. Dans le Mémoire sur le lac de Moeris ( i ), on a fait voir que ces
deux périodes se rapportent à la durée de la crue du fleuve et à celle de son décroissement.
On y a exposé aussi, avec plus de détail qu’on ne peut le faire ici
tout ce qui regarde cette importante destination du lac de Moeris, qui excita
justement l’admiration de l’antiquité toute entière, et dont on ne saurait, dit
Diodore de Sicile, célébrer dignement l’auteur et les bienfaits.
§. II.
Emplacement du Labyrinthe.
Nous pouvons maintenant aborder la recherche de l’emplacement du fameux
labyrinthe, en rapportant d’abord les récits des historiens, et commençant par
celui d’Hérodote. Afin de ne pas morceler les descriptions des auteurs, nous les
citerons ici en entier, au lieu de nous borner à ce qui regarde la position géographique
du labyrinthe.
« Ils voulurent aussi ( les douze rois ) laisser, à frais communs, un monument
à la postérité. Cette résolution prisé, ils firent construire un labyrinthe un peu
au-dessus du lac de Moeris, et assez près de la ville des Crocodiles. J’ai vu ce
bâtiment, et l’ai trouvé au-dessus de toute expression. Tous les ouvrages, tous
les édifices des Grecs, ne peuvent lui être compares, ni du côté du travail, ni
du côté de la dépense; ils lui sont de beaucoup inférieurs. Les temples d’Éphèse
et de Samos méritent sans doute d’être admirés; mais.les pyramides sont au-
dessus de tout ce qu’on peut en dire, et chacune en particulier peut entrer en
.parallèle avec plusieurs des plus grands édifices de la Grèce. L e labyrinthe l’emporte
même sur les pyramides. Il est composé dé douze cours couvertes, dont
les portes sont à l’opposite l’une de l’autre, six au nord et six au sud, toutes
contiguës; une même enceinte de murailles, qui règne en dehors, les renferme:
les appartemens en sont doubles; il y en a quinze cents sous terre, quinze cents
au-dessus, trois mille en tout. J’ai visité les appartemens d’en haut ; je les ai
parcourus : ainsi j’en parle avec certitude et comme témoin oculaire. Quant aux
appartemens souterrains, je ne sais que ce qu’on m’en a dit. Les Egyptiens, gouverneurs
du labyrinthe, ne permirent point qu’on me les montrât, parce qu’ils
servoient, me dirent-ils, de sépulture aux crocodiles sacrés, et aux rois qui
ont fait bâtir entièrement cet édifice. Je ne parle donc des logemens souterrains
que sur le rapport d’autrui : quant à ceux d’en haut, je les ai Vus, et les regarde
comme ce que les hommes ont jamais fait de plus grand. On ne;.peut, en effet,
se lasser d’admirer la variété des issues des différens corps de logis, et des détours
par lesquëls on se rend aux cours, après avoir passé par une multitude de chambres
(i) Voyez.A. M . tom, I , pag. po.
» qui aboutissent a des portiques : ceux-ci. conduisent à d’autres corps de logjs,
« dont il faut traverser les chambres pour entrer dans d’autres cours. Le toit de
„toutes ces pièces est de pierre, ainsi que les murs, qui sont par-tout décorés
» de figures en bas-relief. Autour de chaque cour règne unç colonnade de pierres
» blanches, parfaitement jointes ensemble. A l’angle où finit lé labyrinthe, s’élève
» une pyramide de quarante orgyies, sur laquelle on a sculpté en grand dés
» figures d’animaux. On s’y rend par un souterrain (1). «
L’emplacement du labyrinthe est fixé par la première et par la dernière phrases
de la description d Hérodote : c’est, dit-il, un peu au-dessus du lac, et assez près de
Crocodilopolis, qu’il étoit situé ; et tout auprès on avoit bâti une pyramide. Or, si l’on
cherche dans la province d’Arsinoé de grandes ruines qui soient tout.ensemble
à une médiocre distance de cette ville, auprès du lac, et contiguës à une pyramide,
on s’arrêtera nécessairement au lieu que nous avons désignée qui est
contigu à la pyramide d’Haouârah, et où se trouvent des ruines qui ont près de
mille pieds d’étendue. Hérodote entendoit visiblement ici la grande fosse qui étoit
la première partie du lac de Moeris : le lecteur se souviendra que du plateau où
sont les ruines dont nous avons parlé, on descend vers l’ouest, pour trouver cette
grande branche du lac.
Diodore de Sicile s’exprime ainsi dans quatre passages de son second livre :
« Les Egyptiens, ayant .recouvré leur liberté après la mort d’Actisanès, élurent
» un roi de leur nation nommé Mendès, que quelques-uns appellent Marrus.
» Celui-ci n’entreprit aucune expédition militaire; mais il se fit un tombeau connu
» sous le nom de Labyrinthe. Cet ouvrage est moins considérable par sa grandeur
» immense que par l’artifice inimitable dont il est construit; car, lorsqu’on y est
» entré, il est comme impossible d’en sortir sans le secours d’un guide qui en
» sache parfaitement les détours. Quelques-uns disent que Dédale étant venu en
» Egypte, et ayant admiré cet édifice, en fit pour le roi Minos, en l’île de Crète,
» un semblable à celui de Mendès ; et les poëtes ont ajouté qu’il avoit servi de
» demeure au Minotaure. Mais le labyrinthe de Crète ne paraît plus, soit que
»quelque roi l’ait renversé, soit que le temps l’ait détruit; au lieu que celui
» d’Egypte'subsiste encore dans son entier (2). »
Quoique le second passage de Diodore ne renferme pas le nom de labyrinthe,
cependant nous allons le citer, parce que le monument décrit s’y rapporte nécessairement,
soit par sa position, soit par son étendue, et parce que l’auteur
1 attribue aux douze rois qui, suivant Hérodote, avoient élevé ou achevé le
labyrinthe.
« Ayant régné quinze ans dans une grande concorde, ils entreprirent de se
» bâtir un tombeau commun, afin cpt’étant associés aux mêmes honneurs dans la
»sépulture, comme ils l’avoient été dans la royauté, ce monument rendît à la
» postérité, un témoignage glorieux d’une union si rare. Us s’efforcèrent de sur-
(1) Hérodote, Hist. liv. i l , chap. 148, traduction (2) Diodore de Sicile, traduction de l’abbé Terrasson,
de Larcher. Vqye^ les textes cités à la fin de cette Des- liv. 1 6 1 . Ce que cette traduction-a de défectueux, sera
cripiion, n." 1. corrigé par le texte- n.° 11, que j’ai cité pag. 47*