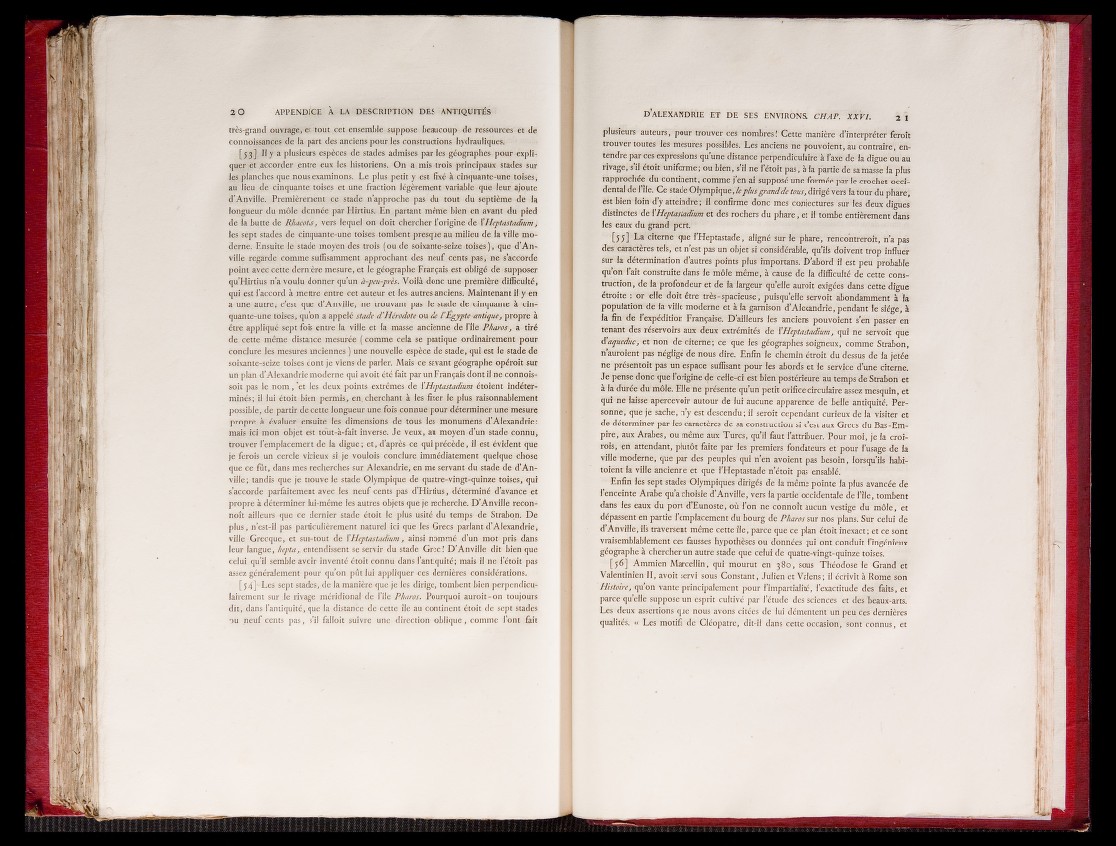
très-grand ouvrage, et tout cet ensemble suppose beaucoup de ressources et de
connoissances de la part des anciens pour les constructions hydraulicpies,
[ i3 ] Hy a plusieurs espèces de stades admises par les géographes pour expliquer
et accorder entre eux les historiens. On a mis trois principaux stades sur
les planches que nous examinons. Le plus petit y est fixé à cinquante-une toises,
au lieu de cinquante toises et une fraction légèrement variable que leur ajoute
d’Anville. Premièrement ce stade n’approche pas du tout du septième de la
longueur du môle donnée par Hirtius. En partant même bien en avant du pied
de la butte de R/iacotis, vers lequel on doit chercher l’origine de X Heptastadium,
les sept stades de cinquante-une toises tombent presque au milieu de la ville moderne.
Ensuite le stade moyen des trois (ou de soixante-seize toises), que d’A n ville
regarde comme suffisamment approchant des neuf cents pas, ne s’accorde
point avec cette dernière mesure, et le géographe Français est obligé de supposer
qu’Hirtius n’a voulu donner qu’un à-peu-près. Voilà donc une première difficulté,
qui est l’accord à mettre entre cet auteur et les autres anciens. Maintenant il y en
a une autre, c’est que d’Anville, ne trouvant pas le stade de cinquante à cinquante
une toises, qu’on a appelé stade d ’Hérodote ou de l'Egypte antique, propre à
être appliqué sept fois entre la ville et la masse ancienne de l'île Pharos, a tiré
de cette même distance mesurée ( comme cela se pratique ordinairement pour
conclure les mesures anciennes ) une nouvelle espèce de stade, qui est le stade de
soixante-seize toises dont je viens de parler. Mais ce savant géographe opéroit sur
un plan d’Alexandrie moderne qui avoit été fait par un Français dont il ne connois-
soit pas le n om , et les deux points extrêmes de 1 Heptastadium étoient indéterminés;
il lui étoit bien permis, en. cherchant à les fixer le plus raisonnablement
possible, de partir de cette longueur une fois connue pour déterminer une mesure
propre à évaluer ensuite les dimensions de tous les monumens d’Alexandrie:
mais ici mon objet est tout-à-fait inverse. Je veux, au moyen d’un stade connu,
trouver l’emplacement de la digue; et, d’après ce qui précède, il est évident que
je ferois un cercle vicieux si je voulois conclure immédiatement quelque chose
que ce fût, dans mes recherches sur Alexandrie, en me servant du stade de d’A n ville;
tandis que je trouve le stade Olympique de quatre-vingt-quinze toises, qui
s’accorde parfaitement avec les neuf cents pas d’Hirtius, déterminé d’avance et
propre à déterminer lui-même les autres objets que je recherche. D ’Anville recon-
noît ailleurs que ce dernier stade étoit le plus usité du temps de Strabon. De
plus, n’est-il pas particulièrement naturel ici que les Grecs parlant d’Alexandrie,
ville Grecque, et sur-tout de fHeptastadium, ainsi nommé d’un mot pris dans
leur langue, hepta, entendissent se servir du stade Grec! D ’Anville dit bien que
celui qu’il semble avoir inventé étoit connu dans l’antiquité; mais il ne {’étoit pas
assez généralement pour qu’on pût lui appliquer ces dernières considérations.
[ jd l ’ Les sept stades, de la manière que je les dirige, tombent bien perpendiculairement
sur le rivage méridional de l’île Pharos. Pourquoi auroit-on toujours
dit, dans l’antiquité, que la distance de cette île au continent étoit de sept stades
ou neuf cents pas, s’il falloir suivre une direction oblique, comme lont fait
plusieurs auteurs, pour trouver ces nombres! Cette manière d’interpréter feroit
trouver toutes les mesures possibles. Les anciens ne pouvoient, au contraire, entendre
par ces expressions qu une distance perpendiculaire à l’axe de fa digue ou au
rivage, s il étoit uniforme; ou bien, s il ne 1 étoit pas, à la partie de sa masse la plus
rapprochée du continent, comme j en ai supposé une formée par le crochet occidental
de 1 île. Ce stade Olympique, le plus grand de tous, dirigé vers la tour du phare,
est bien loin d’y atteindre ; il confirme donc mes conjectures sur les deux digues
distinctes de l'Heptastadium et des rochers du phare, et il tombe entièrement dans
les eaux du grand port.
[55] L a citerne que lHeptastade, aligné sur Je phare, rencontreroit, n’a pas
des caractères tels, et n’est pas un objet si considérable, qu’ils doivent trop influer
sur la détennination d’autres points plus importans. D ’abord il est peu probable
qu’on fait construite dans fe môle même, à cause de la difficulté de cette construction,
de la profondeur et de la largeur qu’elle auroit exigées dans cette digue
étroite : or elle doit être très-spacieuse, puisqu’elle servoit abondamment à la
population de la ville moderne et à la garnison d’Alexandrie, pendant le siège, à
la fin de 1 expédition Française. D ailleurs les anciens pouvoient s’en passer en
tenant des réservoirs aux deux extrémités de l'Heptastadium, qui ne servoit que
A aqueduc, et non de citerne; ce que les géographes soigneux, comme Strabon,
n auraient pas négligé de nous dire. Enfin le chemin étroit du dessus de la jetée
ne presentoit pas un espace suffisant pour les abords et le service d’une citerne.
Je pense donc que l’origine de celle-ci est bien postérieure au temps de Strabon et
à la durée du môle. Elle ne présente qu’un petit orifice circulaire assez mesquin, et
qui ne laisse apercevoir autour de lui aucune apparence de belle antiquité. Personne,
que je sache, n y est descendu; il serait cependant curieux de la visiter et
de déterminer par les caractères de sa construction si c’est aux Grecs du Bas-Empire,
aux Arabes, ou même aux Turcs, qu’il faut l’attribuer. Pour moi, je la croirais,
en attendant, plutôt faite par les premiers fondateurs et pour l’usage de la
ville moderne, que par des peuples qui n’en avoient pas besoin, lorsqu’ils habi-
toient la ville ancienne et que l’Heptastade n’étoit pas ensablé.
Enfin les sept stades Olympiques dirigés de la même pointe la plus avancée de
1 enceinte Arabe qua choisie d’Anville, vers la partie occidentale de l’île, tombent
dans les eaux du port dEunoste, où l’on ne connoît aucun vestige du môle, et
dépassent en partie 1 emplacement du bourg de Pharos sur nos plans. Sur celui de
d’Anville, ils traversent même cette île, parce que ce plan étoit inexact; et ce sont
vraisemblablement ces fausses hypothèses ou données qui ont conduit l’ingénieux
géographe à chercher un autre stade que celui de quatre-vingt-quinze toises.
[56] Ammien Marcellin, qui mourut en 380, sous Théodose le Grand et
Valentinien II, avoit servi sous Constant, Julien et Valens; il écrivit à Rome son
Histoire, quon vante principalement pour l’impartialité, l’exactitude des faits, et
parce qu elle suppose un esprit cultivé par l’étude des sciences et des beaux-arts.
Les deux assertions que nous avons citées de lui démentent un peu ces dernières
qualités. « Les motifs de Cléopatre, dit-il dans cette occasion, sont connus, et