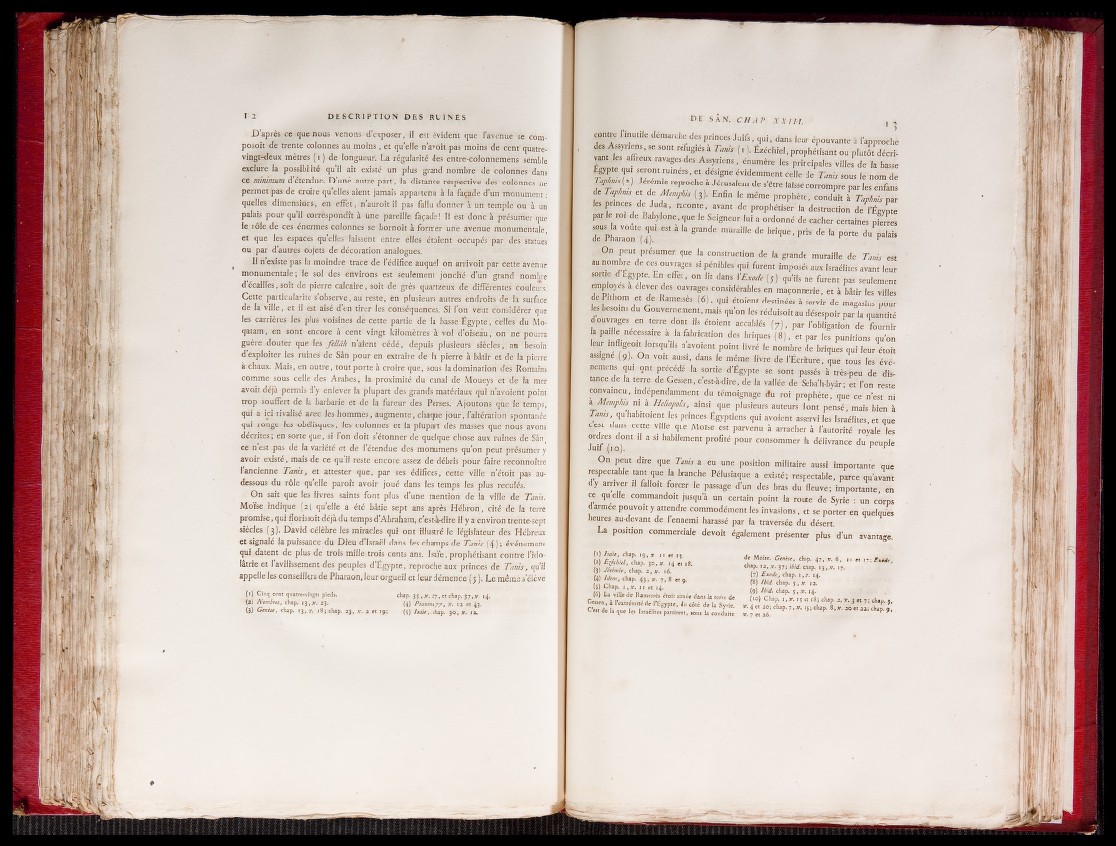
D ’après ce que nous venons d’exposer, il est évident que l'avenue se com-
posoit de trente colonnes au moins, et qu’elle n’avoit pas moins de cent quatre-
vingt-deux mètres ( i ) de longueur. La régularité tles entre-colonnemens semble
exclure la possibilité qu’il ait existé un plus grand nombre de colonnes dans
ce minimum détendue. Duné autre part, la distance respective des colonnes ne
permet pas de croire qu’elles aient jamais appartenu à la façade d’un monument ;
quelles dimensions, en effet, n’auroit il pas fallu donner à un temple ou à un
palais pour qu’il correspondît à une pareille façade! Il est donc à présumer que
le rôle de ces énormes colonnes se bornoit à former une avenue monumentale,
et que les espaces qu elles laissent entre elles étoient occupés par des statues
ou par d’autres objets de décoration analogues.
Il n existe pas la moindre trace de 1 édifice auquel on arrivoit par cette avenue
monumentale; le sol des environs est seulement jonché d’un grand nombre
d’écailfes, soit de pierre calcaire, soit de grès quartzeux de différentes couleurs.
Cette particularité s observe, au reste, en plusieurs autres endroits de la surface
de la ville, et il est aise d en tirer les conséquences. Si I on veut considérer que
les carrières les plus voisines de cette partie de la basse Egypte, celles du Mo-
qatam, en sont encore à cent vingt kilomètres à vol d’oiseau, on ne pourra
guère douter que les fèllâh n’aient cédé, depuis plusieurs siècles, an besoin
d exploiter les ruines de San pour en extraire de la pierre à bâtir et de la pierre
à chaux. Mais, en outre, tout porte à croire que, sous la domination dès Romains
comme sous celle des Arabes, la proximité du canal de Moueys et de la mer
avoit déjà permis d’y enlever la plupart des grands matériaux qui n’avoient point
trop souffert de la barbarie et de la fureur des Perses. Ajoutons que le temps,
qui a ici rivalisé avec les hommes, augmente, chaque jour, l’altération spontanée
qui ronge les obélisques, les colonnes et la'plupart des masses que nous avons
décrites; en sorte que, si 1 on doit s étonner de quelque chose aux ruines de Sân
ce nest pas de la Variété et de l’étendue des monumens qu’on peut présumer y
avoir existé, mais de ce quil reste encore assez de débris pour faire reconnoftre
1 ancienne Tunis, et attester que, par ses édifices, cette ville n’étoit pas au-
dessous du rôle qu’elle paroît avoir joué dans les temps les plus reculés.
On sait que les livres saints font plus d’une mention de la ville de Tanis.
Moïse indique (2} quelle a été bâtie sept ans après Hébron, cité de la terre
promise, qui florissoit déjà du temps d’Abraham, c’est-à-dire il y a environ trente-sept
siècles ( 3 )• David célébré les miracles qui ont illustré Je législateur des Hébreux
et signale la puissance du Dieu d Israël dans les champs de Tunis (4 ) i événemens
qui datent de plus de trois mille trois cents ans. Isaïe, prophétisant contre l’idolâtrie
et I avilissement des peuples dÉgypte, reproche aux princes de Tunis, qu’il
appelle les conseillers de Pharaon, leur orgueil et leur démence (y ). Le même s’élève
(1) Cinq cent quatre-vingts pieds.
(2) Nombres, chap. 13 , y. 23.
(3) Genhe, chap. 13, y. 18; chap. 23, y. 2 et 19;
chap. 35 , jr . 27, et chap. 37,-jtr. 14.
(4) Psaume7 7 , y. 12 et 43.
(5) Jsaje ,. chap. 30, y. 12*
contre l'inutile démarche des princes Juifs, qui, dans leur épouvante à l'approche
des Assyriens, se sont réfugiés à Tanis (, ). Ézéchiel, prophétisant ou plutôt décrivant
les affieux ravages des Assyriens, énumère les principales villes de la basse
Egypte qui seront rumees, et désigne évidemment celle de Tunis sous le nom de
Tuplms{ 2). Jeremie reproche a Jérusalem de s’être laissé corrompre parles enfans
de Tuplmis et de Manphs (3). Enfin le même prophète, conduit à Taplmis par
les princes de Juda, raconte, avant de prophétiser'la destruction de l’Ëgypte
par le roi de Babylone, que le Seigneur lui a ordonné de cacher certaines pierres
T p L 7 o n u î est à Ia grande muraille de brique’ près de la porte du palais
On peut présumer que la construction de la grande muraille de Tunis est
au nombre de ces ouvrages si pénibles qui furent imposés aux Israélites avant leur
sortie d Égypte. En effet, on lit dans l’Exode (y) qu’ils ne furent pas seulement
emp oyes a elever des ouvrages considérables en maçonnerie, et à bâtir les villes
dePithom et de Ramesses (6), qui étoient destinées à servir de magasins pour
les besoins du Gouvernement, mais qu’on les réduisoit au désespoir par la quantité
d ouvrages ^ en terre dont ils étoient accablés (7 ) , par l’obligation de fournir
a paille nécessaire a la fabrication des briques (8), et par les punitions qu’on
lem mfligeon lorsquils navoient point livré le nombre de briques qui leur étoit
assigne (9). On voit aussi, dans le même livre de l'Écriture, que tous les événemens
qui ont précédé la sortie dÉgypte se sont passés à très-peu de distance
de la terre de Gessén, c’est-à-dire, de la vallée de Seba’h-byâr; et l’on reste
convaincu, indépendamment du témoignage du roi prophète, que ce n’est ni
zMentphis ni k Heliopolis, ainsi que plusieurs auteurs font pensé, mais bien à
Tunis, qu habitoient les princes Égyptiens qui avoient asservi les Israélites, et que
cest dans cette ville que Moïse est parvenu à arracher à l’autorité royale les
ordres dont il a si habilement profité pour consommer la délivrance du peuple
Juif (10). r v
On peut dire que Tunis a eu une position militaire aussi importante que
respectable tant que la branche Pélusiaque a existé; respectable, parce qu’avant
dy arriver il falloit forcer le passage d’un des bras du fleuve; importante, en
ce quelle commandoit jusqu’à un certain point la route de Syrie : un corps
darmee pouvoit y attendre commodément les invasions, et se porter en quelques
heures au-devant de l’ennemi harassé par la traversée du désert.
La position commerciale devoit également présenter plus d’un avantage.
! ! ' 9 ’ * " " ie Moïse. Genisc, chap. 4 7 , y . 6, s i et 17; g x té f
W E ych ul, Chap. 30, v . .4 et ,8. chap. la , * . 3 7:',m chap. , * . .7.
(3) Jeremie, chap. 2 , y . 16. /„x 7
m u , r . „ (7) J-xode, chap. \ ,y . 14.
(4) Idem, chap. 43, y, 7 8 et o. /o\ /*•. .
le\ r u , / y (b) •otd. chap. ' , y. 12.
t,\ 1 ■ . . . (9) Ibid. chap. ;,a r . 14.
GcssL S i- “ T ; ? " ° " !T ° la dc (l0> Cb* h *> V. i j et 18; chap. 2, V. 3 et 7; chap, c
C o t d l r 7 7 -, O T ,e ' d“ C° ‘ e deIa » • 4 « - ° î chap. 7 , xr. ,5 ; chap. 8 ,as. aoet J chap. 1
Cest de la tpie les Israélites partirent, sous la conduite v. 7 et 1 6 . P