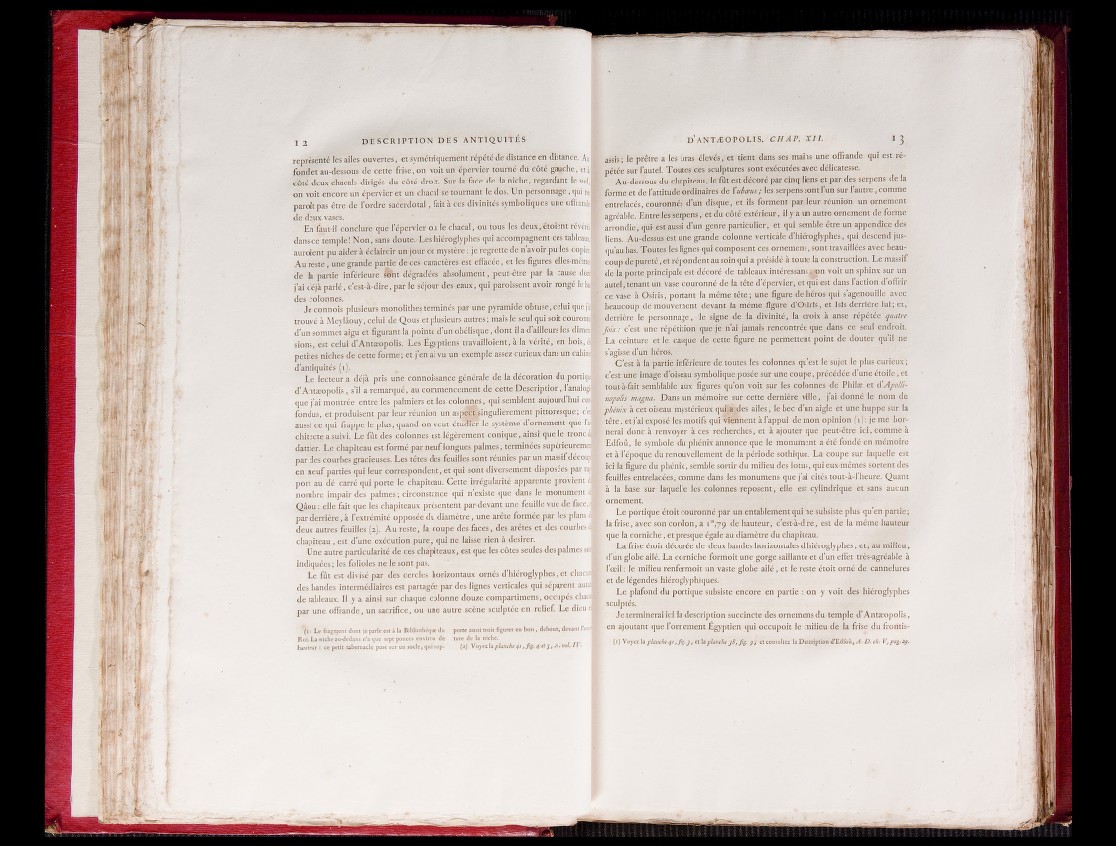
représenté lès ailes ouvertes, et symétriquement répété de distance en distance. AuI
fond et au-dessous de cette frise, on voit un épervier tourné dti côté gauche, et à g
côté deux chacals dirigés du côté droit. Sur la face de la niche, regardant le sud,
on voit encore un épervier et un chacal se tournant le dos. Un personnage, qui neI
paroît pas être de l’ordre sacerdotal, fait à ces divinités symboliques une ofiiaudtl
de deux vases.
En faut-il conclure que l’épervier ou le chacal, ou tous les deux, étoient révéré :
dans ce temple! Non, sans doute.-Les hiéroglyphes qui accompagnent ces tableaux!
auroient pu aider à éclaircir un jour ce mystère : je regrette de n’avoir pu les copier!
Au reste, une grande partie de ces caractères est effacée, et les figures elles-même!
de la partie inférieure font dégradées absolument, peut-être par la cause donij
j’ai déjà parlé, c’est-à-dire, par le séjour des eaux, qui paroissent avoir rongé le k l
des colonnes.
Je connois plusieurs monolithes terminés par une pyramide obtuse, celui que j’iil
trouvé à Meylâouy, celui de Qous et plusieurs autres ; mais le seul qui soit couronnl
d’un sommet aigu et figurant la pointe d un obélisque, dont il a d ailleurs les dimenl
sions, est celui d’Antæopolis. Les Égyptiens travailloient, à la vérité, en bois, ¿1
petites niches de cette forme ; et j’en ai vu un exemple assez curieux dans un cabine'
d’antiquités (i).
Le lecteur a déjà pris une connoissance générale de la décoration du portiqiil
d’Antæopolis, s’il a remarqué, au commencement de cette Description, 1 analogil
que j’ai montrée entre les palmiers et les colonnes, qui semblent aujourdhui coït]
fondus, et produisent par leur réunion un aspect-singulièrement pittoresque; ce!
aussi ce qui frappe le plus, quand on veut etùdier le système d ornement que bail
chitecte a suivi. Le fût des colonnes est légèrement conique, ainsi que le troncdl
dattier. Le chapiteau est formé par neuf longues palmes, terminées superieuremenl
par des courbes gracieuses. Les têtes des feuilles sont réunies par un massif decoupl
en neuf parties qui leur correspondent, et qui sont diversement disposées par rapl
port au dé carré qui porte le chapiteau. Cette irrégularité apparente provient dl
nombre impair des palmes ; circonstance qui n existe que dans le monument dl
Qâou : elle fait que les chapiteaux présentent par-devant une feuille vue de face,h
par derrière, à l’extrémité opposée du diamètre, une arête formée par les plans dl
deux autres feuilles (z). Au reste, la coupe des faces, des arêtes et des courbes dl
chapiteau , est d’une exécution pure, qui ne laisse rien à desirer.
Une autre particularité de ces chapiteaux, est que les côtes seules des palmes s o l
indiquées; les folioles ne le sont pas.
Le fut est divisé par des cercles horizontaux ornés d’hiéroglyphes, et chacun
des bandes intermédiaires est partagée par des lignes verticales qui séparent autat
de tableaux. Il y a ainsi sur chaque colonne douze compartimens, occupés Chacu
par une offrande, un sacrifice, ou une autre scène sculptee en relief. Le dieu e
(i) Le fragment dont je parle est à la Bibliothèque du porte aussi trois figures en bois, debout, devant louv
Roi. La niche au-dedans n’a que sept pouces environ de ture de la niche.
hauteur: ce petit tabernacle pose sur un socle, qui sup- (a) Voyezla planche 41 ,Jlg. 4-ct p, A . vol. IVassis
; le prêtre a les bras élevés, et tient dans ses mains une offrande qui est répétée
sur l’autel. Toutes ces sculptures sont exécutées avec délicatesse.
Au-dessous du chapiteau, le fût est décoré par cinq liens et par des serpens de la
forme et de l’attitude ordinaires de ïuloeus; les serpens sont l’un sur l’autre, comme
entrelacés, couronnés d’un disque, et ils forment par leur réunion un ornement
agréable. Entre les serpens, et du côté extérieur, il y a un autre ornement de forme
arrondie, qui- est aussi d’un genre particulier, et qui semble être un appendice des
liens. Au-dessus est une grande colonne verticale d’hiéroglyphes, qui descend jusqu’au
bas. Toutes les lignes qui composent ces ornemens, sont travaillées avec beaucoup
de pureté, et répondent au soin qui a présidé à toute la construction. Le massif
de la porte principale est décoré de tableaux intéressansrfon voit un sphinx sur un
autel, tenant un vase couronné de la tête d’épervier, et qui est dans 1 action d offrir
ce. vase à Osiris, portant la même tête; une figure de héros qui s’agenouille avec
beaucoup de mouvement devant la même figure d’Osiris, et Isis derrière lui; et,
derrière le personnage, le signe de la divinité, la croix à anse répétée quatre
fois: c’est une répétition que je n’ai jamais rencontrée que dans ce seul endroit.
La ceinture et le casque de cette figure ne permettent point de douter qu’il ne
s’agisse d’un héros.
C ’est à la partie inférieure de toutes les colonnes qu’est le sujet le plus curieux ;
c’est une image d’oiseau symbolique posée sur une coupe, précédée d’une étoile, et
tout-à-fait semblable aux figures qu’on voit sur les colonnes de Philæ et d’Apolli-
nopolis magna. Dans un mémoire sur cette dernière ville, j’ai donné le nom de
phénix à cet oiseau mystérieux quija des ailes, le bec d’un aigle et une huppe sur la
tête, et j’ai exposé les motifs qui viennent à l’appui démon opinion (1): je me bornerai
donc à renvoyer à ces recherches, et à ajouter que peut-être ici, comme a
Edfoû, le symbole du phénix annonce que le monument a été fondé en mémoire
et à l’époque du renouvellement de la période sothique. La coupe sur laquelle est
ici la figure du phénix, semble sortir du milieu des lotus, qui eux-mêmes sortent des
feuilles entrelacées, comme dans les monumens que j’ai cités tout-à-I’heure. Quant
à la base sur laquelle les colonnes reposent, elle est cylindrique et sans aucun
ornement.
Le portique étoit couronné par un entablement qui ne subsiste plus qu’en partie;
la frise, avec son cordon, a i “,79 de hauteur, c’est-à-dire, est de la même hauteur
que la corniche, et presque égale au diamètre du chapiteau.
La frise étoit décorée de deux bandes horizontales d’hiéroglyphes, et, au milieu,
d’un globe ailé. La corniche formoit une gorge saillante et d’un effet très-agréable à
l’oeil : le milieu renfermoit un vaste globe ailé, et le reste étoit orné de cannelures
et de légendes hiéroglyphiques.
Le plafond du portique subsiste encore en partie ; on y voit des hiéroglyphes
sculptés.
Je terminerai ici la description succincte des ornemens du temple d’Antæopolis,
en ajoutant que l’ornement Égyptien qui occupoit le milieu de la frise du frontis-
• (1) Voyez la planche 4/ , et la planche 38, fig. y , et consultez la Description d'Edfoû, A. D . ch. Vj pàg. 2p.