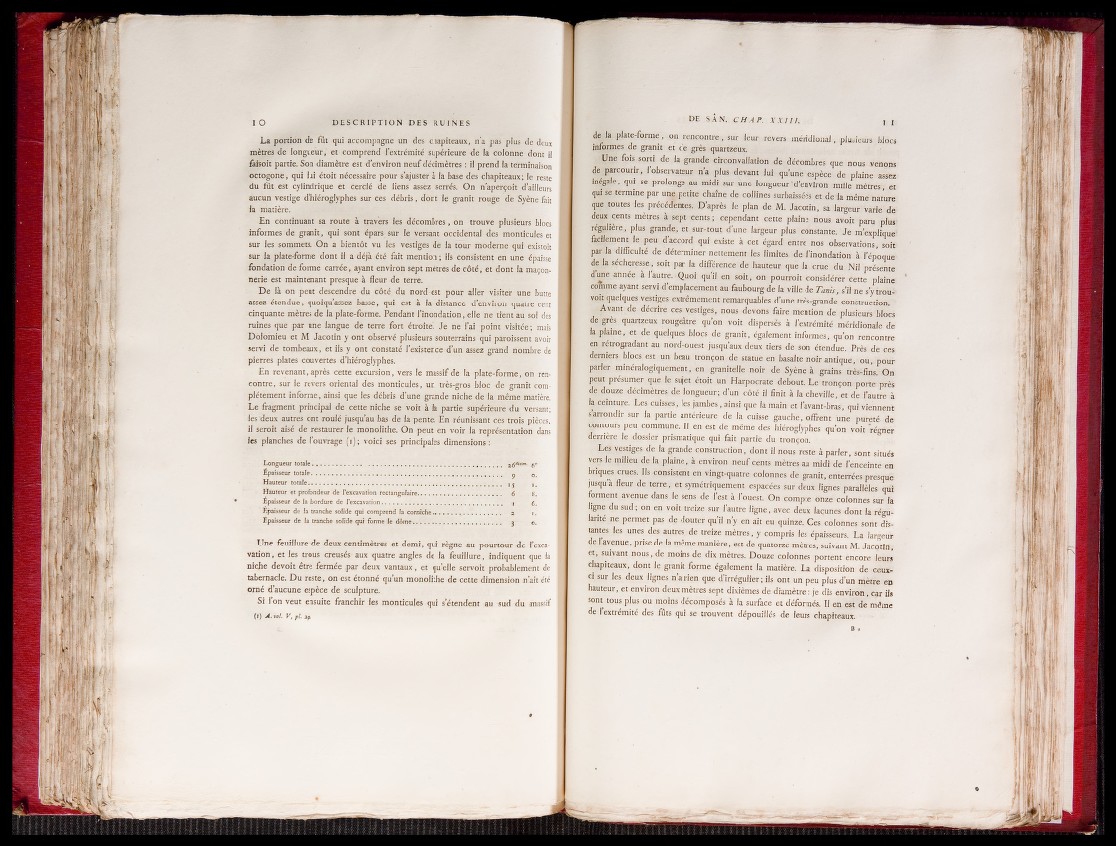
La portion de fût qui accompagne un des chapiteaux, n'a pas plus de deux
mètres de longueur, et comprend l’extrémité supérieure de la colonne dont il
faisoit partie. Son diamètre est d’environ neuf décimètres : il prend la terminaison
octogone, qui lui étoit nécessaire pour s’ajuster à la base des chapiteaux; le reste
du fut est cylindrique et cerclé de liens assez serrés. On n’aperçoit d’ailleurs
aucun vestige d’hiéroglyphes sur ces débris, dont le granit rouge de Syène fait
la matière.
En continuant sa route à travers les décombres, on trouve plusieurs blocs
informes de granit, qui sont épars sur le versant occidental des monticules et
sur les sommets. On a bientôt vu les vestiges de la tour moderne qui existoit
sur la plate-forme dont il a déjà été fait mention ; ils consistent en une épaisse
fondation de forme carrée, ayant environ sept mètres de côté, et dont la maçonnerie
est maintenant presque à fleur de terre.
De là on peut descendre du côté du nord est pour aller visiter une butte
assez étendue, quoiqu’assez basse, qui est à la distance d’environ quatre cent
cinquante mètres de la plate-forme. Pendant l’inondation, elle ne tient au sol des
ruines que par une langue de terre fort étroite'. Je ne l’ai point visitée; mais
Dolomieu et M. Jacotin y ont observé plusieurs souterrains qui paroissent avoir
servi de tombeaux, et ils y ont constaté l’existence d’un assez grand nombre de
pierres plates couvertes d’hiéroglyphes.
En revenant, après cette excursion, vers le massif de la plate-forme, on rencontre,
sur le revers oriental des monticules, un très-gros bloc de granit complètement
informe, ainsi que les débris d’une grande niche de la même matière.
Le fragment principal de cette niche se voit à la partie supérieure du versant;
les deux autres ont roulé jusqu’au bas de la pente. En réunissant ces trois pièces,
il seroit aisé de restaurer le monolithe. On peut en voir la représentation dans
les planches de l’ouvrage (1); voici ses principales dimensions;
Longueur to ta le ..............................................................................................................................
Épaisseur to ta le ................................................................................................................... p o.
Hauteur totale................................................................................................................................. , , lm
Hauteur et profondeur de Texcavation rectangulaire........................................................ 6 8.
Épaisseur de la bordure de l’excavation....................................................... j
Epaisseur de la tranche solide qui comprend ïa corniche . . . . . . . . . . . . . 2 1.
Epaisseur de la tranche solide qui forme ïe dôme.......................................................... 2 o.
Une feuillure de deux centimètres et demi, qui règne au pourtour de l’exca-
vation, et les trous creusés aux quatre angles de la feuillure, indiquent que la
niche devoit être fermée par deux vantaux, et qu’elle servoit probablement de
tabernacle. Du reste, on est étonné quun monolithe de cette dimension n’ait été
orné d’aucune espèce de sculpture.
Si Ion veut ensuite franchir les monticules qui s’étendent au sud du massif
(l) A. vol. V , pl. 2p.
de la plate-forme, on rencontre, sur leur revers méridional, plusieurs blocs
informes de granit et de grès quartzeux.
Une fois sorti de la grande circonvallation de décombres que nous venons
de parcourir, l’observateur n’a plus devant lui qu’une espèce de plaine assez
inégale, qui se prolonge au midi sur une longueur'd’environ mille mètres, et
qui se termine par une petite chaîne de collines surbaissées et de la même nature
que toutes les précédentes. D ’après le plan de M. Jacotin, sa largeur varie de
deux çents mètres à sept cents; cependant cette plaine nous avoit paru plus
régulière, plus grande, et sur-tout d’une largeur plus constante. Je m’explique'
facilement le peu daccord qui existe à cet égard entre nos observations, soit
par la difficulté de déterminer nettement les limites de l’inondation à l’époque
de la sécheresse, soit par la différence de hauteur que la crue du Nil présente
dune année à 1 autre. Quoi qu’il en soit, on pourroit considérer cette plaine
comme ayant servi d’emplacement au faubourg de la ville de Tanis, s’il ne s’y trou-
voit quelques vestiges extrêmement remarquables d’une très-grande construction.
Avant de décrire ces vestiges, nous devons faire mention de plusieurs blocs
de grès quartzeux rougeâtre qu’on voit dispersés à l’extrémité méridionale de
la plaine, et de quelques blocs de granit, également informes, qu’on rencontre
en rétrogradant au nord-ouest jusqu’aux deux tiers de son étendue. Près de ces
derniers blocs est un beau tronçon de statue en basalte noir antique, ou, pour
parler minéralogiquement, en granitelie noir de Syène à grains très-fins. On
peut présumer que le sujet étoit un Harpocrate debout. Le tronçon porte près
de douze décimètres de longueur; d’un côté il finit à la cheville, et de l’autre à
la ceinture. Les cuisses, les jambes, ainsi que la main et l’avant-bras, qui viennent
s’arrondir sur la partie antérieure de la cuisse gauche, offrent une pureté, de
contours peu commune. Il en est de même des hiéroglyphes qu’on voit ’régner
derrière le dossier prismatique qui fait partie du tronçon.
Les vestiges de la grande construction, dont il nous reste à parler, sont situés
vers le milieu de la plaine, à environ neuf cents mètres au midi de l’enceinte en
briques crues. Ils consistent en vingt-quatre colonnes de granit, enterrées presque
jusqu’à fleur de terre, et symétriquement espacées sur deux lignes parallèles qui
forment avenue dans le sens de l’est à l’ouest. On compte onze colonnes sur la
ligne du sud; on en voit treize sur l’autre ligne, avec deux laçunes dont la régularité
ne permet pas de douter qu’il n’y en ait eu quinze. Ces colonnes sont distantes
les unes des autres de treize mètres, y compris les épaisseurs. La largeur
de 1 avenue, prise de la même manière, est de quatorze mètres, suivant M. Jacotin,
et, suivant nous, de moins de dix mètres. Douze colonnes portent encore leurs
chapiteaux, dont le granit forme également la matière. La disposition de ceux-
ci sur les deux lignes n’a rien que d’irrégulier ; ils ont un peu plus d’un mètre en
hauteur, et environ deux mètres sept dixièmes de diamètre : je dis environ, car ils
sont tous plus ou moins décomposés à la surface et déformés. Il en est de même
de 1 extrémité des fûts qui se trouvent dépouillés de leurs chapiteaux.