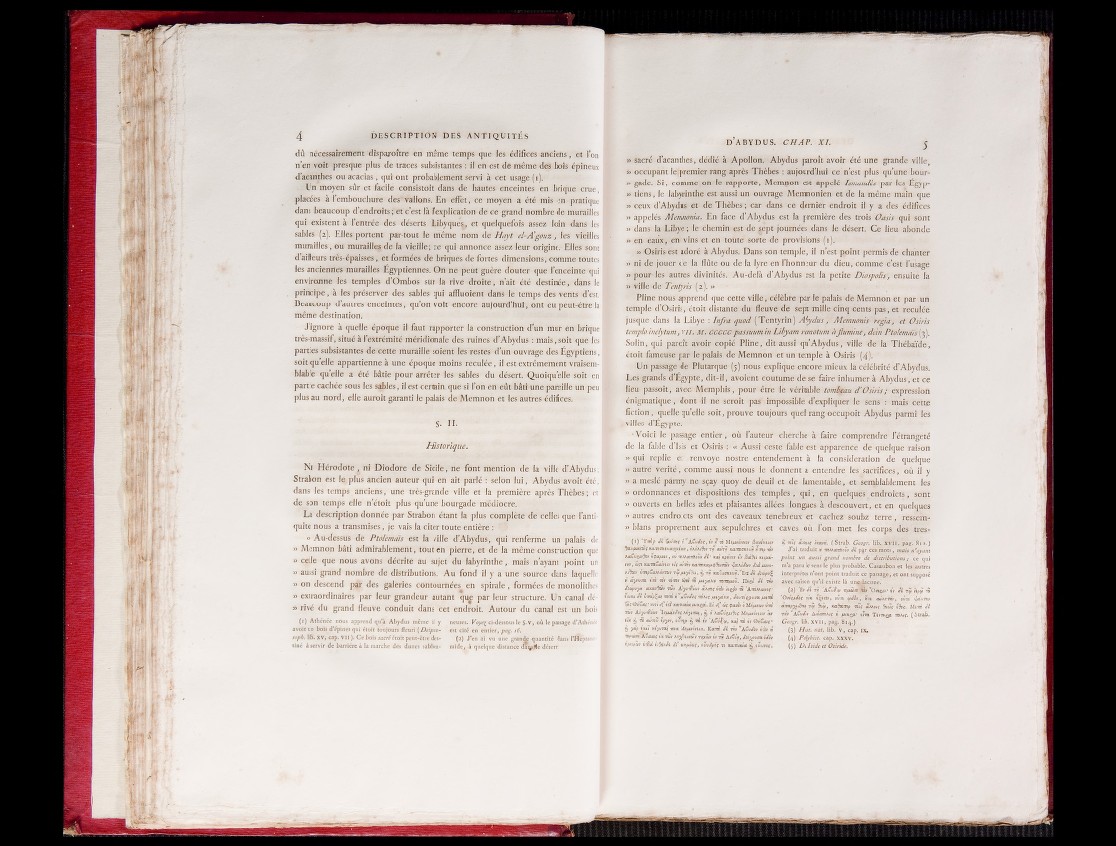
dû nécessairement disparoître en même temps que fes édifices anciens, et l’on
n’en voit presque plus de traces subsistantes : il en est de même des bois épineux
d’acanthes ou acacias, qui ont probablement servi à cet usage (i).
Un moyen sûr et facile consistoit dans de hautes enceintes en brique crue,
placées à l’embouchure des'valions. En effet, ce moyen a été mis en pratique
dans beaucoup d’endroits ; et c’est là l’explication de ce grand nombre de murailles
qui existent à l’entrée des déserts Libyques., et quelquefois assez loin dans les
sables (2). Elles portent par-tout le même nom de Heyt el-A’gouz, les vieilles
murailles, ou murailles de la vieille; ce qui annonce assez leur origine. Elles sont
d ailleurs très-épaisses, et formées de briques de fortes dimensions, comme toutes
les anciennes murailles Egyptiennes. On ne peut guère douter que l’enceinte qui
environne les temples d’Ombos sur la rive droite, n’ait été destinée, dans le
principe, à les préserver des sables qui affluoient dans le temps des vents d’est.
Beaucoup d’autres enceintes, qu’on voit encore aujourd’hui, ont eu peut-être la
même destination,
J’ignore à quelle époque il faut rapporter la construction d’un mur en brique
très-massif, situé à i’eJctrémité méridionale des ruines d’Abydus : mais, soit que les
parties subsistantes de cette muraille soient les restes d’un ouvrage des Égyptiens,
soit qu’elle appartienne à une époque moins reculée, il est extrêmement vraisemblable
qu’elle a été bâtie pour arrêter les sables du désert. Quoiqu’elle soit en
partie cachée sous les sables, il est certain.que si l’on eh eût bâti une pareille un peu
plus au nord, elle auroit garanti le palais de Memnon et les autres édifices.
§. II.
Historique.
Ni Elérodote, ni Diodore de Sicile, ne font mention de la ville d’Abydus;
Strabon est le plus ancien auteur qui en ait parlé ; selon lui, Abydus avoit été, :
dans les temps anciens, une très-grande ville et la première après Thèbes; et
de son temps elle n’étoit plus qu’une bourgade médiocre.
La description donnée par Strabon étant la plus complète de celles que l’anti-1
quité nous a transmises, je vais la citer toute entière :
« Au-dessus de Ptolcmdis est la ville d’Abydus, qui renferme un palais de I
» Memnon bati admirablement, tout en pierre, et de la même construction que I
» celle que nous aVohs décrite au sujet du labyrinthe,. mais n’ayant point un I
» aussi grand nombre de distributions. A u fond il y a une source dans laquelle I
» on descend par des galeries contournées en spirale, formées de monolithes ;
» extraordinaires par leur grandeur autant que par leur structure. Un canal de-1
» rivé du grand fleuve conduit dans cet endroit. Autour du canal est un bois I
( 1 ) A th e n e e nous apprend q u ’à A b y d u s même il y neuses. Voye% ci-dessous le $. v , o ù le passage d ’Athénée I
a v o it un b o is d’ épines q u i é to it toujou rs fleuri ( D e ip n o- e st c ité en e n t ie r , pag. 16.
soph. lib . XV, cap . v u ). C e bois s a c r é é to it p eu t-ê tre d es - (2) J ’en a i vu une grantte q u an tité dans I’fïéptano- I
t in e à se rv ir d e ba rrière a la ma rch e des dunes sab lon- m id e , à quelque d is tan ce dài^itfe désert.
D ABYDUS. CHAP. XI. s
» sacré d’acanthes, dédié à Apollon. Abydus paroît avoir été une grande ville
» occupant le premier rang après Thèbes : aujourd’hui ce n’est plus qu’une bour-
» gade. Si, comme on le rapporte, Memnon est appelé Ismandcs par les Égyp-
» tiens, le labyrinthe est aussi un ouvrage Memnonien et de la même main que
» ceux d’Abydus et de Thèbes'; car dans ce dernier endroit il y a des édifices
3) appelés Memnonia. En face d’Abydus est la première des trois Oasis qui sont
» dans la Libye ; le chemin est de .sept journées dans le désert. Ce lieu abonde
» en eaux, en vins et en toute sorte de provisions (i).
y> Osiris est adoré à Abydus. Dans son temple, il n’est point permis de chanter
» ni de jouer de la flûte ou de la lyre en l’honneur du dieu, comme c’est l’usage
» pour les autres divinités. Au-delà d’Abydus est la petite Diospolis, ensuite la
» ville de Tentyris (2). »
Pline nous apprend que cette ville, célèbre par le palais de Memnon et par un
temple d’Osiris, étoit distante du fleuve de sept mille cinq cents pas, et reculée
jusque dans la Libye : Infra quod (Tentyrin) Abydus, Memnonis régi a, et Osiris
tcmplo inclytum, v il. M . C C C C C passuum in Libyam remotum àflumine, dein P'tolemeiis (3).
Solin, qui paroît avoir copié Pline, dit aussi qu’Abydus, ville de la Thébaïde,
étoit fameuse par le palais de Memnon et un temple à Osiris (4 ).
Un passage de Plutarque (y) nous explique encore mieux la célébrité d’Abydus.
Les grands d’Égypte, dit-il, avoient coutume de se faire inhumer à Abydus, et ce
lieu passoit, avec Memphis, pour être le véritable tombeau d'Osiris ; expression
énigmatique, dont il ne seroit pas impossible d’expliquer le sens : mais cette
fiction, quelle qu’elle soit,prouve toujours quel rang occupoit Abydus parmi les
, villes d’Égypte.
■Voici le passage entier, où l’auteur cherche à faire comprendre l’étrangeté
de la fable d’Isis et Osiris ; « Aussi ceste fable est apparence de quelque raison
» qui replie et renvoyé nostre entendement à la considération de quelque
» autre vérité, comme aussi nous le donnent à entendre les sacrifices, où il y
» a meslé pârmy ne sçay quoy de deuil et de lamentable, et semblablement les
» ordonnances et dispositions des temples, qui, en quelques endroicts, sont
» ouverts en belles æles et plaisantes allées longues à descouvert, et en quelques
» autres endroicts ont des caveaux tenebreux et Cachez soubz terre, ressent-
» blans proprement aux sepulchres et caves où l’on met les corps des mes-
( 1 ) Tîtî'j» S i tsiv-niç h ACvSbç , iv h 7» Ultptômor (&am\itor
Javpaçzoç xa.Ttmtve10p.tvor, óxóxtjor th euh» xa.TO.mtvH ij-zto t ir
xu€vetv%v ttfa p k v , ou 57DMaithovr S i ' xaf x f t im t r fc à j t ï x ttp t-
rwt, u , t xam C aiva r t t ç ewTHr xaTttxap^Jtiaur •dax/Jhiv Sict mvo-
xiJùiv vtnpSctMovmv t u p t y t j t i , Kj th xa.'ixmtvri.' Eçi S i Slùpv%
h a y v m tm mv tdtwv àW « pnytXH omapov. ITegÀ S i vir
Slàpvja. a xa.rjur tu v Alyo-tfliur &kooç éçiv !sgpV « ‘A tn tx u ro ç '
toix£ S i v-mp^ep tn t i « A CvSoç v é x iç p t y i x n , S iv itQ p v o ztp u ò
©«£«$• vvn di' ¿ i f xa .'miùapixçy .. E ! di’ ù ç tpanr ô ULipuur vm
TÛr Ai-ysofliur ‘îep d rS h ç M i t r a i , £ 0 xaCvej.r%( Ultpvôvtiov o r
£<>i è & iPV>y> 5 7“ *K A C v S u , x a j m tr ©i¡Caiç-
5 W .*«*’ ^tyiTip m a Mtprórtia. K « t o S i thv vACvSbr tà v w
tDpômi A v a n f i x i ù r x t ^ t t a u r t ç / u v ir th AiC vh, Sitavate. ¿Sir
i\ptpur i in a tt J trS ï Si’ tpnpto ç, tvvSpôç n xa ïo ix ia x^tvoiroç,
Xjtôïç ¿Mo/«- Ixarn. ( Strab. Geogr. Iib. X v ii, pag. 812. )
J ai traduit w mixa?iXovr Si par ces mots, mais n’ayant
point un aussi grand nombre de distributions ; ce qui
m’a paru le sens le plus probable, Casaubon et les autres
interprètes n’ont point traduit ce passage, et ont supposé
avec raison qu’il existe là uneglacune.'
( 2 ) Er S ï th A C v S u n p u o t a ir vOn&LV t r Si t u îtpu «
Onç/.Sbç ovx t^ t it r , o v n u e f i r \ s t t cluxythv , 0v i t yfdxTHr
amp^tcdtp r u % u , xa.Ja.7ttp i t i ç ¿m 0/? 5soiç t jo ç . M s r a S i
th v AÇvSbr Aioam xiç « p u x ^ i ' tînt T t tm ç y . tîoxjç. ( S t r a b .
Geogr. lib . X V I I , pag. 8 14 .)
(3) Hist. nat. lib. v , cap. îx.
(4) Poiyhist. cap. xxxv.
(5) De Iside et Osiride,
< j : s .. i ' ■; ‘ 'i. ; ;t ï r é t î- : ■:.. - '■ ; : ■ ; ; . i: f v i i