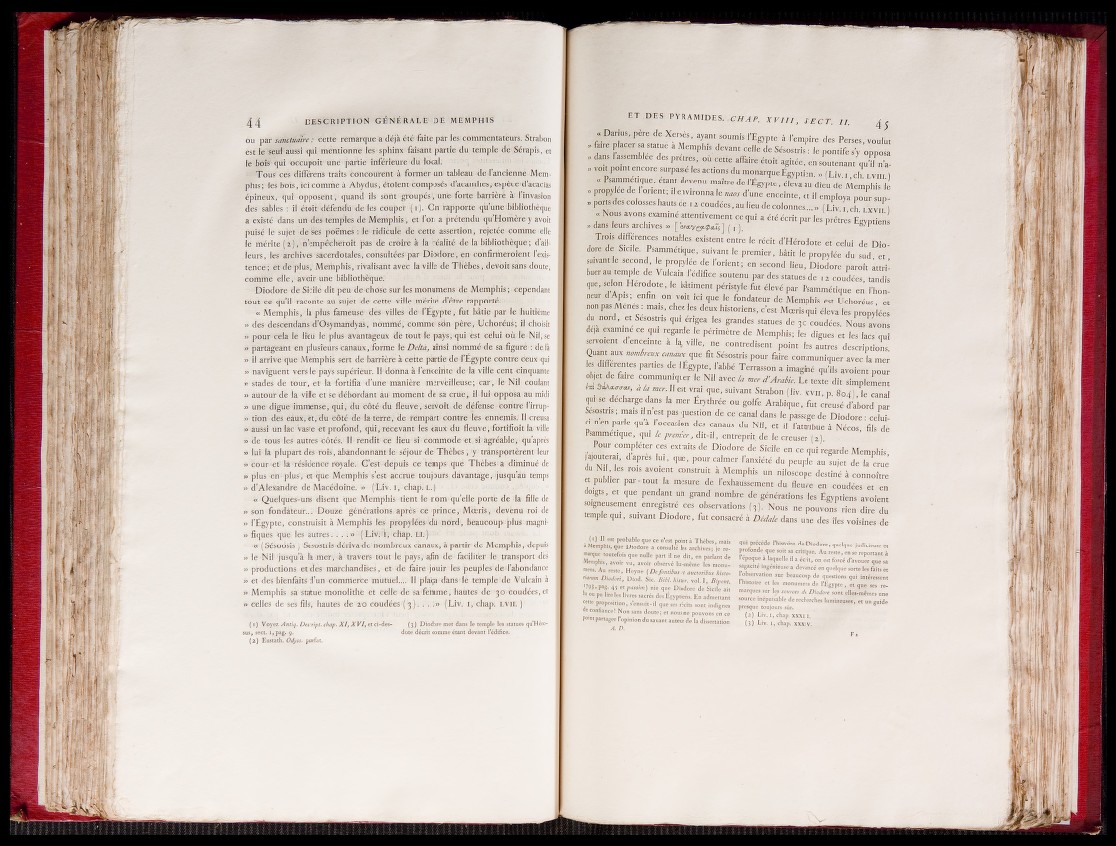
ou par sanctuaire : cette remarque a déjà etc faite par Jes commentateurs. Strabon
est le seul aussi qui mentionne les sphinx faisant partie du temple de Sérapis, et
le bois qui oécupoit une partie inférieure du local.
Tous1 ces différens traits concourent à fonner un tableau de l’ancienne Memphis;
les bois, ici comme à Abydus, étoient composés d’acanthes, espèced’acacias
épineux, qui opposent, quand ils sortt groupés, une- forte barrière a I invasion
des sables : il étoit défendu de les coupeV ( r). On rapporte qU une bibliothèque
a existé dans un des temples de Memphis, et l’on a prétendu qu’Homère y avoit
puisé le sujet de ses poèmes : le ridicule de cette assertion, rejetée comme elle
le mérite (2), n’empêcberoit pas de croire à la réalité de la bibliothèque ; d’ailleurs,
les archives sacerdotales, consultées par Diodore, en confirmeraient l’existence
; et de plus, Memphis, rivalisant avec la ville de Thèbes, devoit sans doute,
comme elle, avoir une bibliothèque.
Diodore de Sicile dit peu de chose sur les monumens de Memphis ; cependant
tout ce qu’il raconte au sujet de cette ville mérite d’être rapporté.
« Memphis, la plus fameuse des villes de l’Egypte, fut bâtie par le huitième
des descendans d’Osymandyas, nommé, comme- sbn père, UchoréuS; il choisit
pour cela le lieu le plus avantageux de tout le pays, qui est celui où le Nil, se
partageant en plusieurs canaux, forme le Delta, ainsi nommé de sa figure : delà
il arrive que Memphis sert de barrière à cette partie de l’Egypte contre ceux qui
naviguent vers le pays supérieur. Il donna à l’enCeirite de la ville cent cinquante
stades de tour, et' la fortifia d’une manière merveilleuse; car, lé Nil coulant
autour de la ville et se débordant àu moment de sa crue, il lui opposa au midi
une digue immense, qui, du côté du fleuve, setvoit de défense contre l’irruption
des eaux, et, du côté de la terre, de rempart contre les ennemis. Il creusa
aussi un lac vaste et profond, qui, recevant les eaux du fleuve, fortifioit la- ville
de tous les autres côtés. Il rendit ce lieu si commode et si agréable, qu’après
lui là plupart des rois, abandonnant le- séjour de Thèbes , y transportèrent leur
cour et la résidence royale. C ’est depuis ce temps que Thèbes a diminué de
plus en plus, et que Memphis s’est accrue toujours davantage, jusqu’au temps
d’Alexandre de Macédoine. » (Liv. 1, chap. L. j >
« Quelques-uns disent que Memphis tient le nom qu’elle porte de la fille de
son fondâteur.... Douze générations, après ce prince, Moeris, devenu roi de
l’Égypte, construisit à Memphis les prOpylées du nòrd, Beaucoup plus-magnifiques
que les autres. 3 .-{-A (Liv: 1, châp. L l . )
•« (SéSoôsis j Sésostris dérivade nombreux canaux, à partir de Memphis, depuis
le Nil jusqu’à la mer, à travers tout le pays, afin de facilitfer le transport dès
productions et des marchandises, et de faire jouir les peuples'de-l’abondance
et des bienfaits d’un commerce mutuel.... Il plaiça dansle temple de Vulcain a
Memphis sa statue monolithe et celle de sa feinme, hautes de 30 coudées,et
celles de ses fils, hautes de 20 coudées (3} . . . .» (Liv. 1, chap. l v i i . )
( i ) Voyez Antiq. Descript, chap. X I , X VI, et ci-dessus,
sect. I,pag. 9.
(2) Eus ta th. Odyss. præfat.
( 3 ) Diodore met dans le temple les statues qu Hérodote
décrit comme étant devant l’édifice.
« Darius, père de Xerxès, ayant soumis l’Egypte à l’empire des Perses, voulut
J fane placer a statue a Memphis devant celle de Sésostris : le pontife sy opposa
» dans 1 assemblée des prêtres, où cette affaire étoit agitée, en soutenant qudl n’a-
» von pomt encore surpassé les actions du monarque Égyptien. 1 (Liv. t , ch. lv i i i )
| Psammcttque, étant devenu maître de l’Égypte, éleva au dieu de Memphis Je
» propylee de 1 orient; il environna le naos d’une enceinte, et il employa pour supp
o r t s des colosses hauts de 12 coudées, au lieu de colonnes....,, (Liv 1 ch l x v , 1
« Nous avons examiné attentivement ce qui a été écrit par les prêtre’s Égyptien
» dans leurs archives » [ ( r b/J
I B m t m n° taWeS eXiSt6nt 6ntre le rédt ¿ ’Hérodote et celui de D io dore
de Sicile. Psammetique, suivant le premier, bâtit le propylée du sud et
suivant le second, le propylée de l’orient; en second lieu, Diodore paroît attribuer
au temple de Vulcain l’édifice soutenu par des statues de ,2 coudées, tandis
que, selon Hérodote, le bâtiment péristyle fUt élevé par Psammétique en l’honneur
d Apis; enfin on von ici que le fondateur de Memphis est Uchoréus et
non pas Menes : mais, chez les deux historiens, c’est Moeris qui éleva les propylées
du nord, et Sésostris qui érigea les grandes statues de 30 coudées. Nous avons
de,a examine ce qui regarde le périmètre de Memphis; les digues et les lacs qui
servoient d enceinte a la, ville, ne contredisent point les autres descriptions
Quant aux nombreux canaux que fit Sésostris pour faire communiquer avec la mer
les différentes parties de 1 Egypte, l’abbé Terrasson a imaginé qu’ils avoient pour
objet de faire communiquer le Nil avec la mer d ’Arabie. Le texte dit simplement
* . ¿h*«nra., à la mrr.il est vrai que, suivant Strabon (liv. x v n , p. 804), le canal
qui se déchargé dans la mer Erythrée ou golfe Arabique, fin creusé d’abord par
Sésostris ; mais il n est pas question de ce canal dans le passage de Diodore : celui-
ci n en parle qu a l’occasion des canaux du Nil, et il l’attribue à Nécos, fils de
Psammetique, qui le premier, d it-il, entreprit de le creuser (2)
. Pour compléter ces extraits de Diodore de Sicile en ce qui regarde Memphis
lajouteiai, d après lui, que, pour calmer l’anxiété du peuple au sujet de la crue’
du Ni! les rois avoient construit à Memphis un niloscope destiné à connoître
et publier par-tout la mesure de l’exhaussement du fleuve en coudées et en
doigts, et que pendant un grand nombre de générations les Égyptiens avoient
soigneusement enregistré ces observations (3). Nous ne pouvons rien dire du
temple qui, suivant Diodore, fut consacré à Dédale dans une des îles voisines de
(1) II est probable que ce n’est pointa Thèbes, mais qui précède l’hisroir» a» n ; a i .
à Memphis, que Diodore a consulté les archives ■ e re n r ô f o T ’ Î ” 1'qUe H id euse «
H R S B B M ¡ S B
‘793 » Pag. 41 et passim) nie que H » ~ £ ~ e" Î Ü P *
lu ou pu lire les livres sacrés des Fovnripnc V ♦ , sou,ces de D ,°dore sont elles-memes une
s
de confiance! Non sans doute; et nous ne pouvons en ce (a) Liv. i , chap. x x x tu
point partager l'o pin ion du savant au teur d e la dissertation ( 3 ) L iv . I , chap. x x x t v
A. D.
Fx